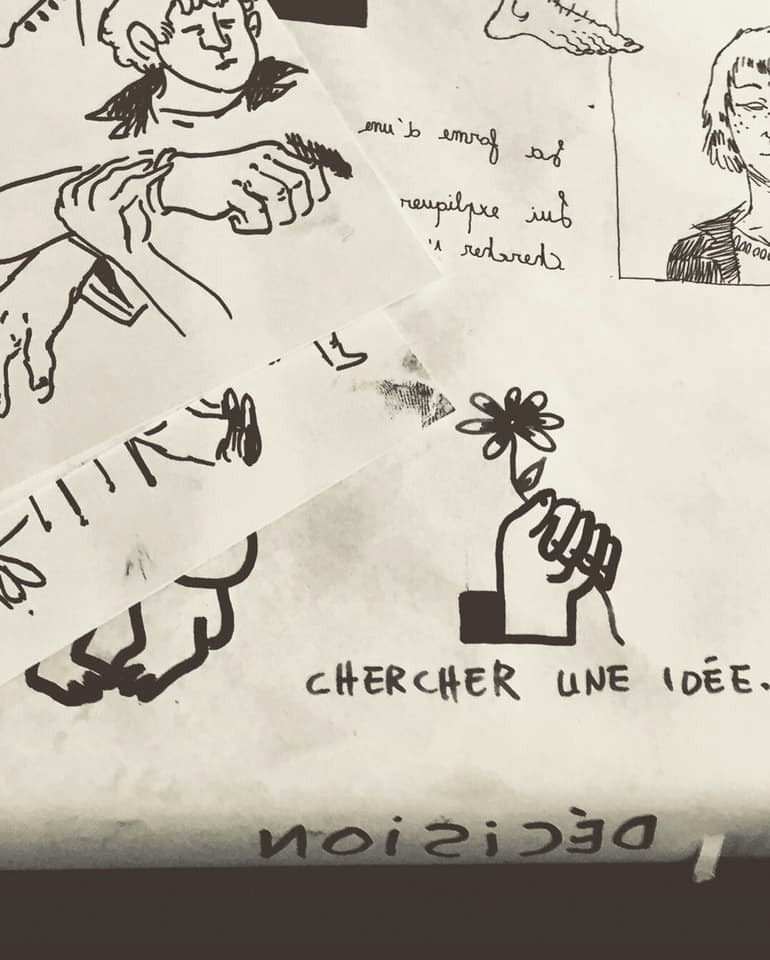Le 19 mars 2012, je suis intervenu devant un échantillon d'une vingtaine d'élèves de CE1 et CE2 volontaires d'une école du Ve arrondissement de Paris pour participer à des ateliers philo les lundis entre 12 heures 30 et 13 h15. Ma venue avait été sollicitée par les trois professeures de ces classes, qui assistaient à la séance. Je précise que l'un de ces élèves est mon petit-fils.
Lors des ateliers précédents, les élèves avaient "travaillé" sur deux thèmes distincts: le travail et l'argent. Les diverses idées philosophiques exprimées par les élèves sur ces thèmes avaient été mises en ordre par eux et leurs professeures. Ce qui m'a frappé en lisant ces "idées philosophiques", c'est qu'elles sont à la fois basiques, de bon sens, et qu'elles sont en même temps les grandes idées des grands philosophes sur ces thèmes.
N'ayant moi-même aucune formation à la pratique de la philosophie en milieu élémentaire, j'ai accepté d'exposer "classiquement" aux enfants en quoi le travail qu'ils venaient de faire était de la philosophie et en quoi cela les préparait à juger par eux-mêmes.
Je joins les notes que j'ai prises et qui leur seront distribuées pour que les enfants conservent des traces des idées qu'ils ont entendues, et que leurs familles en soient averties. Les enfants ont été attentifs, six ou sept sont intervenus, soit pour poser des questions, soit pour donner leur avis.
Deux interventions m'ont frappé. Une petite fille s'est étonnée de l'usage élogieux par moi du mot "critique", qui veut dire "dire du mal de quelqu'un". Ça été l'occasion pour moi de mesurer à nouveau le malentendu entre l'émetteur et le public, et d'expliquer aux enfants que les mots ont le sens qu'ils leur donnent, et d'autres sens, et que le premier devoir dans une relation philosophique est de préciser le sens qu'on donne aux mots.
Un autre élève m'a fait remarquer qu'il est normal que les philosophes n'aient pas la même idée du bonheur puisque le bonheur varie selon les gens. Je me suis promis d'en parler aux professeures qui ont décidé de mettre le thème du bonheur au programme des prochains ateliers. Après tout, c'est une question préalable : est-ce que les philosophes ont raison de chercher et de prêcher la bonne conception du bonheur ?
L'expérience m'a fait toucher du doigt une difficulté sémantique que je n'ai sans doute pas réussi à surmonter : la différence entre une opinion subjective dans laquelle on s'implique passionnément, et une idée objective qu'on soumet à la discussion sans en faire une affaire personnelle. J'ai d'ailleurs admis que lorsque les philosophes débattent, ils sont loin d'être détachés de leurs idées.
Voici le texte que je leur laisse :
"Normalement c'est en classe terminale, vers 18 ans, qu'on étudie la philosophie.
Votre maîtresse a réussi à vous faire pratiquer de la philosophie dès maintenant. Voyons en quoi c'était de la philosophie.
1) Vous avez abordé des questions du type "Que faut-il faire ?, et non " Comment faire ?". Non pas "Comment gagner de l'argent ?" ni "À quelle profession faut-il se préparer ?" mais "Qu'est-ce que le travail ?" "Que nous apporte-t-il ?", "Faut-il être chercher à être riche ?
La philosophie se pose des questions générales et premières. : "Qu'est-ce que la vérité ? Qu'est-ce que la justice? Sommes-nous des animaux ou avons-nous une âme ? Qu'est-ce que nous devons chercher avant tout dans notre vie : être heureux ? Avoir la gloire ? La richesse? Une vie d'aventure ? Une vie tranquille ? Etre utiles aux autres ?".
2) Ce sont des questions de philosophie parce que ce sont des questions ouvertes, auxquelles existent des réponses raisonnables et divergentes.
3) C'est un exercice de philosophie parce que les arguments échangés doivent être des idées qu'on peut discuter. Le contraire du débat philosophique consiste à dire "Moi je pense ça, alors ça me suffit" ou "Ma religion dit que, et on n'en discute pas" ou encore "Chacun pense ce qu'il veut et on n'en discute pas".
5) Votre intelligence est seul juge.
À la différence des religions et de la science, en philosophie, chacun est obligé de juger par lui-même, de se faire un jugement à partir de positions philosophiques raisonnables et divergentes.
6) Conséquences.
Quand on vous apprendra les règles pour bien se conduire, il faudra les suivre parce que ce sont des règles voulues par ceux qui vous entourent. Mais vous aurez le droit de discuter pour savoir si elles sont justes. Cela s'appelle l'esprit critique, la liberté de penser. (Vous avez aussi la liberté de conscience, le droit de penser n'importe quoi, mais c'est une autre liberté).
7) La philosophie est née dans la Grèce antique (400 ans avant Jésus-Christ), parce que c'était une démocratie, comme nous. La philosophie est devenue nécessaire et possible quand la société pose que "les êtres humains naissent libres". Comment décider ensemble quand chacun est libre de penser et de vouloir ? Par le dialogue qui cherche sur quoi on devrait se mettre d'accord parce que c'est vrai, juste et bon.
Philosophie : du grec philo qui aime, et sophia, sagesse. Sont philosophes ceux qui aiment et qui cherchent la sagesse, savoir comment il faut vivre.
8) Pour vous préparer à juger par vous-mêmes dans les débats philosophiques que vous rencontrerez dans votre vie, il faut avoir compris :
- que toutes les convictions et toutes les évidences peuvent être examinées et débattues sans tabou ;
- qu'il y a des questions de choix qui ne sont pas fermées, qui sont discutables, parce qu'il existe à leur sujet des points de vue raisonnables et divergents ;
- qu'il faut essayer de reconnaître ce qu'il y a de vrai dans ce qu'on ne pense pas soi-même, car toutes les opinions ne se valent pas ;
- qu'il faut apprendre à raisonner en suivant les idées logiquement, sans faire interférer des sentiments et des insultes ;
- qu'il faut commencer par définir précisément les mots dont on se sert ;
- et s'informer de ce qui a été écrit d'essentiel sur le sujet auquel on réfléchit.
On peut alors juger par soi-même et en connaissance de cause".