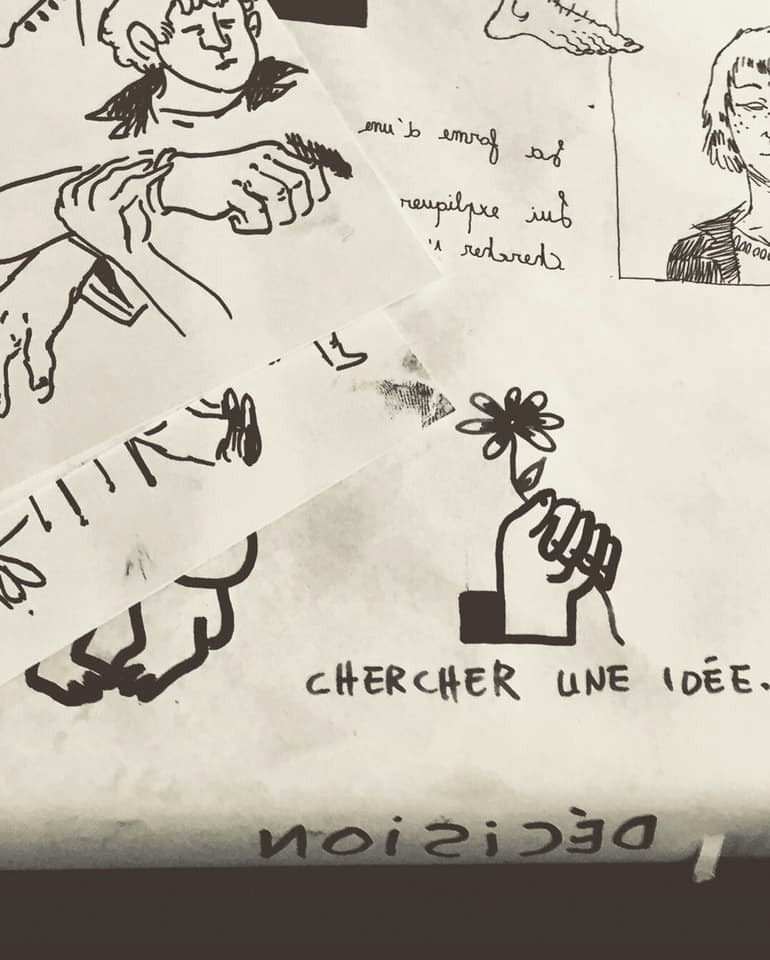L'instauration d'un enseignement d'éducation civique, juridique et sociale en classe de terminale des lycées constitue non seulement une préoccupation pédagogique de participation, de développement des capacités cognitives et analytiques et d'autonomisation de l'élève en situation d'apprenant, mais aussi une éducation à la citoyenneté, dans une dimension qui transcende le stricte cadre référentiel et institutionnel de l'école. Il s'agit non seulement d'apprendre mais d'apprendre à être, et d'acquérir par une auto-formation un statut de citoyen responsable conscient de ses obligations légales et légitimes au sein d'une collectivité fonctionnant sur des bases identitaires communes. Cela implique l'acceptation de l'autre comme semblable et différent à la fois. Les finalités d'un tel enseignement et sa démarche apparaissent donc multiples. Il devient alors nécessaire de préciser ses objectifs pédagogiques dans le contexte d'un cursus scolaire terminal en fonction de l'horaire attribué (une heure par quinzaine).
Que peut-on attendre et exiger d'un élève de terminale concernant l'acquisition, non seulement de connaissances intra ou extra-scolaires, mais surtout d'une démarche réflexive plus ou moins occultée jusqu'alors, dans son système référentiel essentiellement basé sur la reproduction d'informations et de savoir-faire ? Cela pose la nécessité d'une méthodologie déterminée préalablement par les acteurs du système instauré, à savoir les enseignants (mais quel rôle jouent-ils précisément : animateur, coordinateur, donneur d'informations, orienteur ?), les élèves (sont-ils toujours en situation d'apprenant ou d'autonomisation ?), et les examinateurs chargés d'évaluer la production (reste à préciser les critères d'évaluation et les attentes institutionnelles).
Cependant la méthodologie (du débat argumenté) ne constitue qu'un aspect d'un vaste processus intégrant le travail en équipe, la recherche de documents diversifiés et transversaux (histoire, géographie, sociologie, psychologie, économie, sciences...), la collaboration des documentalistes, éventuellement d'intervenants ou de consultants extérieurs à l'établissement, dans des cadres multiples : salle de classe, CDI, rencontres sur le terrain (hôpital, clinique, maison de retraite, laboratoire, musée,
bibliothèque municipale, maison des jeunes, tribunal, centre social, sportif...).
La production d'un document-bilan final passe par la rédaction et la constitution d'un dossier argumenté sur une question préalablement déterminée en commun. Reste à déterminer le mode de diffusion en classe sous forme d'exposé et le processus d'évaluation, sachant que les trois facteurs déterminants concernent le contenu (c'est-à-dire la qualité de l'information et la maîtrise des connaissances en relation avec la recherche effectuée), la construction du travail, et sa communication sous forme de gestion de l'argumentation dans un débat alimenté et respectueux des différences d'opinions et de jugements.
Des thèmes sont proposés aux élèves pour faciliter cette démarche novatrice, sous forme de fiches d'exemples et de ressources complétées par des questions possibles. Parmi celles-ci : les dons d'organes et de greffes humaines ; les droits et les libertés face à Internet ; les risques alimentaires, la couverture maladie universelle : un droit aux soins pour tous ; les hommes politiques sont-ils des justiciables comme les autres ? faut-il donner le droit de vote aux étrangers ? l'effet de serre et la responsabilité planétaire... À travers ces sujets d'actualité, c'est toute une philosophie qui s'exprime dans la finalité de la recherche. Les textes d'accompagnement de ces travaux précisent quatre stades dans leur réalisation :
a) un questionnement impulsant les orientations de la recherche, l'essentiel étant de savoir ce que l'on veut trouver, exposer et montrer, ce qui suppose la collecte d'informations et la réflexion collective en conséquence. Mais il s'agit de partir des attentes, des interrogations et des préoccupations des élèves, essentiellement par rapport aux problèmes de société, comme la violence, la drogue, la délinquance, la misère, la maladie, le sexe, le chômage...
b) une analyse critique des documents et des compétences diversifiées rassemblés, en dégageant l'information de l'idéologie qui peut être sous-jacente et tendancieuse, d'autant plus séduisante que l'élève ne possède pas nécessairement les arguments contradictoires lui permettant de dialectiser ;
c) une diversification des accès et supports qui présente l'information sous des angles diversifiés selon les sources référentielles, d'où la nécessité d'une analyse comparative ;
d) une adaptation de la ressource et des apports de la recherche par rapport au questionnement initial, ce qui renvoie au ré-investissement, à l'assimilation des connaissances et à une démarche méthodologique.
À partir de ces quatre facteurs, les élèves d'une terminale scientifique du lycée Clément Marot de Cahors ont établi un choix parmi les thèmes proposés officiellement, plus particulièrement ceux qui concernaient le domaine scientifique : dons d'organes et de greffes humaines. La difficulté principale a consisté à cerner une problématique à travers la multitude d'interrogations plus ou moins pré-déterminées mais suscitées souvent par l'avancement des recherches, portant sur les aspects éthique, politique, économique, religieux, moral, médical... La consultation des " lois " concernant la bio-éthique a été déterminante et a permis d'établir un plan :
- les dons d'organes légaux a) au niveau législatif ; b) du point de vue biologique et des techniques médicales ; c) concernant les personnes vivantes et/ou décédées ;
- les ventes d'organes et l'illégalité a) les trafics avec les pays défavorisés ; b) les conséquences au niveau médical ; c) les moyens de répression ;
- les méthodes d'avenir a) prélèvement sur les animaux ; b) clonage ;
c) reconstitutions artificielles ;
- et en conclusion, outre l'aspect technico-scientifique et sociologique, le problème de l'identité personnelle et de l'autonomie de la personne humaine, le respect du corps, vivant et/ou décédé.
Bien que sommaire, ce plan présente l'avantage de préciser les pré-requis, les finalités, la répartition des domaines d'investigation et du travail en sous-groupes, la mise en place d'un dispositif méthodologique et pédagogique. L'élément essentiel reste cependant le travail en équipe, la capacité d'investissement dans la recherche d'une documentation progressivement élaborée sous formes de références jusque là ignorées, occultées ou banalisées, notamment à travers la presse nationale, hebdomadaire et les mensuels littéraires, scientifiques, politiques ou économiques. L'utilisation d'Internet montre ses possibilités et ses limites, au delà de l'activité ludique de la recherche informelle, dans la mesure ou la collecte d'informations doit déboucher sur une production conceptualisée et argumentée collectivement. La participation et le statut nouveau d'élèves acteurs-auteurs, d'enseignants et de documentalistes oeuvrant différemment et complémentairement, instaurent un ensemble de relations privilégiées, valorisées et valorisantes, qui montrent à quel point l'acquisition d'un savoir passe par un savoir-être. L'apprentissage à la recherche dans le cadre de l'ECJS constitue un apprentissage à être pour devenir.
Dans ce contexte, quel rôle peut jouer la philosophie dans la didactisation de l'ECJS, qui constitue un enseignement théorique et pratique débouchant sur une prise de conscience de la réalité citoyenne et de son exigence éthique ? Comment concilier exigence sociale, morale et éthique, si ce n'est en se décentrant et en acceptant autrui comme constitutif de ma propre identité dans une relation duelle, dans la mesure où il m'oblige à m'extérioriser, à connaître, à comprendre et à m'interroger sur le sens des valeurs qui constituent l'humanité et la société ? L'éthique est une sagesse pratique dont la finalité consiste à donner un sens à sa vie afin de trouver le bonheur.
Il s'agit alors de concilier les exigences légales et les particularités individuelles, c'est-à-dire rechercher ce qui peut-être nécessaire pour bien vivre et vivre ensemble utilement. Cela exige connaissance, réflexion et engagement responsable dans la mesure où les conséquences de nos actes ont été l'objet de délibération. La philosophie, basée sur la recherche de la vérité et du sens, peut apporter des éléments de méthodologie où se trouvent privilégiés le questionnement, le dialogue, et la clarification des finalités de l'éducation civique : responsabilisation et engagement, prise en compte des réalités sociales au niveau politique, juridique, religieux, économique, intégration et assimilation à une culture, respect du droit à la différence et tolérance. L'éthique nécessite ici une rationalisation de la conduite citoyenne, une prise de décision concernant les problèmes de société. La philosophie va problématiser les définitions données scientifiquement et introduire une délibération individuelle, éthique, concernant les systèmes de représentation, par exemple du bonheur, du plaisir, du normal, du progrès, de la mort, du corps (biologique ou fantasmé) : la biotechnologie, la science, la médecine d'un côté, les conséquences éthiques et sociales de l'autre. L'homme est-il de nature corporelle, spirituelle, les deux complémentairement ?
Le second moment dans l'ECJS concerne l'exposition en classe et soulève le problème d'une " méthodologie du débat argumenté " permettant une didactisation de l'oral réflexif et ses conséquences sur l'enseignement de la philosophie en terminale : quelles en sont les modalités et les conséquences en terme d'apprentissage du philosopher ? Il est intéressant de remarquer que si la philosophie amène questionnement, problématique et conceptualisation, réciproquement, l'éducation civique apporte les thèmes d'actualité sociétaux, et une motivation au dialogue qui stimule davantage les élèves, et les autonomise, dans la mesure où ils se trouvent responsabilisés éthiquement et engagés dans un processus didactique d'exposition. L'homme-citoyen est en situation existentielle et la vie sociale constitue l'essence de son être. Les valeurs qui constituent son existence sont les valeurs de la société.
L'élève de terminale sera sensibilisé davantage aux problèmes d'actualité politique, économique, sportive, médicale... qu'à ceux soulevés par la philosophie, alors qu'il est possible pourtant de mieux les appréhender par l'intermédiaire des thèmes soulevés par l'ECJS. Le débat nécessite argumentation, connaissance et exposition, mais aussi motivation de la classe, en fonction de pré-requis permettant l'échange. Ceux-ci constituent la culture sociale, référentielle, issue des médias notamment. C'est en partant du questionnement et du vécu des élèves que l'échange peut s'opérer, se développer et se répercuter dans l'intégration ou pas de la démarche et de la culture philosophiques. Dans un premier temps, l'essentiel concerne l'apprentissage de l'échange démocratiquement argumenté et la participation à une communauté de réflexion au profit de la recherche de la vérité et de la réfutation des préjugés et des présupposés. Dans la classe, les élèves se trouvent à égalité d'intervention et de liberté d'expression par rapport au respect, à la tolérance, à l'ouverture au monde.
Ils découvrent que le débat argumenté ne relève pas de l'affectif, du sentiment, de l'émotion, mais de la rationalité et de la rationalisation des problèmes. C'est en ce sens que l'on peut parler d'universalisation ou de communauté de pensée. Ils découvrent la différence entre une généralisation démobilisatrice parce qu'impersonnelle et une implication responsable. La finalité de l'exposé et du débat concernent à la fois la participation et l'acquisition de connaissances, permettant un réinvestissement non seulement scolaire mais surtout éthique.