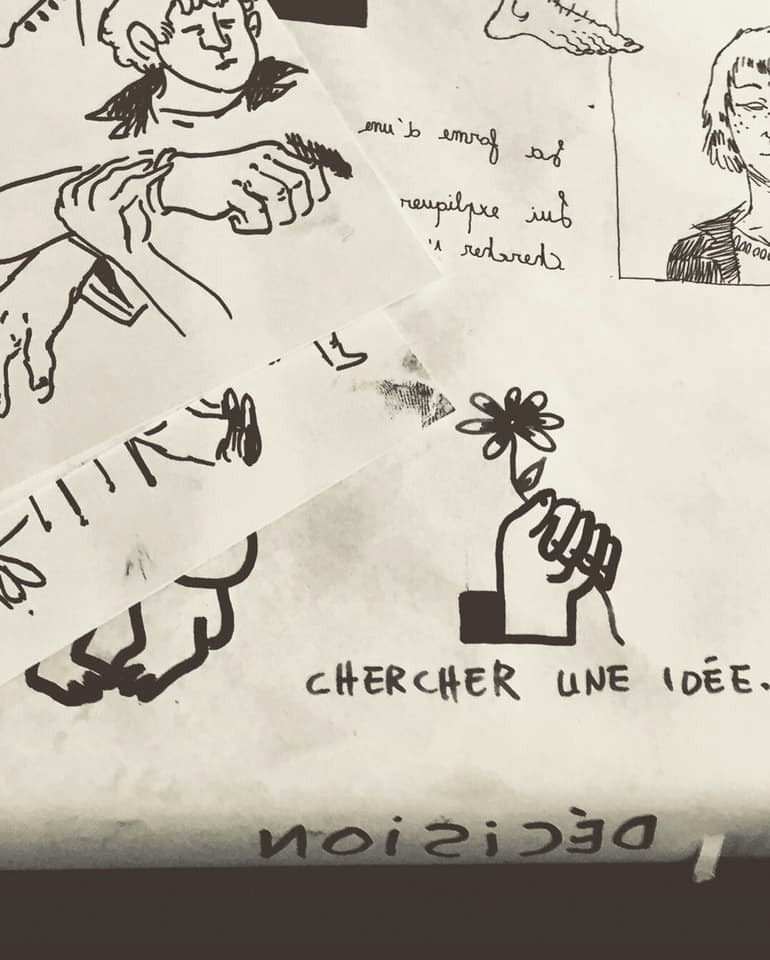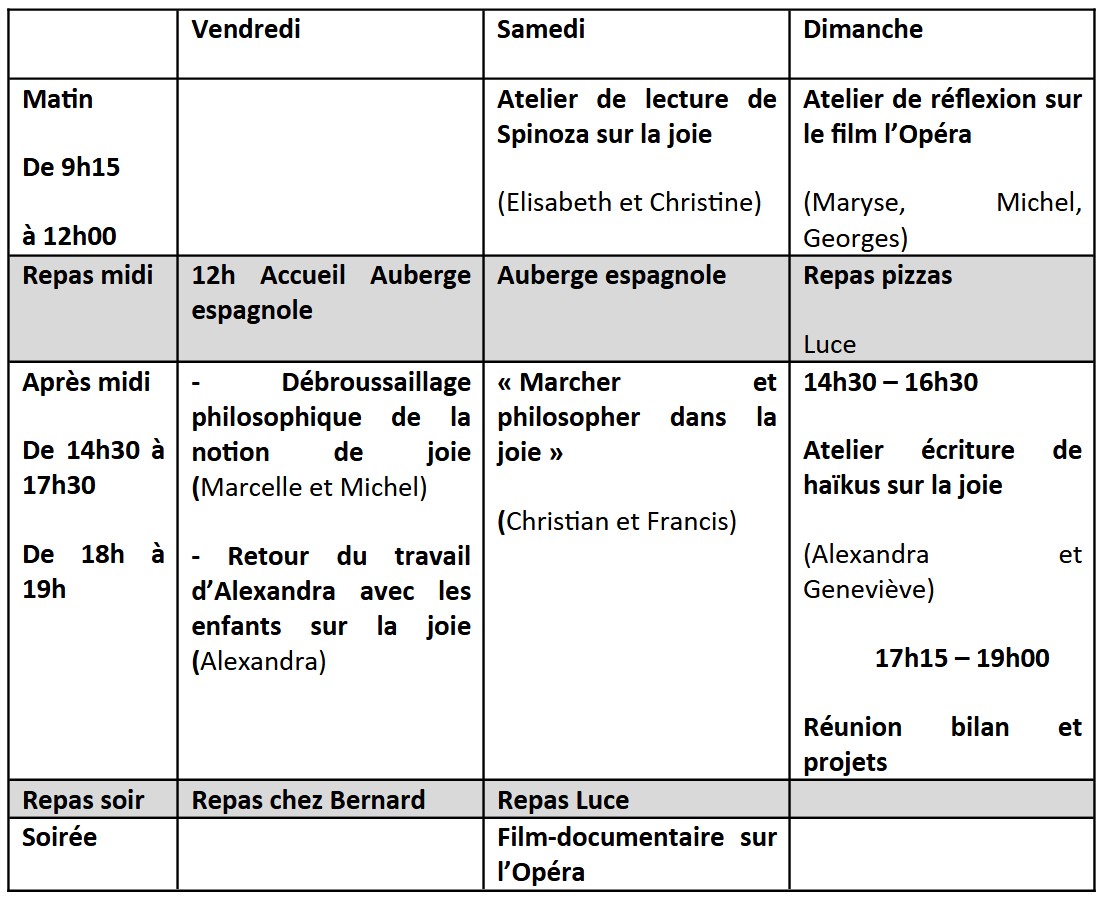Introduction
Le séminaire a pour objectif, sur un thème choisi (la joie), d’une part d’approfondir cette notion, d’autre part d’expérimenter de nouvelles pratiques philosophiques et de les analyser. Cette année, nous avons notamment expérimenté : une lecture serrée de L’éthique de Spinoza ; de la philosophie de rue lors de notre rando philo ; un atelier de haikus philosophiques.
Débroussaillage philosophique de la notion de joie (Michel et Marcelle Tozzi)
Brève introduction sur la joie (Michel) : 15’
Pourquoi s’intéresser à la joie ? Parce que c’est une émotion positive et bénéfique à l’individu. Elle présente des enjeux philosophiques dans la perspective de l’épanouissement humain, son développement personnel, sa façon d’être au monde, son équilibre, le sens de sa vie, le goût de vivre … Elle a une dimension existentielle.
Dans la démarche philosophique, il s’agit :
— théoriquement de la conceptualiser, de la définir. Ce n’est pas simple : quels sont ses attributs ? En quoi s’oppose-elle à la tristesse ? En quoi se distingue-t-elle du plaisir et du bonheur ? De la béatitude, de la félicité ? Quels sont ses rapports à la sagesse ? Comment s’articule-t-elle à d’autres notions : le désir, la liberté, la création ?
— Et pratiquement de savoir si on peut et comment la susciter, et la cultiver. Qu’est-ce qu’une « culture de la joie » ?
Plusieurs philosophes se sont intéressés à la joie, qui peuvent nous inspirer dans notre réflexion : Platon, Montaigne, Descartes… Spinoza, qui a beaucoup inspiré Rosset, Misrahi, Deleuze, Comte Sponville, Nicolas Go, Bergson)).
Epicure, dans une perspective de sagesse, disait qu’il ne fallait satisfaire que les désirs naturels et nécessaires (boire de l’eau, manger du pain, dormir sur sa paillasse) : est-ce la joie des plaisirs simples, celle de la « sobriété heureuse » chère à Pierre Rahbi ?
Descartes distingue la joie intellectuelle, qui résulte d’une activité de l’entendement, de la joie comme passion, « agréable émotion de l’âme, en laquelle consiste la jouissance d’un bien que les impressions du cerveau lui représentent comme siens ».
Sartre affirme : « La joie est une conduite magique qui tend à réaliser par incantation la possession de l’objet comme totalité instantanée ».
Certains philosophes accordent une place centrale à la joie, comme Spinoza, pour lequel elle est passage d’une moindre à une plus grande perfection ; ou Bergson, pour lequel elle est puissance créatrice de l’élan vital ; ou Epicure, qui parle plutôt de plaisir.
D’autres comme les stoïciens ne la placent pas au centre, mais la considèrent comme un effet d’une vie sage, et parlent plutôt de bonheur.
D’autres enfin, comme Schopenhauer ou Cioran, n’y voient qu’un soulagement provisoire de la souffrance, une illusion fugace et passagère.
La psychologie positive fait aujourd’hui de la joie un élément central du bien-être humain.
Définition collective de la joie en recherchant ses attributs par un tour de table (Conceptualisation). 10’
Ecrire au fur et à mesure les attributs au tableau. 5’. Nous avons trouvé :
« Etat émotionnel transitoire, furtif, contextualisé, communicatif, sentiment de plénitude opposé au manque, sentiment de toute puissance, imprévisible, qui peut nous déborder, construit, volontaire, qui demande un effort, produit un ancrage, conscient, qui donne de la légèreté, trait de personnalité (optimisme), consentement au réel, n’exclut pas la tristesse ou les difficultés, dépend de notre attention à la vie ». Certains semblent contradictoires : événement qui surgit spontanément/qui se construit…
— A partir des attributs qui vous paraissent pertinents, élaborer votre définition personnelle de la joie. Exemples :
Etat de bonne humeur qui permet d’oublier momentanément les choses qui fâchent.
Etat qui donne un sentiment de plénitude et de toute-puissance, et qui dure le temps d’un feu de joie.
Etat furtif, spontané, contextualisé, et communicatif : peut être partagé (un éclat de rire), se vit pleinement (nous submerge), et rend extrêmement présent.
Etat émotionnel transitoire, circonstanciel, spontané ou construit.
Sentiment d’être pleinement en accord avec soi-même et le monde, profondément ancré en soi.
Sentiment positif intense, euphorisant. Polymorphe, de durée, d’intensité, de cause différentes. Dans une tension permanente entre excitation et ataraxie.
Evénement spontané, sensoriel, émotionnel, affectif, intellectuel qui émerge à la surface de la conscience et … construction, cheminement quotidien pour atteindre un objectif de bonheur/joie/contentement personnel bienfaisant pour ma vie personnelle et la vie collective.
Quelles questions peut-on (se) poser à propos de la joie ? (Problématisation).
Ecrire les questions au tableau. 5’ de réflexion individuelle + 15’ tour de table. Questions :
Peut-on éprouver de la culpabilité à ne pas être joyeux ?
La joie n’empêche-t-elle pas l’empathie ?
Comment a-t-on pu éprouver de la joie en camp de concentration ?
La joie est-elle un point de départ, un but ou un passage ?
La joie est-elle possible dans un monde chaotique ?
Comment éprouver de la joie tant est grande la misère du monde ?
Peut-on articuler dans la joie spontanéité et construction ?
Y a-t-il des joies perverses ?
Etat passager ou permanent ?
Quand je dis joie, de quelle joie s’agit-il ?
Quid de la « joie » des paradis artificiels ?
La joie est-elle indispensable ?
Que serait une vie sans joie ?
Que faire de la joie des autres ?
Fille de joie ou de plaisir ?
La joie peut-elle naître de difficultés ? etc.
Formation de quatre groupes de réflexion (de 4 à 5 personnes), avec un animateur et un secrétaire ? Capital temps : consignes 10’ , échanges 45’
GR 1 : Approfondir la conceptualisation.
Quelles distinctions conceptuelles entre plaisir, joie, bonheur, sagesse ? Faire un tableau.
GR 2 : travailler le texte de Spinoza sur la joie. Et présenter le contenu au groupe.
GR 3 : travailler le texte de Bergson. Et présenter le contenu au groupe.
GR 4 : travailler le texte de Nicolas Go. Et présenter le contenu au groupe.
Présentation du travail de chaque groupe. 30’
Le travail d’Alexandra Ibanes avec les enfants en classe sur la joie
L’atelier proposé lors du séminaire est un compte rendu de plusieurs débats philo ayant été menés auprès d’enfants de CM2 et de 6ème.
Débat avec une classe de CM2
En classe un travail préparatoire sur la joie a été fait à partir d’ albums jeunesse, la chanson Ya d’la joie de Trenet en expliquant l’historique du texte, L’Hymne à la joie - 9ème symphonie de Beethoven et Le bonheur est dans le pré de Paul Fort.
Comment s’est déroulé le débat ?
Au début du débat, les élèves devaient raconter un moment de joie. Ex. un élève va chaque année dans un parc d’attraction durant plusieurs jours. Elle n’y connait aucune frustration et y vit une surstimulation de joie (héros de son enfance, jeux, consommation, repas, couleurs, musiques joyeuses, spectacles…).
Le débat commence. : « On ne peut pas toujours être joyeux, il y a des moments tristes ou difficiles dans la vie. On ne fait pas toujours ce que l’on veut ». « Quelquefois, on se focalise sur la tristesse, on ne sait pas qu’on est heureux ». « Une surprise pourra provoquer la joie. »
Comment remplir un flocon qui comporterait de la joie ?
4 axes interagissent entre eux : moments d’échanges, de communion, de sensations, de réalisations.
Une bonne nouvelle. Un cadeau. Planter des légumes (fierté et joie d’un élève en très grande difficulté scolaire). Avoir des amis et partager de bons moments. Se sentir en sécurité dans un pays en paix. La beauté des paysage. Se baigner dans la mer. Découvrir son corps en pratiquant la gym, réussir des figures difficiles pour faire un joli enchaînement. L’équitation pour se défouler et pour se sentir libre. Apprendre à faire du café pour préparer le petit déjeuner de ses parents le dimanche matin. Se surpasser en sport pour participer aux JO. Blaguer, rire. Rendre quelqu’un heureux. Progresser en travaillant. La beauté de la nature, tout le monde n’a pas notre chance de vivre dans un beau pays. Le pouvoir de la nature (coucher de soleil, arc-en-ciel, cascades, champs de fleurs, les coccinelles, les oiseaux, les plages paradisiaques…)
Toutes ces joies sont immatérielles, on ne les vit pas tout le temps.
L’argent ça va, ça vient… une montagne reste superbe. Les joies viennent naturellement et sont nécessaires (amis, liberté). C’est une émotion qui est nécessaire pour bien vivre, on n’a qu’une vie, il faut en profiter au maximum. Etre dans un état de joie mène au bonheur.
Comment rendre un moment heureux ?
Il faut faire des efforts et de l’imagination pour provoquer la joie. Partager des moments en famille. Faire une pizza au nom de la maîtresse et la manger en famille. Si on prend l’avion pendant 18 h, s’occuper en regardant les nuages (rêver) ou penser à ce que l’on fera à son arrivée (imaginer). Essayer de rendre heureux les gens tristes en transformant la réalité. Transformer quelque chose de pénible en quelque chose d’amusant. (écouter de la musique en rangeant sa chambre). Respecter les règles de communication.
Qu’est-ce qui empêche la joie ? Etre exclu d’un groupe de copains. Les conflits. Les contraintes. La maladie. Le manque de respect des différences. La frustration. Sa place dans la fratrie. Le deuil.
Débat avec les 6ème, habitués aux débats philo.
Quand je leur annonce le débat sur la joie, un élève me parle d’une émission de téléréalité LOL. Dans une maison, 20 candidats sont enfermés et ont 24 heures pour faire rire leurs adversaires. Si le candidat rit deux fois, il est éliminé, s’il ne rit pas, un stress intense s’installe. Rire devient une faiblesse, les candidats sont dans un état régressif pour déstabiliser la partie adverse, ils utilisent des déguisements, des danses, des chansons ridicules, ils disent des blagues « carambar », ils transforment leurs voix à l’hélium… A la cantine, les collégiens établissent les mêmes règles du jeu. Mais ces rires sont-ils vraiment synonymes de joie ?
Le rire et la joie
On aime rire, on aime la joie mais on a l’impression qu’il faut que la vie soit toujours drôle. Ce n’est pas le cas. La joie de vivre donne de l’énergie. Et rire libère quand on a des moments difficiles. On ne rit pas des mêmes choses, on est différent. Mais le rire crée une complicité car les cerveaux se connectent. Et rire n’est pas forcément la joie car certaines choses ne sont pas drôles : chute, moqueries, harcèlement, sujets difficiles (racisme, handicap, guerres). Quelquefois rire permet d’oublier les difficultés de la vie. Mais ce n’est pas de la joie, on sait qu’au fond, ce qui nous amuse est très grave.
Vivre sans rire peut être déprimant. On est toujours en bas. Il faut trouver un juste milieu. Si on met trop de nutella sur une tartine, c’est écoeurant, ce n’est plus bon. Rire n’est pas la seule forme de joie, une personne qui ne rit pas peut avoir une joie intérieure . Nous avons tous des émotions, nous ne sommes pas des robots.
La joie, c’est réussir sa vie
Pour être heureux, il faut avoir un but dans sa vie, le bonheur il faut se le créer. On est en France, on a beaucoup de chance car nous avons des protections sociales, des associations caritatives, des droits au chômage. On peut être très riche et n’avoir aucun but dans sa vie car on n’a jamais fait aucun effort pour obtenir ce que l’on veut. On a de faux amis qui sont des opportunistes. Tu te lasses de tout car tu as tout . L’argent crée du besoin. Tu ne parles pas avec de l’argent, tu es seul. Il te manque l’essentiel, l’humain. Quand on a tout, on s’ennuie car on possède même ce dont on n’a pas besoin. On n’a plus de désir, on n’est jamais satisfait donc on n’est pas heureux. Sans but , aucun bonheur. Si tu es seul dans ta piscine, tu ne t’amuses pas. La joie c’est peut-être accomplir ses rêves.
La pensée et la joie
Réfléchir rend heureux. Quand on réfléchit lors d’un débat philo, on dit ce qu’on a au plus profond de nos pensées. Ça donne du bonheur à nos vies. Débattre évite de faire des bêtises, ça nous permet de franchir des obstacles. Nos cerveaux sont élastiques qui contiennent des milliers d’informations qui nous apportent de la joie. Si on ne réfléchit pas, on est en difficulté face aux dilemmes moraux qu’on pourrait avoir. Il faut que nos cerveaux nous aident à anticiper les difficultés de la vie. Quand on réussit, on est fier, on se dépasse toujours à ce qu’on était cinq minutes avant. Tout ça procure de la joie. Réfléchir permet la confiance en soi et procure de la joie.
Si nous avions un cerveau vide ?
On nait avec un cerveau vide. Au fil du temps, on comprend ce qu’on peut faire ou pas. Nos parents, notre famille, nos amis nous accompagnent . On retient ce qui est important pour nous. Il y a aussi l’imitation. Le vocabulaire, on le retient grâce à notre cerveau. Pour se déplacer au départ, on est à quatre pattes, on essaie, on tombe, on recommence, ça devient un automatisme. C’est l’expérience de la vie qui commence. Quand on réussit, quelle joie. A chaque âge, on a donc des joies différentes. Après on évolue grâce aux autres. Importance de l’altérité. En découvrant de nouvelles choses , on se découvre nous (goûts, passions, envies). L’intelligence peut apporter du contentement car on comprend un texte difficile, un théorème… la joie, c’est différent, c’est en rapport avec des qualités qui nous caractérisent. Les débats philo apportent de la joie car on apprend à s’écouter, à se respecter, à apprendre des uns des autres, à nous donner confiance, à se comprendre, à se poser des questions.
Oser frôler Spinoza : la joie en textes et en imagination
Christine Marchal et Elisabeth Golinvaux — avec les puissances d’agir de Françoise Sureau, Michel Kalansky et Daniel Lapon.
Cet atelier est le fruit d’une lecture collective, hebdomadaire, en ligne. Elle a permis à un groupe de « non spécialistes » d’aborder l’Ethique. A la date de nos rencontres, nous étions parvenus à la proposition 27 du livre 3 avec des incursions, déjà, pour certain.e.s, dans les livres 4 et 5.
AVANT-PROPOS
Accueil et structure de l’atelier (Elisabeth)
Lecture du début de l’introduction du Traité de L’Amendement de l’Intellect (Christine)
INTRODUCTION
Spinoza : un homme, une vie – raconté (Françoise). Le monde de Bento – raconté (Elisabeth)
Une substance-Dieu-la N/nature. Une infinité d’attributs qui expriment l’essence de la substance Dieu-la Nature. L’étendue et la pensée. Une infinité de modes. Tout est cause et tout est causé. L’homme, un corps et un esprit (mens).
SE FROTTER AUX TEXTES
Mise en commun
IMAGINER
L’imagination selon Bento racontée… (avec support des textes du point 4) et une expérience de pensée – La jalousie
Consignes
Courte Imagination active guidée
« Rendre compte » des RESSENTIS visuels, auditifs et kinesthésiques de 2 ou 3 volontaires avec une attention à une DESCRIPTION stricte, sans interprétation et les mots les plus précis possibles
Reprise avec mise en lumière de la fonction de l’imagination dans la production des affects – qui sont PASSIFS dès lors que la fonction imaginative n’est pas mise en œuvre consciemment. 30’
RETOUR sur le parcours
Choix d’un des trois axes de retour suivants, mise par écrit puis partage :
Forme et caractère de ma participation – écoute/prise de parole/conceptualisation/problématisation/argumentation – et point(s) sur le(s)quel(s) je souhaite concentrer mon attention dans les prochains ateliers
Ouverture(s), questionnement(s), fissuration(s) de certitude(s)… éprouvé(s) par l’exploration de la pensée de Spinoza
Forme et qualité du dispositif par rapport à un critère précis.
Les gestes
Les gestes posés par les groupes, pour aborder les textes, ont été très différents.
Le premier groupe s’est beaucoup appuyé sur les définitions de concepts spinozistes travaillés avec l’une des animatrices pour approcher la compréhension des textes. Il a tenté de mettre au jour et de formuler les questions suscitées par eux – « qu’est-ce que cela me fait ? » en s’appuyant sur la recherche d’exemples et des témoignages. Il semble avoir travaillé par association d’idées au fil des concepts rencontrés.
Les membres du second groupe ont pris chaque texte un par un, ont essayé de se confronter à la notion qui était dégagée et tenté de voir si une question s’imposait ou pas. Par contre, ils/elles n’ont pas travaillé le lien avec la joie (dans le temps imparti, ils/elles n’auraient pu y parvenir puisque la notion de joie se découvre presqu’en fin de parcours).
Le troisième groupe, quant à lui, semble avoir essentiellement abordé ce qui lui apparaissait comme des manques ou des fragilités de la pensée spinoziste en mettant à jour l’apparente contradiction de la vision proposée et les moyens de la dire et en proposant à l’auteur des notions – du 20ème siècle, qui auraient pu « l’aider » dans ses recherches ; qu’il n’aurait néanmoins pu connaître.
Quelques lieux de questions et de réflexion
Voici, sans ordre préétabli et tous groupes confondus, quelques questions et lieux d’examen proposés et abordés (retranscrits de façon plus ou moins explicite en fonction de leur retransmission) :
La stricte égalité et l’unité entre le corps et l’esprit
Le lien entre joie et cause adéquate
Le lien entre colère et tristesse
Peut-on dégager une positivité d’affects qui dépendent de la tristesse ?
Examen de la peur comme affect passif et comme affect actif et questionnement de la perception claire et distincte de son effet en tant qu’elle est affect actif (et nous fait donc agir)
La colère diminue-t-elle ou augmente-t-elle ma puissance d’agir et dans quelles conditions ?
Faut-il nécessairement augmenter sa puissance d’agir ?
Passivité et activité peuvent-ils se vivre de façon concomitante ?
Que signifie les notions de reliance et d’unité avec ce qui est ? A quelles expériences renvoient-elles ? Quels liens ont-elles avec le bonheur ? (Témoignage)
La vie est-elle l’ensemble des forces qui s’opposent à la mort ?
Comment concevoir, tout à la fois, la persévérance dans l’être et le suicide ?
Spinoza dépasse-t-il l’opposition classique entre idéalisme et réalisme ?
Comment peut-on être actif et passif en même temps ?
Est-ce que le désir serait la conscience de cet effort de persévérer dans son être ?
Spinoza a créé un système où il affirme, mais où sont passés le doute et les nuances ? Quelle place y a-t-il pour eux ?
Comment échapper au dogmatisme dans un système qui apparaît comme une succession d’affirmations ? La notion même de système, en tant qu’il veut tout comprendre et tout expliquer, n’est-elle pas enfermante et un peu vaine ? Que fait-on du principe de raison limité mis en lumière par la modernité ?
La création d’un système traduit-il une puissance d’agir ?
Spinoza a essayé de penser le monisme malgré la grande difficulté à le dire avec un système de pensée et d’expression qui est éminemment dualiste.
La théorie systémique, avec, notamment, les boucles de rétroaction et la causalité complexe aurait pu aider l’auteur à penser sa vision ; la notion d’information permettrait sans doute de « parler moniste ».
Les théories de l’inconscient questionnent le fondement de la perception claire et distincte comme fondement de l’agir.
Lire un auteur est-il « tout sauver » de lui ? Ne se trouve-t-on pas, alors, dans une position de révérence dogmatisante ?
C’est peut-être par l’idée très singulière de la joie qu’il développe que Spinoza peut nous être utile.
Spinoza peut être perçu comme matérialiste en ce sens qu’il considérerait que tout l’univers fonctionne avec les mêmes règles ; ce qui lui permettrait de faire système. Mais, dans nos connaissances actuelles, il n’y a pas un système mais plusieurs systèmes que nous ne savons pas relier.
Les sentiments sont complexes et ambivalents ; Spinoza le met-il en lumière ?
Y a-t-il une position frontale entre les conceptions du désir comme manque (Platon, repris par la psychanalyse) et celle de Spinoza ?
Quelques retours sur le parcours
— Par rapport à ma position/participation :
En quoi suis-je philosophe ? Quelle est ma légitimité dans ce travail ? Je comprends que, pour moi, philosopher c’est partir de mon expérience de vie et aller chercher des réponses chez les autres et chez les philosophes.
Les explications très claires ont fait sauter en moi des verrous.
— Par rapport à ma lecture de Spinoza :
J’ai pu rencontrer Spinoza
Je me vis imperméable à la langue de Spinoza (cela ne remet pas en question le dispositif)
En quoi le système est-il forcément enfermant ? Comment, d’un système, faire quelque chose qui ouvre ? N’avons-nous pas là une part active ?
Qu’est-ce qu’être lecteur collectif d’un texte ? Comment se colle-t-on, se frotte-t-on au texte ? Comment le frôle-t-on ? Comment construit-on une compréhension collective ? Y a -t-il une vérité du texte ou n’y a-t-il que des interprétations ? Quelles différences y a-t-il entre un groupe de lecture en présentiel et un groupe de lecture en distanciel ?
Le vécu d’une personne expliquerait-elle sa psychologie et le système dans lequel il s’inscrit et/ou qu’il construit ? Le système de Spinoza serait-il un contenant rassurant et protecteur pour son auteur ?
— Par rapport au dispositif proposé :
Ce dispositif est très complémentaire du premier de notre séminaire. Celui-ci est parti de nos représentations de la joie pour en élaborer une définition qui a ensuite été confrontée à celles de philosophes. Ici, l’on a d’abord rencontré Spinoza et l’on a tenté de comprendre comment son système nous amène au concept de la joie.
L’on ne peut, en effet, comprendre le concept sans comprendre un peu la philosophie du philosophe ; c’est son approche qui nous permet de voir comment il est configuré. C’est d’autant plus important pour Spinoza que son concept de joie est très particulier.
L’appel aux définitions des concepts a été d’une aide précieuse (une animatrice remplissait cette fonction de support en passant de groupe en groupe).
Le travail en groupe était jubilatoire.
Grande qualité d’échange dans les groupes.
Le dispositif était trop ambitieux par rapport au temps dont nous disposions ; un participant a exprimé sa frustration de ne pas avoir vécu l’expérience de pensée initialement prévue dans l’étape 4.
Nous, animatrices, avons assisté à la construction spontanée de l’expérience de pensée au départ des témoignages – et de leur questionnement de deux participant.e.s ; elle a porté sur l’affect de la peur (qui avait été particulièrement discuté). Néanmoins, sa reprise consciente et sa mise en lien avec les textes proposés n’a pu se faire dans les limites du temps de l’atelier.
LES TEXTES PROPOSES
AVANT-PROPOS
« Après que l’Expérience m’eut enseigné que tout ce qui se présente fréquemment dans la vie ordinaire est vain et futile, voyant que tout ce dont j’avais peur et tout ce qui me faisait avoir peur n’avait en soi rien de bon ni de mauvais, sinon en tant que l’âme en était mue, je résolus enfin de rechercher s’il y aurait quelque chose qui fût un bien vrai, et qui pût se partager, et qui, une fois rejeté tout le reste, affectât l’âme tout seul ; bien plus, s’il y aurait quelque chose qui fût tel que, une fois cela découvert et acquis, je jouisse d’une joie continuelle et suprême pour l’éternité. »
Spinoza, Traité de l’amendement de l’intellect, trad. B. Pautrat, Paris, Alia 1999, p. 17.
SE FROTTER AUX TEXTES (Extraits de Spinoza).
-
« … nous avons montré que l’idée du corps et le corps, c’est-à-dire l’esprit et le corps (…) sont un seul et même individu, que l’on conçoit tantôt sous l’attribut de la pensée, tantôt sous celui de l’étendue. » Éthique, 2p21s.
-
« Je dis que nous agissons lorsqu’il arrive quelque chose, en nous ou hors de nous, dont nous sommes cause adéquate, c’est-à-dire lorsque suit de notre nature, en nous ou hors de nous, quelque chose qu’elle permet à elle seule de comprendre clairement et distinctement (…). Et au contraire, je dis que nous pâtissons lorsqu’il arrive quelque chose en nous ou hors de nous, ou que quelque chose suit de notre nature dont nous ne sommes, nous, la cause que partielle » Éthique, 3d2.
-
« Par affects, j’entends les affections du corps par lesquelles la puissance d’agir du corps est augmentée ou diminuée, aidée ou contrariée, et en même temps les idées de ces affections. » Éthique, 3d3.
-
« Abstraction faite du reste chaque chose s’efforce de persévérer dans son être. »
« L’effort (conatus) par lequel chaque chose s’efforce de persévérer dans son être n’est rien à part l’essence actuelle de cette chose. » Éthique, 3p7.
« Cet effort, quand on le rapporte seulement à l’esprit, on l’appelle volonté ; mais quand on le rapporte à la fois à l’esprit et au corps, on le nomme aspiration (appétit), laquelle n’est donc rien donc que l’essence de l’homme, dont la nature est telle qu’en suivent nécessairement les choses qui servent à sa conservation, si bien que l’homme est déterminé à les accomplir. De plus, entre l’aspiration et le désir, il n’y a aucune différence sinon qu’on rapporte généralement le désir aux hommes en tant qu’ils sont conscientsi de leurs aspirations. On peut de fait le définir comme suit : le désir est l’aspiration avec la conscience d’elle-même. » Éthique, 3p9s. -
« Tout ce qui augmente ou diminue, aide ou contrarie la puissance d’agir de notre corps, l’idée de cette chose augmente ou diminue, aide ou contraire la puissance de penser de notre esprit. » Éthique, 3p11.
« C’est pourquoi, nous le voyons, l’esprit peut pâtir de grands changements et passer parfois à une plus grande, parfois à une moindre perfection. C’est pourquoi par joie, j’entendrai dans la suite une passion par laquelle l’esprit passe à une perfection plus grande ; par tristesse, au contraire, une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. » Éthique, 3p11s. -
« (…) l’amour n’est rien d’autre que la joie qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure ; et la haine, rien d’autre que la tristesse qu’accompagne l’idée d’une cause extérieure. » Éthique, 3p13s.
-
« A part la joie et le désir qui sont des passions, il y a d’autres affects de joie et de désir qui se rapportent à nous en tant que nous agissons. » Éthique, 3p58.
« Parmi tous les affects qui se rapportent à l’esprit en tant qu’il agit, il n’y en a pas qui ne se rapportent à la joie ou au désir. » Éthique, 3p59.
IMAGINER
-
« L’idée d’un mode quelconque dont le corps humain est affecté par les corps extérieurs doit envelopper à la fois la nature du corps humain et la nature du corps extérieur. » Éthique, 2p16.
« Il suit (…) que les idées que nous avons des corps extérieurs indiquent plutôt la constitution de notre corps que la nature des corps extérieurs (…). » Éthique, 2p16c. -
« Et donc, pour conserver les mots courants, nous appellerons images des choses les affections du corps humain dont les idées nous représentent les corps extérieurs comme nous étant présents, même si elles ne reproduisent pas les figures des choses.
Et ici, pour commencer à indiquer ce qu’est l’erreur, je voudrais vous faire observer que les imaginations de l’esprit, regardées en elles-mêmes, ne contiennent aucune erreur, autrement dit que l’esprit ne fait pas erreur parce qu’il imagine, mais seulement en tant qu’on le considère manquer d’une idée qui exclut l’existence des choses comme lui étant présentes. Car si l’esprit, pendant qu’il imagine des choses qui n’existent pas comme lui étant présentes, savait en même temps que ces choses en réalité n’existent pas, il attribuerait cette puissance d’imaginer, à coup sûr, à une vertu de sa nature, et non à un vice ; surtout si cette faculté d’imaginer dépendait de sa seule nature, c’est-à-dire (…) si cette faculté d’imaginer de l’esprit était libre. » Éthique, 2p17s. -
« J’appelle ici une chose passée ou future, en tant que nous avons été affectés par elle ou que nous le serons. Par exemple, en tant que nous l’avons vue ou que nous la verrons, qu’elle nous a restaurés ou qu’elle nous restaurera, qu’elle nous a blessés ou qu’elle nous blessera, etc. En effet, en tant que nous l’imaginons ainsi, nous affirmons son existence ; c’est-à-dire que le corps n’est affecté d’aucun affect qui exclut l’existence de la chose. Et partant, le corps est affecté par l’image de cette chose selon le même mode que si la chose même était présente (…). » Éthique, 3p18s1.
Philosopher dans la rue (Atelier Rando-Philo Sorèze 2024)
Francis TOLMER et Christian BELBEZE
« Mini café-philos de rue »
Questionnement
Le risque des rencontres philosophiques nous est toujours apparu comme étant celui de la création d’un entre-soi. Les raisons de cette situation sont nombreuses, elles peuvent aller de la présence du mot philosophie, qui peut effrayer à une disponibilité nécessaire trop rare de se couper du monde plusieurs jours afin de participer à un séminaire philosophique. La rando-philo oblige à sortir mais place le groupe uniquement dans un paysage. Afin d’essayer de planter la philosophie et notre groupe dans un territoire et non plus uniquement dans le paysage, nous avons imaginé une rando-philo qui intègrera les populations locales.
Cette rando-philo a donc comme but d’aller à la rencontre de « ceux qui sont là ». Nous allons interroger et partager philosophiquement avec ceux du territoire, sur la joie, le sujet de cette année. Ce type d’exercice est pratiqué depuis l’Antiquité. Que cela soit de manière provocatrice en portant des gants de boxe comme le faisait Diogène de Sinope, ou encore généreuse comme Epicure qui ouvrait son jardin et ses échanges aux passants. Aujourd’hui des philosophes comme Laurent Ott pratiquent régulièrement ce type d’atelier appelés ateliers de rue ou de bas d’immeuble.
Le Dispositif
Les étapes du dispositif de l’atelier ont été les suivantes :
Explications sur l’atelier en grand groupe.
Distribution d’un badge « Séminaire Philo » permettant de rassurer par un coté informatif le public interrogé.
Création de groupes de deux à cinq personnes.
Choix d’un lieu par le groupe permettant la rencontre : centre-ville, bord de lac aménagée, musée …. Le lieu peut être amené à changer durant la rando.
Le groupe doit dans un premier temps élaborer des questions, puis aller ensuite les poser et s’entretenir avec les personnes rencontrées durant la rando.
Une fiche est distribuée pour aider les groupes à créer ses questions.
Suggestion de déroulement :
Courte intro de présentation de la démarche : « Nous faisons des rencontres philo sur le thème de la joie, on voudrait partager avec vous pendant 2 minutes ».
Demander aux « participants de rue » des éléments d’expérience par rapport à la joie. Ex : Quelle est / a été votre plus grande joie ? Qu’est-ce qui vous donne de la joie dans la vie ?
Proposez une problématisation, ou une citation qui propose un autre angle, ou encore posez une question : (Pour une citation) Comment comprenez-vous cette citation ? Etes-vous plutôt d’accord / pas d’accord ? Pourquoi ?
Cherchez à obtenir des réponses argumentées.
Une liste de citations est aussi proposée pour engager le dialogue :
Le régime de la joie est celui du tout ou rien : il n’est de joie que totale ou nulle (Clément Rosset).
Espérer, c’est être heureux (Alain).
On appelle bonheur un concours de circonstances qui permettent la joie. Mais on appelle joie cet état de l’être qui n’a besoin de rien pour se sentir heureux ( André Gide).
Conquérir sa joie vaut mieux que s’abandonner à la tristesse (André Gide).
Ce qu’on appelle la joie de vivre, enfantine et pure, n’est qu’une joie animale (Anton Tchekhov).
La joie, c’est la capacité à accroître son potentiel, sa puissance, ses talents. Et la joie nous envahit quand on est capable de se développer, de développer sa compétence au contact d’une pratique (Charles Pépin).
La joie est en tout ; il faut savoir l’extraire (Confucius).
Nous devons tendre vers la joie, le bonheur, la paix et le contentement. Notre capacité à atteindre cet objectif dépend bien plus de notre état d’esprit que de considérations matérielles telles que l’argent ou le pouvoir (Le Dalaï Lama).
L’homme aime compter ses malheurs, mais il ne compte pas ses joies. S’il le faisait, il se rendrait compte que pour chaque souci, il reçoit beaucoup plus de joie (Fedor Dostoievski ).
La joie annonce toujours que la vie a réussi, qu’elle a gagné du terrain, qu’elle a remporté une victoire : toute grande joie a un accent triomphal (Henri Bergson).
Fais n’importe quoi, mais tires-en de la joie (Henry Miller).
Une seule joie, et le monde vaut encore la peine (Jean Giono).
Telle est la vie des hommes. Quelques joies, très vite effacées par d’inoubliables chagrins. Il n’est pas nécessaire de le dire aux enfants (Marcel Pagnol).
La joie n’est pas dans les choses, elle est en nous (Richard Wagner).
Il n’y a pas de plus grande joie que de réjouir un autre être (André Gide).
La joie est dans la plénitude du réel (Simone Weil).
Il n’y a pas de plus grande joie que celle qu’on n’attend pas (Sophocle).
Si vous voulez que la vie vous sourit, apportez-lui d’abord votre bonne humeur (Baruch Spinoza).
Il faut travailler et faire ce que l’on peut, et pour le reste, tout prendre avec légèreté et bonne humeur. On ne se rend pas la vie meilleure en étant amer (Rosa Luxembourg).
Le groupe se déplace pour rencontrer et interroger des personnes
Retour en grand groupe ou chaque groupe relate son expérience, les propos échangés et les interrogations philosophiques générées par l’expérience.
Durant l’atelier
Au départ, la plus grande difficulté que semblait poser la réalisation de l’atelier, soulevée par plusieurs, était le questionnement de personnes inconnues. A la proposition faite par un des animateurs d’aller interroger les joueurs de boules de la place du village, un participant répondra (certes avec humour) : « Ils vont nous les mettre dans la figure leurs boules, oui !». L’animateur, afin d’essayer de galvaniser les participants, les a présentés en chasseurs chargés de récupérer de la nourriture philosophique. Les chasseurs inquiets, le dos courbé, grognant des menaces contre les organisateurs, sont néanmoins partis pour leur quête.
Durant l’atelier, les groupes ont été dans des lieux différents, parfois plusieurs lieux pour un même groupe. Certains groupes se scindant en plusieurs petits groupes vers des lieux différents. Ainsi la météo très chaude poussera un sous-groupe vers un musée climatisé.
Un retour des groupes surprenant
Autant le départ était funeste, autant le retour des petits groupes fut glorieux. Chacun ayant vécu une expérience différente, intéressante à divers titres. Nous retrouvons là, ce que Laurent Ott souligne quand il dit : “Chez nous, il n’y a pas de programme … parce qu’il se passe toujours quelque chose” CRDE [Centre de ressources en éducation de l’enfance], 2021, t. 48:25).
En grand groupe
Nous devons bien l’avouer, les paroles entendues et ramenées par les chasseurs de pensées philosophiques étaient parfois un maigre butin. Les participants de l’atelier se sont d’avantage interrogés sur les modalités de l’atelier. Ils ont été particulièrement surpris d’avoir pu ouvrir sans trop de difficulté un dialogue avec des passants. Certains essayerons même de tirer quelques règles sur le comment créer cet espace capable d’accueillir un débat philo dans la rue avec des inconnus.
L’analyse des situations a aussi été un objet d’interrogation. Ainsi la mariée déclarant devant l’église que « Aujourd’hui, c’est un jour où il faut se réjouir » amènera les participants à se questionner sur les obligations sociales de la réjouissance en ce jour particulier du mariage et plus généralement dans nos représentations et rites, mais aussi sur les circonstances favorisant la naissance d’une discussion.
Pour nous cet atelier pose deux questions :
comment nous projeter en demandeur ou questionneur ; et comment favoriser la naissance d’une discussion à teneur philosophique dans des conditions d’improvisation totale. Il nous semble que le sujet mérite d’être approfondi ! Mais c’est là une autre question que celle de la joie qui nous a occupés en cet après-midi de juillet 2024 à Sorèze et que nous avons essayé de partager avec tout un territoire.
Sources
CRDE [Centre de ressources en éducation de l’enfance]. (2021, 23 septembre). Pédagogie sociale : Jouer les proximités contre la distanciation : (Par L. Ott & ESEDE) [Vidéo]. Youtube. Consulté le 15 mai 2024, à l’adresse https://www.youtube.com/watch?v=wYbWxpAuZSg
Ciné philo sur le documentaire L’opéra
Maryse et Michel Khalanski
Présentation du film (Maryse)
Le film choisi par Gunter, projeté le samedi soir, est un documentaire franco-suisse, sorti en 2017, intitulé L’Opéra. Pendant plus d’une année (2015-2016) le réalisateur J-S. Bron a filmé le travail derrière le rideau des différents métiers dans les deux salles de L’Opéra de Paris, à Bastille et au Palais Garnier. Dans cette mosaïque de séquences d’un travail personnel et collectif avec des épisodes conflictuels, le réalisateur a filmé des moments de joie plus ou moins intense.
L’atelier du dimanche matin a débuté par une introduction (Georges et Michel K. et lecture d’un courriel de Gunter) sur trois thèmes.
- L’évolution du travail humain. A l’ère industrielle, le travail est passé de la production d’une œuvre artisanale à la surproduction de marchandises et dans notre société post-industrielle à la perte de sens du travail. Références à Marx, Arendt, Graeber. La dépréciation du travail des artistes est vue comme un aspect de cette évolution générale. Référence à Heidegger.
- La contradiction du statut attribué au travail dans la vie humaine. Est-ce une source de souffrance, de servitude ou d’épanouissement ? Homo sapiens a aussi été nommé Homo faber, il y a dans la nature humaine une pulsion laborieuse associée au plaisir de faire un objet dont la valeur est reconnue par le groupe auquel il appartient. Pour Marx, le travail est l’essence de l’homme, ce qui pose problème c’est la forme qu’il a pris dans le capitalisme.
- Réflexions de Comte-Sponville sur la joie au travail. Il compare trois théories du bonheur dans lesquelles la joie est considérée comme une manifestation du bonheur au travail. Selon Platon, le bonheur est impossible à atteindre parce que la possession de l’objet que nous désirons abolit le désir, c’est-à-dire la condition même du bonheur. Schopenhauer part du même présupposé, mais il considère que la satisfaction du manque conduit à l’ennui : « toute notre vie oscille comme un pendule, de droite à gauche, de la souffrance à l’ennui. » Pour Spinoza, en revanche, le désir n’est pas seulement manque, il est surtout puissance de jouir et jouissance en puissance ; quand il n’y a plus de manque il reste la joie. Comte-Sponville conclut que « la fonction managériale a pour but de créer dans l’entreprise les conditions telles que les travailleurs viennent travailler pour le salaire chez Platon en vivant des moments de joie chez Spinoza plutôt qu’à s’ennuyer chez Schopenhauer. »
Le dispositif
Des groupes de 3 personnes tirent au hasard une enveloppe contenant le nom d’une des six catégories fonctionnelles présentées dans le film :
Fonction de direction. Le directeur de l’Opéra et son adjoint.
Fonctions administratives. Les agents administratifs.
Fonctions supports des spectacles. Décorateur, Perruquier, maquilleuse, agents d’entretien.
Direction des spectacles. Chef d’orchestre, chef de chœur, metteur en scène, régisseuse de scène.
Les artistes. Le jeune baryton russe, le ténor remplaçant, la danseuse étoile et son assistante.
Le mécénat. La mécène et les enfants de quartier populaires initiés à la musique classique à l’Opéra.
Chaque groupe développe une discussion à visée philosophique sur les questions suivantes :
Si vous occupiez cette fonction à l’Opéra, argumentez pourquoi vous auriez de la joie dans votre travail.
La joie éprouvée dans le travail est-elle un élément important, voire décisif, de motivation des travailleurs de l’Opéra ?
Quelques remarques faites lors de la restitution de l’atelier.
La trajectoire de Micha, un chanteur russe débutant, montre que la joie est multifactorielle. Elle passe par des apprentissages techniques et linguistiques, par le bien-être de l’artiste dans son travail, par la bonne entente avec les collègues, de bons rapports avec la hiérarchie.
La joie se manifeste différemment dans les deux types d’activité : la création dans la phase d’élaboration du spectacle et le résultat dans le succès du spectacle auprès du public. Mais c’est dans la création que la joie s’exprime le mieux.
Les agents administratifs sont peu nombreux dans le film. Leur joie n’est pas évidente. On remarque en revanche l’importance de leur fonction qui ne se borne pas à répondre au téléphone, ils peuvent obtenir rapidement un résultat décisif pour le spectacle comme trouver dans l’urgence un artiste disponible et compétent pour remplacer un chanteur défaillant, ils ont de fait un réel pouvoir.
Enfin, un point de vue critique a été exprimé sur le film, jugé trop centré sur une création élitiste visant l’excellence, valorisant la fonction hiérarchique et la division du travail plutôt que la coopération.
Question finale posée à l’ensemble des participants :
Auriez-vous aimé travailler à l’Opéra et quel métier auriez-vous aimé exercer à l’Opéra ?
La plupart des réponses portent sur les métiers artistiques : danse, chant, mises en scène… Deux participants évoquent des postes de décision (ministre de la culture et directeur de l’opéra). Un participant a plutôt été incité à être spectateur car c’est une fonction dont dépend toutes les autres.
Atelier philosophique sur l’écriture de Haikus (Geneviève LETELLIER, Alexandra IBANES)
Michel T. : pour moi, la question soulevée, après expérimentation de haikus dans l’atelier, est de savoir si le haiku peut être un genre d’écriture philosophique. Première réaction : le haiku cherchant, dans la tradition japonaise, à fixer une sensation spontanée présente immédiate, il ne serait guère approprié à une pensée philosophique, qui n’est pas de l’ordre de la sensation et suppose du temps pour s’élaborer… Le haiku peut faire penser, mais il ne pense pas. Comme forme d’écriture courte, l’aphorisme, effectivement utilisé par des philosophes occidentaux, me semble plus porteur…
Le déroulé
Un peu d’Histoire, le Haïku et son origine au Japon : Le haïku est né au Japon dans le courant du XVIIème siècle. Ce serait le maître japonais Bashô Matsuo qui en serait le père. Le mot même de haïku a été imaginé au XIXème siècle à partir de la contraction de deux autres mots : haïkaï (amusement) et hokku (désignant la première strophe de 5/7/5 mores (Unité prosodique inférieure à la syllabe, qui est susceptible de recevoir l’accent ou le ton.) d’un renga – autre genre de la poésie japonaise).
Les critères requis pour composer un Haïku
Pour la forme, il sera question de composer un poème en trois lignes. Nous retiendrons ici le nombre de syllabes/mores (5/7/5) à comptabiliser pour l’écriture du Haïku. Nous nous appuierons sur deux piliers : le kigo et le kireji.
Par kireji, nous entendons une « césure », permettant de faire une pause dans la lecture du haïku qui peut se retrouver sous la forme d’un simple tiret. Quant au kijo, c’est un mot de « saison », plaçant ainsi le haïku dans la réalité de l’auteur, il s’agit là du fond, du thème principal du poème.
En effet, de quoi s’inspire le Haïku ? Les poètes de haïku font appel aux saisons, à la nature, tels que l’infiniment petit (insectes, fleurs, pétales), les arbres et les feuilles, les pierres, les montagnes et les étendues d’eau (lac, mer, ruisseau, rivières, etc.), un animal, les éléments naturels (vent, terre, feu…), un émerveillement au monde, l’éphémère, l’instant présent. Les auteurs jouent sur la description de leurs sens : ouïe, goût, odorat, toucher et vue. User des cinq sens permet à l’auteur de renforcer les sentiments, les émotions et les images qui sont proposés et ressentis. Il est conseillé d’utiliser un seul verbe conjugué au temps du présent du mode Indicatif. Cela souligne l’effet d’immédiateté requise dans un Haïku. Sous cette forme courte et saisissante, le poète va à l’essentiel, c’est une sensation de l’instant.
Le haïku autorise une certaine liberté de ton. L’élégance et le raffinement sont souvent de mise, mais l‘on peut aussi se laisser aller à un peu de fantaisie et d’humour. Le haïku n’est pas chargé en ponctuation, celle-ci donne la respiration du texte. Il faut retenir que le haïku est un texte lu mais surtout énoncé, narré à l’oral ! Il se termine par une fin intrigante, une note surprenante qui donnera de la force au poème et laissera une impression efficace, éloquente, à celui qui l’écoute, le lit ou le clame.
Atelier individuel d’écriture
Après l’exposition des critères indispensables pour la composition de Haïkus, nous avons donné une heure de liberté au groupe, pour la création des poèmes sur le Thème de la Joie ou de haïkus joyeux.
Il était possible soit de créer seuls, soit de se mettre en binôme. Précisons que chacun a choisi de produire de façon individuelle. Chaque membre du groupe s’est isolé et a profité du lieu bucolique et champêtre du Moulin du Chapitre pour s’éloigner ou non de notre rassemblement. La liberté résidait également à concevoir un à plusieurs haïkus selon les dispositions de chacun, chacune.
Retour des productions : après cette heure créative, nous avons réalisé une « joute de Haïkus » comme elles pouvaient être organisées à l’époque de Bashô puisqu’il souhaitait que ces poèmes se popularisent. Cela consistait à clamer à haute voix son Haïku, chacun son tour, comme une bataille oratoire. Nous étions installés en demi-cercle, deux micros circulant de main en main, en partant chacun d’un bout du demi-cercle, en avançant l’un vers l’autre à tour de rôle.
Retour sur les impressions générales ressenties lors des créations
Nous avons par la suite consacré environ 15 minutes pour échanger sur le ressenti des créateurs lors de leurs réalisations. Etait-ce difficile ? Si oui pourquoi ? Y a–t-il eu des blocages ? Des facilités ? Etait-ce agréable ou non ? Quels étaient les éléments déclencheurs ?
Voici ce qui a été soulevé : « C’est difficile de supprimer les verbes ». « C’est comme une photo instantanée ! », « J’ai dû élaguer, j’avais toujours des syllabes de trop ! », « Est-ce que le haïku est la meilleure façon d’exprimer la pensée ? » « C’est comme une ellipse, une amorce de la pensée. C’est déclencheur de la pensée », « Cela décrit un état », « Nous sommes encombrés d’Alexandrins et de rimes par notre culture… », « C’est un joli jeu entre le mot et l’image, est-ce une pensée ? ».
Enfin, nous avons conclu cet atelier avec un retour général du dispositif, de ce qui s’est déroulé. Je vous livre quelques évocations des participants : « On finit le week-end avec la joie, les rires ! » (en référence aux rires exprimés lors des restitutions). De manière générale, les participants s’accordaient à dire que l’atelier créatif était bien situé, en fin de Séminaire.
Puis rapidement, nous avons basculé sur un dialogue abordant les questions de philosophie et poésie puis philosophie et pensée:
« L’image fait penser, elle donne à penser. La Pensée philosophique est précise, rigoureuse. La pensée c’est aussi dialoguer avec soi-même (Platon). Penser c’est du vent (Socrate). »
D’après un membre du groupe créer ce genre de texte concis émane « d’une tension entre deux images, un frottement qui produit un effet, c’est une puissance inspiratrice. » Nous serions face à « une limitation du vocabulaire que l’on possède, que l’on échange ». Cela nous permet de « créer des mots : Joie-jeu, joie-plaît… » et cette « poésie nous aide à penser, elle crée un autre univers, non éprouvé certes mais ce mélange (rythme/son) vient créer un nouvel espace de conceptualisation, tel un espace de gestation, en gestation ! C’est un terrain où l’on fait pousser un concept, non nommé, non partageable, mais ressenti. C’est ici un premier état ! » « Oui, c’est un flou, une suggestion, un autre ordre, c’est la poésie ! ».
C’est « une ouverture à un ailleurs, à autre chose (qui fait quoi ?) ». Il s’agirait de « la langue dans un usage inhabituel (ici, non pour conceptualiser mais cela ouvre à la lecture de poèmes et ce que l’on écrit). Cela nous mène ailleurs, nous amène à philosopher autrement ». « La pensée diffère de la pensée philosophique. C’est un usage philosophique de la langue et un usage poétique de la langue. »
Il a été dit que dans l’Antiquité les émotions représentaient les Passions. Cela nous décentre. Mais aujourd’hui « on ne peut avoir une réflexion sans une articulation avec l’émotion. Il existe deux registres, mais l’un rend-il service à l’autre ? ». « Les idées nous affectent », elles entraineraient des « émotions » qui entraineraient à leur tour la « poésie ». Nous finirons avec cette remarque « La pensée n’est pas une peinture muette sur nos murs !».
Pour conclure, je suis amenée à penser, comme pouvait le dire Jankélévitch lorsqu’il étudiait l’œuvre de Ravel, qu’il admirait, et qui était extrêmement stricte dans son écriture, dans l’exigence des compositions musicales : « La contrainte libère ». Est-ce qu’ici nous ne pourrions pas faire ce parallèle en rapprochant la contrainte de la forme nécessaire pour écrire un Haïku et la libération de l’expression de la pensée, de nos émotions, de la Joie ?