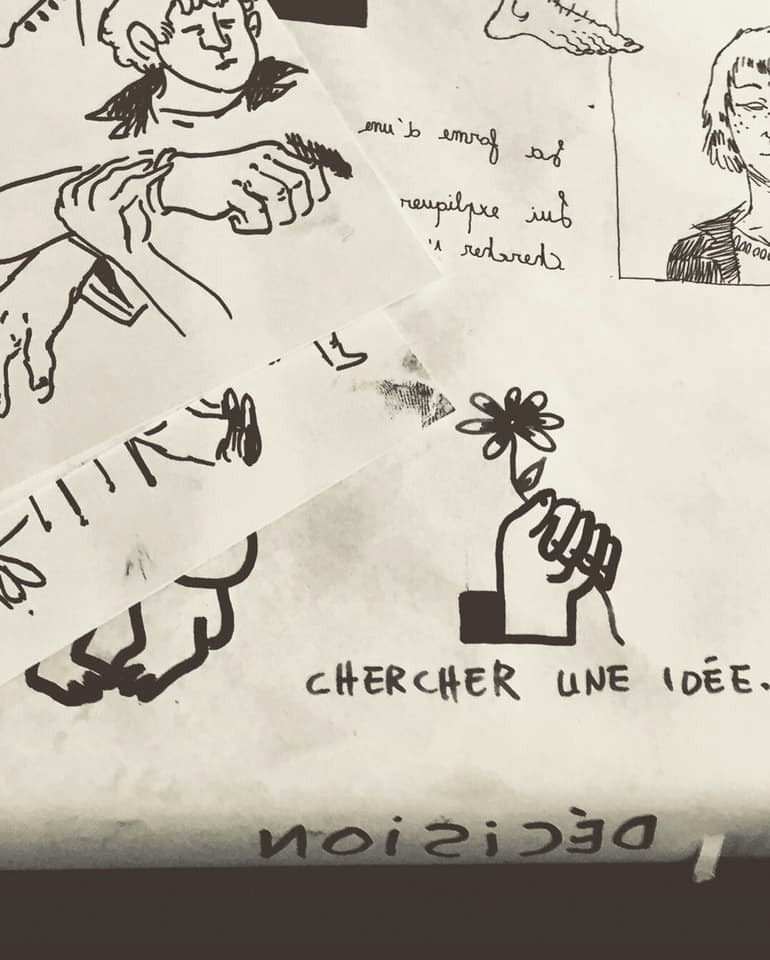Dans cet article, j’aborde le défi que représente la promotion de la délibération philosophique dans des sociétés de plus en plus pluralistes et je soutiens que les normes philosophiques occidentales traditionnelles de la philosophie pour enfants (PPE) risquent d’imposer l’uniformité et d’exclure des voix diverses par le biais de ce que Chetty appelle la « communauté d’enquête fermée ». Alors que la communauté de recherche philosophique (CRP) vise un dialogue démocratique, sa dépendance à l’égard de normes idéales telles que le « raisonnable » peut marginaliser et silencier certaines positions et certains propos. En conséquence, j’explore l’agonisme de Mouffe et la transversalité de Guattari en tant que cadre alternatif possible pour structurer l’enquête philosophique de groupe. Je conclus que même si la CRP agonistique (CRAP) englobe le pouvoir, le conflit et le dissensus, elle réifie toujours l’exclusion et les dynamiques hégémoniques. Au lieu de cela, je plaide pour une CRP transversale, qui rompt à la fois avec les hiérarchies verticales et la pureté horizontale pour cultiver une pensée errante et co-émergente à travers les frontières. En fin de compte, je conclus que la CRP transversale est un cadre plus solide pour l’éducation pluraliste en raison de sa capacité à affirmer la pluralité sans l’effondrer dans la similitude ou l’antagonisme.
La mondialisation contemporaine de l’existence humaine a conduit à l’émergence de nouvelles communautés pluralistes. Du remplacement colonial et du déplacement des populations aux réseaux d’importation/exportation et de migration du capitalisme, en passant par la formation de communautés numériques qui ignorent la distance physique, les associations humaines contemporaines ont été pluralisées de manière nuancée et inédite. Les communautés, en particulier dans le contexte socio-historique occidental, sont devenues plus diversifiées sur le plan linguistique (Helot, 2012), sur le plan religieux (Banchoff, 2007), mais aussi sur le plan culturel – devenant multiraciales et multiethniques. Face à cette pluralité croissante, cependant, un sentiment de ressentiment s’est progressivement développé, popularisant les macro- et micropolitiques conservatrices et totalitaires qui mettent l’accent sur le nationalisme, l’identité et l’isolationnisme. Ce virage réactif vers le nationalisme et la fermeture culturelle constitue une menace sérieuse pour la vie démocratique, en particulier dans les sociétés pluralistes où la différence n’est pas seulement inévitable, mais aussi fondamentale. La consolidation de l’identité autour de la pureté, de la similitude ou de l’exceptionnalisme national sape les conditions relationnelles nécessaires à la délibération de groupe et à l’association pluraliste.
Le principe de John Dewey selon lequel l’éducation devrait constituer un lieu privilégié pour cultiver des habitudes de recherche, de coopération et de délibération réfléchie offre une voie puissante et dynamique pour aborder les tensions actuelles qui poussent les démocraties pluralistes vers un conservatisme basé sur l’identité. Selon Dewey, la démocratie n’est pas simplement un arrangement politique, mais un mode de vie associé, qui doit être appris et pratiqué par le biais d’un dialogue ouvert et d’un apprentissage par l’expérience. La « grande communauté » émerge du « type d’enquête le plus élevé et le plus difficile et d’un art de la communication subtil, délicat, vivant et réactif » qui prend « possession de la machinerie physique de transmission et de circulation et lui insuffle la vie » (Dewey, 1946, p. 184). Plutôt que d’utiliser un principe d’homogénéisation de la délibération politique (semblable à la position originelle de Rawls ou à la situation idéale de discours de Habermas qui déploient des modèles rationnels a priori de communication basés sur un sujet délibérant idéalisé qui peut parler et parvenir à un consensus par-delà les différences), la délibération dériverait ici des multiples façons de vivre qui peuvent être exprimées dans une situation de communication intersubjective. Par conséquent, une démocratie délibérative deweyenne extrait « les traits souhaitables des formes de vie communautaire qui existent réellement, et les utilise pour critiquer les caractéristiques indésirables et suggérer des améliorations ». (Dewey, 2001, p. 87).
Sur cette base, Matthew Lipman et Ann Margaret Sharp ont introduit la philosophie pour enfants et adolescents (PPEA) en tant que pédagogie pratique pour l’éducation démocratique. Pour Lipman, la recherche philosophique en classe offre aux jeunes les outils nécessaires pour raisonner ensemble, remettre en question les hypothèses et développer les vertus intellectuelles nécessaires pour naviguer dans le pluralisme. Sa « communauté de recherche philosophique » (CRP) modélise une démocratie miniature dans laquelle les élèves apprennent non seulement à penser de manière critique, mais aussi à écouter, à répondre et à co-construire du sens avec d’autres personnes qui peuvent penser ou vivre différemment. En ce sens, Lipman étend la pensée philosophique au-delà des limites du monde universitaire en la formalisant comme un élément crucial de la vie démocratique dans une communauté plurielle (Burgh, 2018 ; Muega et Acido-Muega, 2023). Seule « une éducation qui promeut la recherche philosophique chez les enfants est la garantie d’une société adulte authentiquement démocratique » (Lipman, 1982, p. 38). Elle permet aux individus de mieux de naviguer de manière critique, bienveillante et créative dans les complexités de la délibération démocratique à travers les différences en encourageant des habitudes de pensée démocratique adéquates.
Cependant, une vague plus récente de penseurs critiques a remis en question la compatibilité entre la PPEA et les exigences d’une enquête pluraliste authentique et éthique (Chetty, 2014 ; 2018 ; Elicor, 2020 ; Reed-Sandoval 2014a, 2014b, 2019 ; Reed-Sandoval et Sykes, 2016 ; Rosas, 2023 ; Rainville, 2001 ; Kennedy et Kohan, 2023). Au lieu de promouvoir la pluralité, la créativité et les connexions, le déploiement non critique de la PPEA et de la CRP dans des espaces pluriels peut involontairement réduire au silence certaines voix et en normaliser d’autres par le biais de ce que Darren Chetty a appelé la « Gated Community of Inquiry » (communauté d’enquête fermée). Ce dont nous avons besoin aujourd’hui, dans ce contexte de montée du conservatisme et de l’homogénéisation, c’est d’une CRP capable de naviguer dans les topologies du pouvoir et de l’assujettissement qui définissent notre quotidien actuel, tout en évitant d’être reterritorialisé par ces mêmes relations.
À cette fin, cet article évalue deux cadres conceptuels possibles pour adapter la CRP aux exigences non idéales et pluralistes de l’existence sociale contemporaine : la vision agonistique de Chantal Mouffe et le concept de transversalité de Félix Guattari. Après avoir examiné ces deux concepts et leur dynamique au sein de la CRP, je conclus qu’une Communauté Transversale de Recherche Philosophique (CTRP) est plus apte à cultiver une recherche philosophique de groupe qui valorise et promeut les conditions de pluralisme qui définissent notre existence sociale actuelle. Plus précisément, je soutiens que si la Communauté Agonistique de Recherche Philosophique (CARP) offre une alternative à la CRP idéale, elle normalise également l’assujettissement hégémonique en tant que condition ontologique de l’éducation politique. La CTRP, en revanche, traiterait « des multiples façons dont nous sommes conditionnés, rassemblés et vidés de notre imagination dans le moment présent » afin d’ouvrir des voies pour que la créativité conceptuelle et l’enquête de groupe pluraliste puissent s’épanouir (Bradley et Cole, 2018, p. 5).
Le jeu de pouvoir de la réflexion philosophique et de la transcendance totalitaire.
Malgré les tentatives des PPEA de traiter les frictions contemporaines d’une démocratie pluraliste, il y a un sens sous-évalué et sous-discuté dans lequel la recherche philosophique (occidentale) est en tension avec le pluralisme. D’une part, le paysage de la délibération pluraliste opère dans une topologie socio-historique spécifique de pouvoir et de différence. D’autre part, la pensée philosophique (en particulier dans la tradition occidentale et dans la PPEA) est souvent présentée comme une pratique réflexive transcendantale dépourvue de relations de pouvoir ou de hiérarchies matérielles. Dans la PPEA, l’espace de délibération, la CRP, est conçu comme une « condition de parole idéale » où les hiérarchies verticales et les frontières conceptuelles peuvent être explorées et remises en question par le biais d’une enquête philosophique horizontale (Kennedy et Kennedy, 2011 ; Kennedy, 2012 ; Kennedy et Kohan, 2021 ; Kennedy, 2023 ; Naji, 2013).
La communauté d’enquête philosophique (CPI) de Lipman n’est pas seulement un dispositif pédagogique, mais plutôt la projection d’une communauté de parole idéale dédiée à une forme normative de pratique démocratique - une communauté qui sert de médiateur entre la démocratie en tant que forme d’enquête sociale et l’enquête philosophique dialogique en tant que forme de pratique communicative. (Kennedy, 2012, p. 37).
En d’autres termes, la valeur de la philosophie réside dans sa capacité à créer des communautés de pensée qui transcendent les limites matérielles du monde et de la vie sociale en vue de leur contemplation et de leur reconstitution. La nature idéale de la pensée et du dialogue philosophiques est, par conséquent, souvent présentée comme la clé pour permettre d’authentiques normes démocratiques de délibération. La CRP n’est pas simplement une méthode pédagogique, mais une mise en œuvre concrète des principes démocratiques. Il modélise le dialogue inclusif, le respect mutuel et l’intériorisation des normes épistémiques nécessaires à l’épanouissement de la démocratie délibérative (questionnement, recherche de la clarté, de la vraisemblance, etc.).
L’aspiration à une forme horizontale idéale d’enquête de groupe, où des normes épistémiques raisonnables et communautaires fondent l’entreprise philosophique, peut toutefois se faire au prix du silence ou même de l’assimilation de la pluralité. Levinas souligne que l’histoire de la philosophie occidentale « peut être interprétée comme une tentative de synthèse universelle, une réduction de toute l’expérience, de tout ce qui est raisonnable, à une totalité par laquelle la conscience embrasse le monde, ne laisse rien en dehors d’elle-même, et devient ainsi une pensée absolue. » (Levinas, 1982, p. 75). En d’autres termes, l’objectif général de la pensée philosophique occidentale est d’homogénéiser la pluralité sous le parapluie unifié de l’Être (c’est-à-dire de l’ontologie). Il est important de noter que cette volonté de totalisation révèle une affinité plus profonde entre l’universalité horizontale de la pensée philosophique et les structures d’autorité verticales de l’État.
L’ontologie, en tant que philosophie première, est une philosophie du pouvoir. Elle s’inscrit dans l’État et dans la non-violence de la totalité, sans se prémunir contre la violence dont vit cette non-violence, et qui apparaît dans la tyrannie de l’État. La vérité, qui devrait réconcilier les personnes, existe ici de manière anonyme. L’universalité se présente comme impersonnelle, et c’est là une autre inhumanité (Levinas, 1969, p. 46).
L’ontologie, en tant que forme de pensée unificatrice et totalisante, est liée à un besoin de contrôle, de maîtrise et de domination ; un besoin de totaliser l’extériorité et l’autre dans le même. Sa revendication d’une totalité non violente (comme le Royaume des fins de Kant, la position originelle de Rawls ou la Communauté idéale de parole de Habermas) ne tient pas compte des conditions très totalisantes et violentes de son homogénéité. Cette volonté d’affirmer le « primat de la similitude » se matérialise dans la création de l’État qui, comme nous le dit Hegel, est l’actualisation de la liberté concrète par l’homogénéisation des volontés particulières (Hegel, 2005, §260). L’État, en d’autres termes, fonctionne comme un système d’homogénéisation dans lequel la pluralité des individus peut être intégrée dans l’ordre rationnel de la vie éthique. Au sein de cette totalité, la particularité n’a de sens qu’en tant que partie de l’universel. Il est important de noter que, tout comme l’État cache son passé violent afin d’afficher une totalité pure et intacte, la priorité ontologique de la similitude dans la pensée philosophique occidentale est conditionnée par un rétrécissement violent et l’exclusion de la pluralité et de la multiplicité. C’est pourquoi l’ontologie en tant que philosophie première est « une philosophie du pouvoir … en tant que philosophie première qui ne met pas en question le même, une philosophie de l’injustice » (Levinas, 1969, p. 46). Par conséquent, si nous prenons au sérieux la vision de Levinas sur la complicité entre la philosophie occidentale et la logique homogénéisante de l’État, alors l’engagement de la PPEA en faveur de la délibération démocratique ne peut pas siéger dans l’ordre des choses.
Pour Maria Lugones, la volonté de totaliser la pluralité s’exerce par des actes de séparation qui valorisent les catégories pures, abstraites et congruentes au détriment des multiplicités désordonnées, obscures et rhizomatiques. Comme elle l’explique, « l’hypothèse de l’unité est un acte de séparation par scission ; en concevant ce qui est multiple comme unifié, ce qui est multiple est compris comme intérieurement séparable, divisible en ce qui le rend un et le reste » (Lugones, 1994, p. 464). En d’autres termes, la logique de la pureté dissèque ce qui est complexe en éléments isolés et « purs » qui peuvent être plus facilement classés, évalués et gérés. Ce processus fragmente la multiplicité en parties distinctes et décontextualisées qui peuvent être sélectivement légitimées ou exclues par le cadre culturel dominant. La pluralité, l’altérité et la multiplicité ne deviennent en effet lisibles que sous la forme de fragments catégoriques rendus intelligibles – et donc contrôlables – par les positions dominantes.
La fragmentation de la multiplicité en catégories congruentes et unifiées n’est pas fortuite. Elle est au contraire essentielle à la construction de la subjectivité occidentale moderne. Le sujet moderne doit être purifié pour devenir quelqu’un qui pense, communique et socialise à partir du point de vue de l’unité – à partir du point de vue de la primauté de la similitude. Il doit être « habillé, costumé, masqué pour paraître capable d’exercer cette réduction de l’hétérogénéité à l’homogénéité, de la multiplicité à l’unité » (Lugones, 1994, p. 466). Cela « exige que son reste n’ait plus d’importance pour le sentiment qu’il a de lui-même en tant que personne qui exerce à juste titre un contrôle sur la multiplicité » (Lugones, 1994, p. 466). Cela exige la réduction de la complexité du sujet en une identité unidimensionnelle. « Dans la mesure où la maîtrise des inscriptions institutionnelles fait partie du programme d’unification, explique-t-elle, sa différence ne peut pas être considérée comme des « inscriptions », mais seulement comme des marques coïncidentes et non symboliques » (Lugones, 1994, p. 466).
Pour illustrer ce propos, Lugones évoque le sujet mexicain/américain dans l’imaginaire anglo-saxon. Le sujet mexicain/américain est intrinsèquement multiple et marqué par la fluidité, l’hybridité et la créativité culturelle. Or, c’est précisément cette richesse que la logique anglo-saxonne de pureté (et la pensée philosophique occidentale) ne peut tolérer. Pour préserver l’ordre hégémonique dominant, la logique de la similitude aplatit cette multiplicité dans un binaire statique.
La philosophie anglo-saxonne veut que les mexicains/américains conservent leur culture (pour être différents et ne pas être des citoyens à part entière) et s’assimilent (pour être exploitables), une position dont la contradiction est évidente. Mais comme une double personnalité dédoublée, le mexicain authentique peut s’assimiler sans cesser d’être « cultivé », les deux moi étant complémentaires, la nature ornementale du moi mexicain résolvant la contradiction (Lugones, 1994, p. 470).
Par cette fragmentation, la logique anglo-saxonne de pureté systématise le contrôle sur le sujet mexicain/américain de deux manières. D’une part, elle réduit la multiplicité à la logique occidentale de la fragmentation. Ce faisant, et d’autre part, cette « scission fait du moi une personne incapable d’être culturellement créative dans une culture vivante » (Lugones, 1994, p. 471). Le sujet fragmenté est donc aliéné par les deux groupes et coupé de la possibilité de participer activement aux cultures vécues auxquelles il appartient. Il devient incapable de générer des formes nouvelles, hybrides ou relationnelles de vie communautaire qui reflètent leurs relations complexes et multiples. Ainsi, la logique de pureté réduit la multiplicité à des catégories fragmentées qui imposent des formes d’identité statiques, imposées de l’extérieur et culturellement stériles.
Normes d’exclusion philosophique dans l’éducation
En philosophie professionnelle, Kristie Dotson (2013) souligne comment la culture de la justification qui domine la philosophie professionnelle aux États-Unis exclut les formes non traditionnelles de pensée philosophique par l’exceptionnalisme et l’incongruité. D’une part, l’exclusion par l’exceptionnalisme « implique l’exclusion infondée de vastes corpus de recherche fondée sur le privilège d’un groupe (ou d’un ensemble de groupes) et de leurs recherches par rapport à d’autres » (Dotson, 2013, p. 12). D’autre part, l’exclusion par incongruence provient du fait que le penseur non traditionnel « n’accepte pas une norme de justification ou un ensemble donné de normes de justification prévalant dans le contexte de la philosophie professionnelle » (Dotson, 2013, p. 14). L’exclusion par l’exceptionnalisme et l’incongruité illustrent la vision de Lugones sur la logique de la pureté. Ce point de vue philosophique moderne fonctionne comme un mécanisme de pouvoir qui fragmente et hiérarchise les modes de connaissance en élevant les normes et procédures épistémiques dominantes au rang de rationnelles, légitimes ou proprement « philosophiques ».
S’appuyant sur les arguments de Dotson, Chetty (2018) illustre comment la multiplicité peut être réduite au silence dans la PPEA grâce à la norme procédurale du caractère raisonnable. Pour Chetty, les commentaires de Dotson sur la philosophie professionnelle suggèrent que « dans une classe où les enfants sont engagés dans une enquête philosophique structurée par des normes de « raisonnabilité », la constitution de certaines contributions comme “déraisonnables” peut servir à exclure les perspectives offertes par les élèves issus de minorités racialisées et, ce faisant, à masquer et à perpétuer les structures racialisées de domination » (Chetty, 2018, p. 50). Par conséquent, tout comme une totalité idéale non violente présuppose mais oublie ses origines violentes, « la communauté de recherche idéalisée - un espace véritablement égalitaire, où la voie de l’enquête n’est pas bloquée et où toutes les suppositions sont examinées - pourrait en fait parfois fonctionner comme une « Gated Community of Inquiry » (Chetty, 2018, p. 40). Il souligne que si Lipman et Sharp ont tous deux reconnu l’importance de la culture et de l’histoire dans la formation du caractère raisonnable du dialogue philosophique, Lipman a également insisté sur le fait que ces éléments ne pouvaient pas être spécifiés par un ensemble prédéterminé de contenus. Cependant, c’est ici que Chetty souligne à quel point les discours courants et quotidiens sur le caractère raisonnable sont déjà imprégnés de l’ignorance des Blancs. Ceci, ajouté à la sous-représentation des personnes de couleur dans la PPEA, empêche les praticiens d’éviter de renforcer la domination blanche et d’élever le pluralisme dans leur CRP. En d’autres termes, des normes telles que le « caractère raisonnable » peuvent fonctionner comme un outil de contrôle qui renforce la pureté de la communauté d’enquête en excluant les formes d’expression ancrées dans la culture ou situées dans l’histoire.
Si nous ne comprenons pas le lien entre la logique dominante de la pureté et du caractère raisonnable, nous courons le risque très réel de catégoriser les propos marginalisés comme déraisonnables tout court, tout en présentant les récits dominants comme ne posant aucun problème. Pour revenir à l’exemple de Lugones, au sein de la CRP, les enfants mexicains/américains peuvent être socialement reconnus comme « américains » uniquement dans la mesure où ils confirment la perspective dominante et, à l’inverse, rejetés comme « mexicains » lorsque leurs contributions perturbent ou compliquent ce récit. La logique de pureté ne permet pas à la CRP de s’engager dans la multiplicité vécue de l’expérience relationnelle, mais au contraire d’isoler et de diviser les identités et les paroles en fragments digestes alignés sur les normes hégémoniques. Cela reflète la préoccupation de Chetty selon laquelle la CRP, lorsqu’elle est régie par des normes abstraites telles que le « caractère raisonnable », devient une communauté d’enquête fermée qui détermine tacitement quelles formes d’expression sont admissibles. Dans les deux cas, la volonté de pureté maintient un espace qui semble ouvert et égalitaire tout en excluant secrètement ceux dont les façons de penser, de parler ou d’être ne sont pas conformes à la sémiotique de la culture dominante.
Sans une intervention stratégique et délibérée, la communauté de recherche philosophique est vouée à reproduire la réduction systémique et ontologique de la pluralité qui sévit dans l’histoire de la philosophie occidentale, de la philosophie professionnelle et même de la philosophie pour/avec les enfants. Plutôt qu’une condition de parole idéale qui fuit la verticalité matérielle de la pensée philosophique, nous avons besoin d’une communauté de recherche philosophique qui puisse naviguer à la fois dans ses dimensions verticales et horizontales. Nous pouvons emprunter deux voies possibles. D’une part, le modèle agonistique nous offre un cadre pour repenser l’IPC comme une tension constante et insoluble entre les dimensions verticales et horizontales de la pensée philosophique et de la délibération démocratique. D’autre part, la transversalité nous offre un cadre conceptuel qui réoriente les dimensions verticales et horizontales de la pensée philosophique de groupe vers de nouveaux territoires conceptuels.
Pluralisme démocratique et communauté d’enquête agonistique
Pour comprendre comment la Communauté de Recherche Agonistique et Philosophique (CRAP) peut fournir un cadre théorique à une forme plus critique et pluraliste d’enquête collective, nous devons faire un bref détour par son problème d’origine. S’inspirant de la critique de Carl Schmitt à l’égard de la théorie démocratique, Mouffe part de l’idée qu’il existe une tension fondamentale et insoluble entre le libéralisme et la démocratie. D’une part, le libéralisme s’engage à une inclusion absolue et à un consensus à travers une pluralité d’identités. D’autre part, la démocratie nécessite des normes d’exclusion pour définir qui est « le peuple ». En d’autres termes, les démocraties exigent une sorte d’« amitié » qui distingue un « nous » d’un « eux » (Mouffe, 2000, p. 50-51). Ce besoin d’exclusion trouve son origine dans le besoin humain fondamental de reconnaissance sociale. Cependant, les théories démocratiques délibératives libérales contemporaines, qui mettent l’accent sur l’inclusivité et l’égalité, ne reconnaissent pas la manière dont l’exclusion et les hiérarchies de pouvoir soutiennent les démocraties (plurielles ou non).
Pour Mouffe, il s’agit là d’un élément essentiel pour comprendre la montée des politiques d’extrême droite dans les démocraties pluralistes contemporaines. Le libéralisme étant incapable de définir « qui » est le peuple de manière ouvertement politique, il doit justifier ses pratiques d’exclusion par des raisons naturelles, morales ou métaphysiques. Les théories libérales contemporaines finissent ainsi par masquer une décision politique contingente comme une décision neutre ou inévitable. Comme elle l’explique,
[nier] l’existence d’un tel moment de fermeture, ou de présenter la frontière comme dictée par la rationalité ou la morale, c’est naturaliser ce qui devrait être perçu comme une articulation hégémonique contingente et temporaire du « peuple » à travers un régime particulier d’inclusion et d’exclusion. (Mouffe, 2000, p. 49)
De cette manière, le libéralisme exclut la possibilité d’une contestation de la forme même de la sphère démocratique. Comme l’expliquent Sant et al., « le problème ici est que la nature de la sphère démocratique est elle-même considérée comme acquise et qu’il n’y a pas de possibilité d’émergence de nouvelles subjectivités politiques ou de contestation de ce qui constitue un engagement démocratique » (Sant et al., 2020, p. 231-232). Par conséquent, lorsque cette contestation est bloquée, les groupes mécontents sont poussés vers les mouvements extrémistes comme moyen de réclamer un pouvoir politique et une visibilité dans un système qui, autrement, leur refuse une place à première vue.
Mouffe, cependant, n’est finalement pas d’accord avec Schmitt sur la futilité d’une association démocratique pluraliste. Comme elle l’explique, « si nous acceptons que les relations de pouvoir soient constitutives du social, alors la question principale de la politique démocratique n’est pas de savoir comment éliminer le pouvoir mais comment constituer des formes de pouvoir compatibles avec les valeurs démocratiques ». (Mouffe, 1999, p. 753) Elle suggère en particulier de passer des normes libérales de la délibération démocratique (inclusivité, égalité et consensus) à des formes agonistiques de délibération démocratique où le dissensus fonctionne comme une norme politique. En d’autres termes, nous avons besoin d’une forme de délibération démocratique qui mette l’accent sur la nature antagoniste, chargée de pouvoir et affective des luttes politiques. Nous avons besoin d’une forme de délibération démocratique qui reconnaisse la nécessité de l’exclusion et la relation entre le pouvoir et la légitimité. Comme elle le précise, « le but de la politique démocratique est de construire le « eux » de telle sorte qu’il ne soit plus perçu comme un ennemi à détruire mais comme un « adversaire », c’est-à-dire quelqu’un dont on combat les idées mais dont on ne remet pas en cause le droit à défendre ces idées » (Mouffe, 2000, p. 101-102).
Baptist Roucau explore de manière innovante la possibilité de combiner les idées de Mouffe avec l’éducation par la PPEA à travers ce qu’il appelle la Communauté Agonistique de Recherche Philosophique (CARP). Pour lui, l’agonisme « offre un cadre novateur pour l’éducation démocratique fondé sur la reconnaissance du fait que, dans une démocratie pluraliste, le désaccord politique est inéluctable, intrinsèquement passionnel et enchevêtré dans les relations de pouvoir » (Roucau, 2023, p. 21). L’éducation agonistique cultive spécifiquement des normes de dialogue ouvertes à l’altérité, encourage la capacité des jeunes à débattre dans le paysage inégal des relations de pouvoir, et nourrit leur capacité à exploiter les émotions politiques dans le but de promouvoir une vision substantielle d’une société juste. D’une part, Roucau souligne que l’agonisme démocratique et la PPEA partagent déjà des objectifs et des valeurs communs, tels que favoriser le désaccord plutôt que l’accord, souligner l’importance des questions politiques et mettre l’accent sur le rôle des émotions dans la pensée (Roucau, 2023, p. 28-30). D’autre part, et en même temps, l’adoption d’une CRAP impliquerait aussi certains changements. Plus précisément, Roucau propose que l’introduction de l’agonisme dans la PPEA) approfondisse son engagement envers le désaccord soutenu, 2) encourage l’aisance avec le conflit et les émotions négatives, et 3) mette en évidence les relations de pouvoir dans les conversations philosophiques.
D’abord et avant tout, la célébration du dissensus par l’agonisme fournit aux jeunes « un fondement théorique solide pour valoriser le désaccord comme résultat légitime du dialogue philosophique » (Roucau, 2023, p. 31). Cela peut également atténuer la frustration qui émerge lorsque la recherche « ne mène nulle part » (Roucau, 2023, p.31.). Deuxièmement, alors que l’éthique générale de PPEA « semble favoriser la gaieté et la convivialité », une communauté agonistique de recherche philosophique repenserait la fonction du conflit et de l’émotion négative en tant qu’éléments constructifs clés de la pensée philosophique et du dialogue communautaire. Roucau propose spécifiquement deux manières possibles d’y parvenir. La première option, proposée par Jane Lo (2017), consisterait à demander aux participants de jouer le rôle d’arguments enflammés, de réfléchir aux positions et aux émotions, et de « s’entraîner à se pardonner les uns les autres » (Lo, 2017, p. 95). La deuxième option, proposée par Ásgeir Tryggvason (2019), consisterait à établir une hégémonie en tant qu’« idéal pédagogique pour parvenir à une clôture dans les discussions enflammées sans viser le consensus » (Tryggvason, 2019, p. 5). Enfin, l’introduction de l’agonisme dans la CRP et la PPEA « permettrait d’aborder explicitement les relations de pouvoir qui sous-tendent les questions politiques » et offrirait aux étudiants la possibilité de questionner « ce qui compte comme perspectives légitimes et raisonnables dans la CRP » (Roucau, 2023, p.33).
En ce sens, la CRAP promeut le pluralisme en fournissant essentiellement un espace où la lutte antagoniste ontologique pour une identité politique peut être équitablement et justement délibérée d’une manière dynamique et ouverte. Plutôt que d’espérer une enquête de groupe idéale et un dialogue au-delà des différences, elle présente clairement le paysage du pouvoir et des émotions qui légitiment l’identité du groupe tout en reconnaissant sa nature temporaire et politique. La proposition de Roucau est, je crois, un pas dans la bonne direction. Si la PPEA cherche à s’engager dans une réflexion philosophique sur des problèmes non idéaux et des applications conceptuelles, la communauté de recherche doit faire de la place au dissensus, au conflit et aux émotions négatives, ainsi qu’au contexte socio-historique. Cependant, je crois aussi que l’agonisme de Mouffe offre en fin de compte une dynamique de similitude en constante évolution plutôt qu’une forme pluraliste d’association. En d’autres termes, la CRAP est ouverte au pluralisme dans la même expression réductrice et idéale de similitude que nous trouvons déjà dans l’histoire de l’ontologie occidentale. Plutôt que de cultiver un espace où la pluralité peut s’épanouir, elle nous présente un espace de délibération qui légitime la réduction de la pluralité à une pureté temporaire.
La réduction totalitaire de l’altérité dans la communauté agonistique de recherche philosophique
Si le lien entre l’éducation démocratique agonistique et la PPEA permet de s’engager de manière critique dans la dynamique de pouvoir inconsciente qui dicte le dialogue philosophique dans la CRAP, il risque néanmoins de reproduire le totalitarisme que nous avons identifié à la fois dans la philosophie occidentale et dans la PPEA traditionnelle. L’accent mis sur l’hégémonie, l’exclusion et le pouvoir ne résiste pas tant aux dimensions totalitaires de la pensée philosophique occidentale qu’il ne les normalise et les légitime par des décisions politiques de groupe. Outre Schmitt, Mouffe s’appuie également sur la psychanalyse lacanienne pour soutenir les exigences hégémoniques de la formation de l’identité. Pour Lacan, le sujet se constitue à partir d’un manque qui doit être comblé par une autorité extérieure. Le sujet se constitue spécifiquement dans et par un langage donné par l’Autre (c’est-à-dire l’ordre symbolique de l’inconscient qui se réfère au langage, aux lois et aux normes sociales). Cet Autre étranger, impersonnel et autoritaire fournit au sujet une identité stable à travers ce que Lacan appelle un Significateur Maître. Ce maître-signifiant est un point nodal vide de l’Autre qui fonde à la fois la structure discursive de l’inconscient et l’identité du sujet. En d’autres termes, il constitue un socle autoritaire qui sécurise la relation du sujet au champ sémiotique et fonde son identité dans le discours social.
Dans la mesure où le sujet ne dispose pas de la structure symbolique fondamentale pour se représenter, il n’a pas la capacité de se doter d’une identité propre. Le sujet est ainsi constitué par un manque ou un besoin fondamental, celui de la reconnaissance sociale. En d’autres termes, il est dépendant de l’autorité extérieure du signifiant maître pour résoudre ce manque fondamental qui lui est d’abord présenté. Pour Lacan, le sujet se constitue donc dans une relation discursive hégémonique avec l’Autre (Mouffe, 2000, p. 137-138). La nécessité de l’exclusion hégémonique que Mouffe ontologise comme condition d’identification du « peuple » est fondée sur la même absence ontologique d’une identité interne immanente. Si le peuple ne peut pas se définir de manière interne, Mouffe estime qu’il doit être défini dans une relation hégémonique avec un agent extérieur ou, dans ce cas, un adversaire qui doit être battu dans une lutte politique légitime.
Le danger de la démocratie agonistique n’est pas seulement qu’elle favorise la compétitivité et l’adversité, mais qu’elle peut rapidement normaliser l’exclusion antagoniste à travers une politique identitaire hégémonique verticale. L’écart constitutif entre le collectif et sa conceptualisation en tant que « peuple » est essentiellement « incompatible avec la prétendue nature hégémonique de la lutte démocratique qui est censée préserver cet écart » (Rummens, 2009, p.382). Dès qu’un peuple prétend représenter « le peuple », il peut « rejeter ceux qui ne font pas partie de la plèbe en tant que membres légitimes de la communauté, effondrant ainsi l’écart nécessaire pour maintenir le lieu du pouvoir vide » (Rummens, 2009, p. 383).
Comme l’a fait Dewey, nous pourrions évoquer l’éducation à la rescousse. L’objectif de l’éducation agonistique serait alors de former les étudiants aux exigences discursives d’une lutte démocratique pour définir qui est le peuple. Elle cultiverait la capacité des jeunes à délibérer à la fois verticalement et horizontalement en les maintenant dans une tension agonistique irrésolue. En d’autres termes, alors que l’antagonisme est ontologique, des programmes éducatifs comme la P4C pourraient offrir un espace dans lequel cultiver les exigences horizontales d’une démocratie pluraliste agonistique. En d’autres termes, la PPEA pourrait donner aux jeunes le langage philosophique (celui des droits de l’homme, de la moralité, de la justice, de l’égalité, etc.) pour maintenir l’écart entre l’hégémonie et l’égalité dynamiquement vivant.
Ceci étant dit, nous devrions toujours supposer « un chevauchement discursif minimal entre les positions adverses dans le sens d’une compréhension au moins partiellement partagée et donc discutable de la signification de ces valeurs » (Rummens, 2009, p. 383). Le pluralisme et l’altérité sont une fois de plus soumis à des normes discursives minimales universelles qui prédéfinissent qui peut « concourir » dans la communauté d’enquête. Cela nous ramène à l’inquiétude de Chetty, qui craignait que les exigences discursives minimales de PPEA (comme le caractère raisonnable) ne soient déjà entachées par les luttes de pouvoir hégémoniques de l’antagonisme. En conséquence, la CRAP peut facilement reproduire une communauté d’enquête cloisonnée sous le couvert d’un agonisme démocratique légitime. La communauté agonistique de l’enquête philosophique pose donc de sérieux risques à la pluralité dans l’éducation démocratique.
La communauté transversale d’investigation philosophique
Plutôt que de maintenir l’hégémonie verticale dans une tension insoluble avec l’unité horizontale - ou, comme le dirait Lugones, comme de pures catégories isolées les unes des autres - j’aimerais proposer la transversalité comme cadre alternatif pour doter la CRP de capacités pluralistes. La transversalité a été proposée à l’origine par Guattari comme un outil clinique pour une véritable thérapie de groupe où l’individu et le groupe peuvent créer des relations productives d’une manière non totalitaire. En tant que concept, elle s’oppose fondamentalement
(a) à la verticalité, telle qu’elle est décrite dans l’organigramme d’une structure pyramidale (chefs, assistants, etc.) ; (b) à l’horizontalité, telle qu’elle existe dans les services perturbés d’un hôpital, ou plus encore, dans les services séniles ; c’est-à-dire à un état d’afraires dans lequel les choses et les gens s’adaptent tant bien que mal à la situation dans laquelle ils se trouvent. (Guattari, 1984, p, 17)
L’enquête transversale rompt à la fois les frontières verticales du pouvoir et la pureté horizontale du peuple. Elle offre « une nouvelle direction [qui] agit comme un plan non vertical et non horizontal » à travers lequel les forces dominantes d’homogénéisation et de totalisation « peuvent être cartographiées et réorientées » (Cole et Bradley, 2018, p. 2). C’est une manière d’ouvrir à la fois l’individu et le groupe pour produire de nouveaux modes d’être singuliers en ouvrant les frontières qui les constituent comme séparés, isolés et purs.
Ce n’est qu’à partir d’un certain degré de transversalité qu’il sera possible - mais seulement pour un temps, car tout cela est à repenser continuellement - d’engager un processus analytique donnant aux individus un réel espoir d’utiliser le groupe comme un miroir. L’alternative à une intervention de type analytique de groupe est la possibilité pour un individu de se joindre au groupe en tant qu’auditeur et locuteur, d’accéder ainsi à l’intériorité du groupe et de l’interpréter. (Guattari, 1984, p. 20)
En clair, la transversalité vise à produire de nouvelles relations subjectives en rejetant intentionnellement les frontières totalisantes et catégoriques établies par le capitalisme, la colonisation et même la philosophie occidentale. En écoutant et en parlant simultanément, l’individu entre dans une relation réciproque avec le groupe qui lui permet de comprendre sa dynamique interne. Ce faisant, le groupe cesse de fonctionner comme une structure sociale fixe et devient une sorte de miroir analytique, à travers lequel l’individu peut rencontrer à la fois ses propres investissements inconscients et les forces collectives qui les façonnent. Ceci, à son tour, permettrait une réorientation stratégique des forces macro et micro de l’homogénéisation.
L’objectif de l’enquête transversale sur les groupes n’est pas de réaffirmer la domination du groupe sur l’individu ou vice versa, mais de constituer un espace de compréhension conjointe de leurs désirs, tensions ou structures affectives collectives respectives. Il vise à créer un espace où les catégories conceptuelles et matérielles de la vie contemporaine peuvent être exprimées et repensées à travers de nouvelles connexions et perspectives transversales. En d’autres termes, la transversalité est le type de pensée qui cherche à transgresser - c’est-à-dire qui cherche à être errant de la même manière que la poétique des relations de Glissant est censée être errante (Glissant, 2009). La transversalité « ne demande pas une unité de perspective, une totalité séduisante, mais introduit plutôt un moyen de communiquer entre les segments, dans un autre espace ou une autre dimension » (Bradley, 2018, p. 79). L’objectif principal d’une CTRP est donc de cultiver une affinité pour la pensée transversale, pour traverser les frontières et créer une nouvelle relationnalité subjective autour de la production de concepts philosophiques errants. Il promeut un type d’enquête communautaire qui identifie et brise les frontières dans le but de résister à l’homogénéisation et d’affirmer une pluralité de singularités. L’enquête philosophique transversale avec les jeunes chercherait d’abord à identifier les relations de pouvoir, les investissements affectifs et la sémiotique socio-historique qui isolent et purifient les concepts philosophiques. Elle chercherait ensuite à ouvrir ces frontières en fournissant un espace où de nouvelles connexions conceptuelles peuvent être formées.
La principale différence entre la CRAP et le CTRP est que ce dernier n’opérationnalise pas un besoin issu d’un manque qui, en fin de compte, force le groupe à une relation d’assujettissement. Plutôt que d’être structuré autour de l’antagonisme ou de l’exclusion, le TCPI canalise le désir, non pas comme un manque ou un besoin, mais comme une force productive et connective qui génère de nouvelles possibilités de penser avec les autres. Il ne s’agit pas ici d’établir une position philosophique issue d’un besoin ontologique de reconnaissance. Ce sont les flux désirants positifs du collectif qui génèrent des alliances inattendues, des hybrides conceptuels et des solidarités affectives qui transforment la manière dont les participants se rapportent les uns aux autres et à l’enquête philosophique en cours. En ce sens, la CTRP s’apparente à la notion de communauté de recherche philosophique de Kennedy. En d’autres termes, la CTRP est une pratique de « problématisation continue des concepts » qui
agit comme un moteur de reconstruction personnelle et sociale, premièrement, en modélisant le processus évolutif de développement d’inconcepts de nouveauté créative ; deuxièmement, en rendant visibles les liens entre les divers territoires de connaissance que nous appelons les « disciplines » ; troisièmement, en explorant la subjectivité de groupe comme un phénomène autorégulateur et autopoïétique ; et quatrièmement, en fournissant un cadre discursif délibératif pour la gouvernance. (Kennedy, 2022, p.10)
Cependant, la compréhension de la CRP par Kennedy privilégie encore trop l’unité horizontale, universelle et idéale de la démocratie. Pour Kennedy et de nombreux praticiens de la PPEA, la CRP est une condition idéale de discours où la recherche philosophique et le dialogue se déroulent entre égaux dans un espace non coercitif. Cependant, l’accent mis sur l’égalité horizontale rend la CRP plus transcendantal (c’est-à-dire un espace de communication idéal universel) que transversal (c’est-à-dire un espace délibératif qui englobe l’asymétrie, la rupture et la négociation permanente de la différence).
L’objectif du CTRP n’est pas d’aplanir la nature verticale de la hiérarchie, mais de la rendre opérationnelle de manière transversale. Ces hiérarchies peuvent exister et existent, et l’objectif de la CTRP est de les rendre perméables et contestables. Cela signifie que les hiérarchies sont fonctionnelles plutôt qu’ontologiques. Elles émergent et se dissolvent en fonction des flux désirés et des connexions productives de l’enquête. En fonction de l’enquête philosophique en question, certaines subjectivités/relationalités peuvent permettre à un coefficient de transversalité plus ou moins élevé de se matérialiser. Dans l’enquête éthique, par exemple, le CTRP pourrait mettre l’accent sur l’Autre lévinassien en tant que source de la responsabilité et de la pensée éthiques. Plutôt que de débattre de l’application de principes purs, cela encouragerait les jeunes à produire leurs propres concepts éthiques à partir d’un face à face singulier, localisé, pluraliste et pourtant hiérarchique. En tant que tel, plutôt qu’une condition idéale de discours, il se concentre sur le conditionnement d’une cartographie critique des conditions matérielles et historiques de nos concepts éthiques et politiques. Cela rend la CTRP plus anarchique que démocratique par nature, mais il se peut que la PPEA n’ait pas besoin de modéliser l’enquête démocratique pour cultiver et sauvegarder une démocratie pluraliste. C’est peut-être en cultivant une forme de recherche plus anarchique que nous pouvons résister aux forces hégémoniques et homogénéisantes qui menacent une véritable vie démocratique à travers les différences.
-
Banchoff, T. (2007). Democracy and the New Religious Pluralism. Oxford University Press.
-
Bradley, J. P. N. (2018). On Philosophical and Institutional “Blinkers”: SOAS and Transversal Worldviews. Dans D. R. Cole & J. P. N. Bradley (Eds.), Principles of Transversality in Globalization and Education (pp. 67–82). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-0583-2_5
-
Bradley, J. P. N., & Cole, D. R. (2018). Principles of Transversality in Globalization and Education. Dans J. P. N. Bradley & D. R. Cole (Eds.), Principles of Transversality in Globalization and Education (pp. 1–15). Springer. https://www.academia.edu/37708300/Principles_of_Transversality_in_Globalization_and_Education
-
Burgh, G. (2018). The Need for Philosophy in Promoting Democracy: A Case for Philosophy in the Curriculum. Journal of Philosophy in Schools, 5(1), 38–58. https://doi.org/10.21913/jps.v5i1.1483
-
Chávez Leyva, Y., & Reed-Sandoval, A. (2016). Philosophy for Children and the Legacy of Anti-Mexican Discrimination in El Paso Schools. APA Newsletter on Hispanic/Latino Issues in Philosophy, 16, 17–22.
-
Chetty, D. (2014). The Elephant in the Room: Picturebooks, Philosophy for Children, and Racism. Childhood and Philosophy, 10(19).
-
Chetty, D. (2018). Racism as Reasonableness: Philosophy for Children and the Gated Community of Inquiry. Ethics and Education, 13(1), 39–54. https://doi.org/10.1080/17449642.2018.1430933
-
Dewey, J. (1946). The Public and Its Problems: An Essay in Political Inquiry. Gateway Books.
-
Dewey, J. (2001). Democracy and Education. The Pennsylvania State University. https://nsee.memberclicks.net/assets/docs/KnowledgeCenter/BuildingExpEduc/BooksReports/10.%20democracy%20and%20education%20by%20dewey.pdf
-
Dotson, K. (2012). How is This Paper Philosophy? Comparative Philosophy: An International Journal of Constructive Engagement of Distinct Approaches toward World Philosophy, 3(1). https://doi.org/10.31979/2151-6014(2012).030105
-
Elicor, P. P. E. (2020). Mapping Identity Prejudice: Locations of Epistemic Injustice in Philosophy for/with Children. Childhood and Philosophy, 16(1), 1–25. https://doi.org/10.12957/childphilo.2020.47899
-
Glissant, É. (2009). Poetics of Relation. University of Michigan Press.
-
Guattari, F. (1984). Molecular Revolution: Psychiatry And Politics. Penguin.
-
Hegel, G. W. F. (2005). Philosophy of Right (S. W. Dyde, Trans.). Courier Corporation.
-
Hélot, C. (2012). Linguistic diversity and education. Dans C. McKinney, P. Makoe, & V. Zavala (Eds.), The Routledge Handbook of Multilingualism (pp. 214–231). Routledge.
-
Kennedy, D. (2012). Lipman, Dewey, and the Community of Philosophical Inquiry. Education and Culture, 28(2), 36–53.
-
Kennedy, D. (2022). Schooling the New Sensibility: Communal Philosophical Dialogue, Play, and Social Democracy. Dans A. Koubova, P. Urban, M. Maclean, & W. Russell (Eds.), Play and Democracy: Philosophical Perspectives (pp. 191–206). Routledge. https://doi.org/10.4324/978100312289
-
Kennedy, D. K. (2023). Schooling, Community of Philosophical Inquiry and a New Sensibility. Childhood and Philosophy, 19(n/a), 01–21. https://doi.org/10.12957/childphilo.2023.74061
-
Kennedy, D., & Kohan, W. O. (2021). Some ethical implications of practicing philosophy with children and adults. Childhood & Philosophy, 17, 01–16. https://doi.org/10.12957/childphilo.2021.61025
-
Kennedy, N., & Kennedy, D. (2011). Community of Philosophical Inquiry as a Discursive Structure, and its Role in School Curriculum Design. Journal of Philosophy of Education, 45(2), 265–283. https://doi.org/10.1111/j.1467-9752.2011.00793.x
-
Levinas, E. (1969). Totality and Infinity (A. Lingis, Trans.). Martinus Nijhoff Publishers.
-
Levinas, E. (1985). Ethics and Infinity: Conversations with Philippe Nemo (R. A. Cohen, Trans.). XanEdu Publishing, Inc.
-
Lipman, M. (1982). Philosophy for Children. Thinking: The Journal of Philosophy for Children, 3(3–4), 35–44. https://doi.org/10.5840/THINKING1982339
-
Lo, J. (2017). Empowering Young People through Conflict and Conciliation: Attending to the Political and Agonism in Democratic Education. Democracy & Education, 25(1). https://democracyeducationjournal.org/home/vol25/iss1/2
-
Lugones, M. (1994). Purity, Impurity, and Separation. Signs, 19(2), 458–479.
-
Mouffe, C. (1999). Deliberative Democracy or Agonistic Pluralism? Social Research, 66(3), 745–758.
-
Mouffe, C. (2000). The Democratic Paradox. Verso.
-
Muega, M. A. G., & Acido-Muega, M. B. (2023). The Role of Philosophy in Democratic Education. Dans M. A. V. Mancenido-Bolaños, C. J. P. Alvarez-Abarejo, & L. P. Marquez (Eds.), Cultivating Reasonableness in Education (Vol. 17, pp. 3–20). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4198-8_1
-
Naji, S. (2013). Recent Interviews with Philosophy For Children (P4C) Scholars and Practitioners. Childhood and Philosophy, 9(17), 153–170.
-
Rainville, N. (2001). Philosophy for Children in Native America: A Post-Colonial Critique. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 21(1), 65–77.
-
Reed-Sandoval, A. (2014a). Cross-Cultural Exploration in the P4C Classroom. Teaching Ethics, 14(2), 77–90. https://doi.org/10.5840/tej20141426
-
Reed-Sandoval, A. (2014b). The Oaxaca Philosophy for Children Initiative as Place-Based Philosophy: Why Context Matters in Philosophy for Children.
-
Reed-Sandoval, A. (2019). Can Philosophy for Children Contribute to Decolonization? Precollege Philosophy and Public Practice, 1, 27–41. https://doi.org/10.5840/P4201811284
-
Reed-Sandoval, A., & Sykes, A. C. (2016). Who talks? Who listens? Taking ‘positionality’ seriously in Philosophy for Children. Dans The Routledge International Handbook of Philosophy for Children. Routledge.
-
Rosas, E. P. (2023). U.S. Americanization in Puerto Rico’s Public Schools: Proposing Children’s Self-Organization for Decoloniality Through Photovoice and Philosophy for/with Children. Analytic Teaching and Philosophical Praxis, 43(2), Article 2.
-
Roskamm, N. (2015). On the other side of “agonism”: “The enemy,” the “outside,” and the role of antagonism. Planning Theory, 14(4), 384–403. https://doi.org/10.1177/1473095214533959
-
Roucau, B. (2023). Learning to Navigate Disagreement in Democratic Education: The Potential of the Agonistic Community of Philosophical Inquiry. Dans M. A. V. Mancenido-Bolaños, C. J. P. Alvarez-Abarejo, & L. P. Marquez (Eds.), Cultivating Reasonableness in Education (Vol. 17, pp. 21–38). Springer Nature Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-4198-8_2
-
Rummens, S. (2009). Democracy as a Non‐Hegemonic Struggle? Disambiguating Chantal Mouffe’s Agonistic Model of Politics. Constellations, 16(3), 377–391. https://doi.org/10.1111/j.1467-8675.2009.00548.x
-
Tryggvason, Á. (2019). How to End a Discussion: Consensus or Hegemony? A Response to “Education for Deliberative Democracy and the Aim of Consensus.” Democracy & Education, 27(2). https://democracyeducationjournal.org/home/vol27/iss2/5