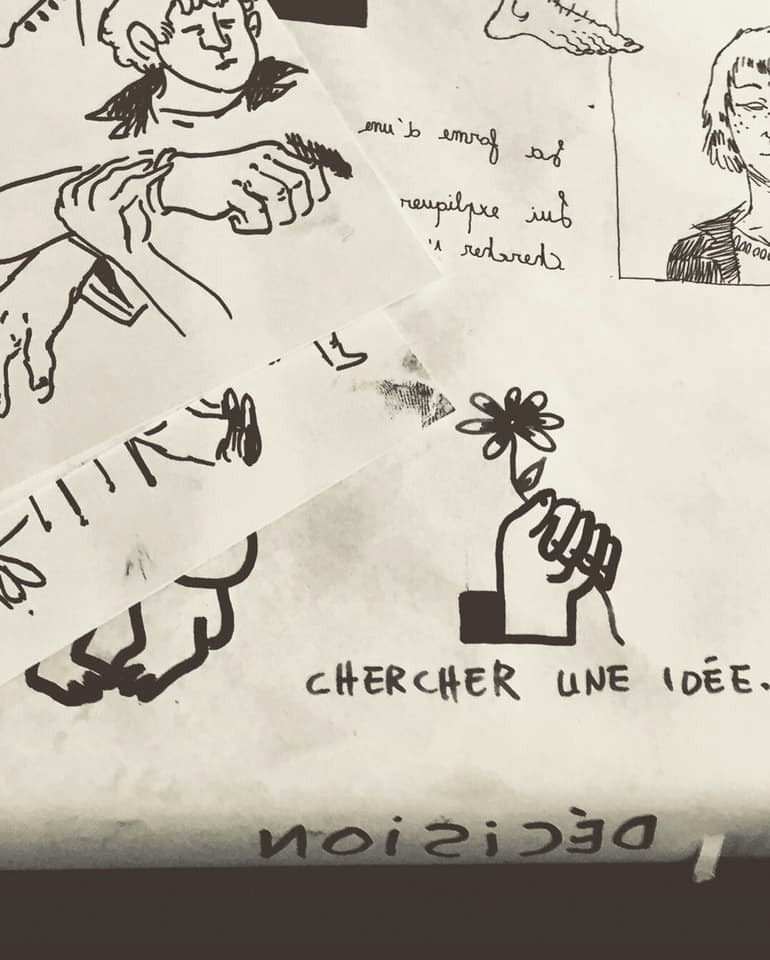Si l’invention technique constitue une manifestation de l’inventivité de la vie, comme le soutient Simondon (1958), alors elle s’enracine dans l’activité vitale de l’élève et le rapport qu’il cultive à son milieu. Celui-ci se caractérise par une réalité technique qu’il s’agit de saisir dans sa signification, par « une compréhension des fonctions techniques pensées sous l’aspect de l’universalité » (Simondon, 1958, p. 101). Or, comment susciter chez les élèves une forme de logos de la technique, c’est-à-dire un symbolisme qui soit commun à la machine et à l’homme ? Les terminales générales et technologiques du lycée Senghor d’Évreux Normandie interrogent les techniques contemporaines à partir d’un dispositif technique (la radio), en réalisant plusieurs podcasts mettant en scène des débats vivants fondés sur une solide recherche préalable et une argumentation philosophique nuancée.
Par groupes de trois ou quatre, les élèves débutent une recherche documentaire, scientifique et philosophique avec une attention portée sur les techniques contemporaines, avant de prendre le recul propre à en saisir les enjeux. L’enjeu de cette contribution consiste à analyser des outils, ici une webradio, et méthodes existant dans les pratiques philosophiques afin d’en matérialiser la visée émancipatrice. Dans quelles mesures la conception de podcasts radiophoniques relève-t-elle d’une pratique philosophique émancipatrice, en tant que libératrice de l’asservissement des humains eu égard à leur environnement technique ? Pourquoi rend-elle possible la conscientisation, d’une part des rapports internes à une technique (la genèse d’une émission radiophonique) et d’autre part des rapports externes au milieu de vie, traversé des techniques contemporaines ?
Interroger les techniques à travers la participation à une expérience technique
Dans le cadre de l’étude de la notion « la technique » au programme de philosophie de Terminale, les élèves des séries générales et technologiques participent au projet « Podcasts philo’ des techniques » dans lequel ils sont amenés à travailler en groupe pour produire de A à Z un podcast de quelques minutes, en bénéficiant de l’accompagnement de leur professeur de philosophie et d’un professeur documentaliste. Les podcasts traitent chacun d’un objet technique, d’un dispositif technique, d’une filière technique ou d’une pratique technique, nouveau ou à venir qui fait l’actualité ou qui est l’objet de débats dans les médias ; les élèves conduisent une réflexion problématisée et argumentée sur les enjeux philosophiques (éthiques, épistémologiques et/ou métaphysiques) liés à son développement.
Principes et enjeux
Les podcasts ne doivent pas seulement s’en tenir à une réflexion sur le bon ou mauvais usage d’une technique (suivant la thèse de la neutralité axiologique des techniques), mais interroger la manière dont le développement d’une technique peut transformer l’expérience humaine, la nature et le monde social en prenant en compte une multiplicité de facteurs (analyse de valeur) qui ont toute leur importance dans la réflexion philosophique dont elle peut être l’objet : inscription sociale et culturelle, demandes et effets politiques, fonction d’usage, fonction de signe, fonctionnement technique, mode de conception et de production (cycle de vie), modèle économique de commercialisation, usages, appropriations, détournements et réemplois. Étant donné que les enjeux philosophiques que développe le podcast ont partie liée avec ces facteurs, il est préconisé que la première partie du podcast rappelle le fonctionnement de la technique en question et contextualise son développement passé, actuel ou à venir. Les « podcasts philo’ des techniques » constituent une production finale notée. Ils sont diffusés publiquement par Radio Senghor, la webradio scolaire du lycée. À travers cette réflexion, la quasi-totalité des perspectives (« l’existence humaine et la culture », « la morale et la politique » et « la connaissance ») et des notions (notamment : le travail, la science, l’État, la liberté, le temps, l’art, la justice, le devoir, le bonheur, le langage, la conscience, la raison) du programme de philosophie peuvent être abordées. Parmi les auteurs au programme, sont facilement mobilisables les suivants : Platon, Aristote, Bacon, Descartes, Diderot, Smith, Kant, Comte, Marx, Bergson, Weber, Mauss, Bachelard, Heidegger, Benjamin, Jonas, Arendt, Lévi-Strauss, Weil, Simondon.
S’orienter dans les recherches
Les grandes lignes où s’acheminent les réflexions des élèves sont proposées à partir des thématiques suivantes, au croisement des sciences de l’ingénieur, de la biologie, de la géologie et des philosophies de la nature et des techniques :
-
Géoingénierie (techniques de modification du climat) :
- Le nucléaire (risques, décarbonation de l’électricité, les coûts cachés, des déchets radioactifs pour les générations futurs).
- Les énergies renouvelables (électricité verte, éoliennes, panneaux solaires, etc.)
- Les énergies fossiles (prospection, fractures hydrauliques, pic pétrolier, etc.).
- Le moteur à hydrogène : ressorts d’une promesse technologique.
-
Géoingénierie (techniques de modification du climat) :
- Captage et stockage du dioxyde de carbone.
- Contrôle du rayonnement solaire (éclaircissement des nuages).
-
Transports, aménagements du territoire, urbanisme, surconsommation et pollution :
- Transports de demain (individuel ou collectif).
- Voiture autonome (responsabilité en cas d’accident).
-
Informatique, numérique, techniques de l’information et de la communication, économies des plateformes et économie de l’attention :
- GAFAM : Google (Alphabet), Apple, Facebook (Meta), Amazon et Microsoft.
- La collecte des données personnelles et leurs utilisations (protection des données personnelles, ciblage publicitaire, surveillance politique).
-
Biotechnologie :
- « Bébé sur mesure » (eugénisme, sélection artificielle ou naturelle).
- GPA/ PMA.
- Techniques contraceptives et charge mentale.
- Transition de genre.
- Euthanasie.
- Tatouages, piercing et customisation du corps.
-
Intelligence artificielle :
- Histoire de l’IA : des premiers ordinateurs à Chat-GPT.
- L’IA au quotidien.
Loin d’un catalogue ou d’un décalogue, ces sujets constituent des instanciations variées de ces liens équivoques et problématiques qui existent entre l’humain, la technique et la nature. Ce sont bien ces rapports dynamiques, métamorphiques, qui définissent leurs racines communes. Aussi, il ne s’agit pas tant de tomber dans l’éclectisme des thématiques possibles en philosophie des techniques, que de penser la relation fondamentale que cette dernière entretient avec les écosystèmes, la biosphère, l’écologie politique, mais aussi avec l’humain en général, pour en penser à la fois les potentialités et les limites.
Inscription du projet dans le curriculum et visées pédagogiques
Il s’agit d’interroger les techniques contemporaines à travers la participation à une expérience technique (la production de contenus radiophoniques) pour ne pas s’arrêter à une connaissance théorique des techniques, mais « aller voir sous le capot » : ouvrir la boîte noire. Éprouver la constitution technique des savoirs et de l’information constitue, elle-même, une hypothèse philosophique au carrefour de la philosophie des techniques et de la philosophie de l’éducation. Par-là, on entend coordonner méthodes pédagogiques et contenus d’enseignement, à partir d’une réciprocité : comprendre pour faire / faire pour comprendre. Mettre en œuvre un apprentissage par la pratique, c’est s’écarter d’une transmission du savoir de type magistral pour privilégier un travail en groupe avec une production finale valorisable. C’est un travail en autonomie et une responsabilisation qui doivent jouer sur la mobilisation, l’implication et la meilleure mémorisation qui en découle.
La première séance donne lieu à présentation des différents types de scénario envisageables pour les podcasts : rôles joués ; reportages, chroniques, débat, interviews ; les pistes pour choisir son sujet. La création pédagogique débute par un balbutiement parsemé de doutes, de zigzags et de retours avant de s’élancer, pour de bon, dans une réalisation riche de sens. Un travail sur la voix, son rythme et sa tonalité, permet d’incarner une pensée vive dans un débat radiophonique modéré ; il s’agit d’allier la fulgurance d’une voix d’élève – à la verve de ses improvisations spéculatives – et un cheminement collectif au cours duquel il faut bien que la discussion avance, faisant volte-face ou traçant une ligne de crête pour éviter que les mots qui prennent leur envol s’affaissent, se perdent dans la trace appauvrie d’une intuition soudaine, que le mot « intuition » ne fait, lui-même, que suggérer. La démarche à l’œuvre dans l’expérience pédagogique de la webradio est à l’image de la marche incommode d’un groupe de randonneurs escaladant un mont ou un volcan : c’est ce cheminement philosophique que les élèves collectivement élaborent.
Entrelacs entre la création pédagogie et la création technique
La réalisation de podcasts par équipe, avec toutes les contraintes techniques qu’elle implique – celles de l’enregistrement dans le studio du lycée – met en scène un jeu de rôles entre un présentateur, qui peut choisir de prendre position ou non, un expert scientifique, voire un intervenant critique auprès d’une commission européenne. La confrontation à la radio des différentes positions philosophiques interroge, par la médiation technique, notre rapport au vivant notamment, par la pluralité contemporaine des manières de donner la vie, in vitro par exemple, ainsi que le rapport à la liberté humaine : sommes-nous devenus esclaves de la prolifération des techniques contemporaines ? Le symbolisme interhumain de la machine permet de coordonner et de mettre en relation les domaines hétérogènes de la culture humaine.
La rencontre entre la vie et la pensée
La culture technique, en tant qu’elle est « technologie réflexive », n’est pas un autre domaine de la culture, à côté des lettres et des sciences, mais une redécouverte de la réalité humaine dans son rapport avec son milieu qui transcende et intègre les savoirs humains les plus hétéroclites. En tant que ces savoirs sont intellectuellement coordonnés dans le fonctionnement de l’objet technique, la culture technique devient un « art de compromis » qui préside à la création pédagogique. La culture technique des élèves est le milieu de la rencontre entre la vie et la pensée et constitue à ce titre une voie d’accès au monde symbolique caractéristique de la réflexivité.
Outre cette dimension réflexive à cheval entre la vie et la pensée, l’expérience constitutive de la réalisation d’une webradio n’est pas seulement l’articulation entre les savoirs, mais également une symphonie à trois ou quatre voix. Les élèves au cours de l’enregistrement se questionnent, s’interpellent et se répondent. Malgré les coupures possibles effectuées au montage, il a fallu pour certains groupes recommencer l’enregistrement encore et encore ; l’on constate chez des élèves anxieux une forme de honte liée à leur voix, au fait qu’elle soit captée, enregistrée, au risque qu’elle fasse dissonance. L’enregistrement parfois est entrecoupé d’un éclat de rire, d’un mot inopiné qui fuse ou d’une prononciation burlesque, ce qui situe cette expérience pédagogique à mi-chemin entre la légèreté et le sérieux.
Sa portée est double : en tant que réalisation commune d’une webradio à l’échelle d’un lycée, la voix, parce qu’elle constitue la dimension de la conscience intime de l’élève en concert et en concertation avec les participants de l’équipe, se trouve comme captée, presque captive du dispositif technique, à jamais enclose dans la radio, qui peut ad infinitum en reproduire l’écho. Le deuxième enjeu est social : ce qui est dit et la manière de le dire peuvent donner lieu à jugements, railleries et commentaires désagréables de la part des camarades ; il y a donc à l’endroit des pairs une question d’image, que l’on ne trouve dans une telle proportion, ni dans un examen écrit dont le seul destinataire est le correcteur, ni dans un examen oral où ce qui se joue se trouve circonscrit au lieu et au temps de l’épreuve.
Inventivité technique et inventivité technologique
L’activité technique que l’on observe chez l’enfant puis chez l’adolescent dès le plus jeune âge est antérieure à toute compréhension théorique ; elle précède ainsi tout savoir rationnel et ne fait l’objet que d’une simple connaissance intuitive de la part de l’enfant. En ce sens, l’activité technique est le fait d’un vivant qui s’explore, se lie aux autres et traverse grâce à elle un milieu de vie donné. La technique ne désigne donc pas seulement une relation d’usage entre un humain et un objet, mais également une forme d’accord ou de débat entre l’activité technique d’un vivant d’une part, et les contraintes du milieu d’autre part. Les techniques contribuent alors à individualiser le monde dans lequel se trouve l’humain : en effet, le monde, par l’invention technique, est posé comme monde individué sur fond duquel se rencontre la main créatrice de l’humain et les caractéristiques du milieu, comme la résistance de la matière.
Or l’invention technique est elle-même une manifestation de l’inventivité de la vie, elle s’enracine dans l’activité vitale de l’enfant et le rapport à son milieu de vie : la réflexion que le jeune porte sur les choses consiste ainsi non pas dans une opération logique indépendante de son milieu de vie, mais implique précisément une genèse vitale de l’activité de l’esprit, qui a une origine non spirituelle et naît justement de ce débat avec le milieu extérieur. La technique crée un milieu associé de la vie et de la pensée, c’est-à-dire entre la sphère proprement vitale et la dimension scientifique, à savoir la réflexivité. Comment penser en conséquence le rapport entre culture technique et réflexivité ?
La culture technique des élèves consiste non pas dans une maîtrise des outils subordonnées aux finalités humaines, ni dans un formalisme abstrait de tout milieu de vie, mais dans cette inventivité technique qui s’établit sur l’activité vitale de l’enfant, elle désigne en ce sens le jeu de causalité récurrent chez l’humain, entre vie et pensée (Simondon, 1958). Elle possède ainsi une fonction médiatrice, entre la dimension de la vie, et la pensée formelle qui caractérise la réflexivité. La culture technique n’est donc plus uniquement du côté de la vie, mais dans la relation et la rencontre entre l’activité symbolique et l’activité vitale : elle devient le milieu intermédiaire entre la vie et la réflexivité. C’est donc moins la réflexivité comme opération logique, qui ouvre l’accès à la culture considérée comme monde de symboles, que la culture technique elle-même, par son statut médiateur, qui constitue la voie d’accès à la réflexivité. Il nous faut toutefois préciser et démontrer cet aspect. L’enfant en effet, inscrit dans l’immanence du vivant, se caractérise à l’égard des objets techniques par une subjectivité non pas percevante – ou pas strictement percevante – mais avant tout usageante, fondée sur la praxis : or, la complexité des objets techniques se traduit par une insuffisance de la perception devant le matériau sensible et appelle ainsi une spiritualisation par les formes symboliques de la réalité technique, une prise de distance à son égard. L’enfant, a fortiori les adolescents opèrent au fur et à mesure une prise symbolique de la réalité qui fait intervenir la possibilité d’une invention technique : c’est la vie elle-même qui fait culture, et suppose que par-delà la posture simplement perceptive du jeune homme ou de la jeune femme, les objets techniques – dont les machines – deviennent, eux-mêmes, des faits culturels. Les adolescents accèdent à une posture transformatrice du milieu par la médiation d’une activité créatrice, tant pédagogique que technique, à l’épreuve de l’activité vitale elle-même. La culture technique est la zone médiatrice entre l’activité vitale de l’enfant et la pensée symbolique par lequel se déploie le monde des significations, celui de la réflexivité.
Création pédagogique et technique : du symbolisme à la réflexivité
La culture technique, loin de désigner une science particulière appliquée au domaine de la technique, caractérise une prise de conscience de la réalité technique, qui n’est pas un point de vue abstrait porté sur les machines, mais le fait même de saisir cette réalité dans sa signification. Cette conscience de la nature des machines consiste alors non seulement à connaître leurs relations mutuelles et leurs relations avec l’humain, mais aussi la valeur impliquée dans ces relations : c’est donc à ce titre que la technique peut revêtir un caractère véritablement culturel, qui excède la simple culture littéraire ou scientifique – toujours partielle parce qu’excluant les machines – et devient par conséquent le symbolisme universel propre de ce nouvel encyclopédisme. Ce symbolisme interhumain de la machine permet ainsi de coordonner et de mettre en relation tous les domaines de la culture humaine. La culture technique n’est donc pas un autre domaine de la culture, à côté des lettres et des sciences, mais une redécouverte de la réalité humaine dans son rapport avec son milieu qui transcende et intègre les savoirs humains les plus hétéroclites.
Cette mise en relation des savoirs hétérogènes permettant une systématisation des concepts scientifiques, implique un autre ordre de réalité qui transcende ces savoirs particuliers : celui de la réflexivité. La réflexivité en effet, par la structure de redoublement qui la caractérise, permet de s’affranchir des structures conceptuelles de chaque science jusqu’à parvenir au point de contact, au point de rencontre entre les sciences. Ainsi, elle ne constitue nullement une structure conceptuelle plus générale qui ouvrirait à un monde stable composé de symboles, mais ce qui précisément permet la relation entre les structures conceptuelles, en ce qu’elle rend possible une connexion entre les différentes strates du savoir. La réflexivité cesse ainsi d’être une superstructure de la connaissance caractérisée par des opérations purement logiques et définie indépendamment de la vie, pour devenir une science des relations et des rapports entres les structures du savoir. Et c’est précisément cette relation, permettant de trouver au sein des techniques des opérations véritablement universelles, qui exhibe le sens et la valeur de l’humain et des techniques. Cette signification prend alors racine dans cette mise en relation entre l’humain et son milieu que permet la réflexivité, au sein d’un encyclopédisme technique qui correspond au système universel des concepts scientifiques reliés entre eux. La culture technique n’est donc ni une science de l’ingénieur, ni le développement de l’habileté de l’ouvrier, mais une prise de conscience de la réalité technique par la découverte d’opérations internes dans les objets techniques, permettant l’éclosion d’un symbolisme universel, interhumain et interscientifique, c’est-à-dire d’un encyclopédisme technique ; et la réflexivité est l’opérateur qui, au sein de cet encyclopédisme, permet la mise en relation entre les savoirs hétérogènes.
Ainsi, nous pouvons conclure : la culture technique est par essence réflexive, en ce sens que la connexion entre les savoirs est constitutive de cette conscience universelle des réalités techniques conçue comme encyclopédiques. L’enjeu reste alors d’interroger cette relation entre la notion de culture technique et le concept de réflexivité – permettant l’intercommunication des sciences constitutive d’une culture totale et universelle. Comment la culture technique, en tant qu’encyclopédisme et à titre de totalisation réflexive de l’ensemble des savoirs, permet-elle de saisir le potentiel d’évolution humaine et de transformer le social par l’invention technique dans son déploiement ?
La webradio comme mécanologie : l’unité interdisciplinaire des sciences
La technologie réflexive, ou mécanologie, consiste à étudier la genèse des objets techniques de laquelle résulte une vraie connaissance de la technicité, caractérisant le nouvel encyclopédisme que définit Simondon (1958). La méthode qui permet de suivre l’être dans sa genèse, consiste dans une transduction, c’est-à-dire dans une herméneutique génétique de l’objet technologique permettant de rendre compte de son ontogenèse. Cette appréhension de la genèse implique une réorganisation de la réalité selon différentes phases. Qu’est-ce à dire ? Cela signifie que tout comme le social, l’objet technique n’est pas un donné, mais il est construit à partir des données historiques. Appréhender l’objet dans sa genèse consiste à le ressaisir dans les différentes phases de cette construction, c’est-à-dire dans son individualisation progressive qui va rendre possible une coordination de sa relation interne et de sa relation au milieu. C’est ce processus d’individualisation de l’objet technique qui définit ce que Simondon (1958) appelle la concrétisation, c’est-à-dire le processus dans lequel la systématique interne de l’objet technique s’ouvre en intégrant des objets techniques extérieurs. Ce processus de concrétisation implique une indépendance à l’égard du processus de production lui-même, par la mise en relation de l’objet avec un milieu associé : l’objet technique régule ses propres conditions de fonctionnement grâce au milieu, par analogie avec l’organisme. Par cette autonomie, l’objet technique prend une signification proprement technologique : sa valeur réside précisément dans ce mode de présence spécifique au milieu, comme condition de maintien dans l’existence et de la régulation de son fonctionnement. Ainsi, la culture technique comme technologie réflexive consiste non pas à connaître des objets techniques individués, mais des processus d’individuation : il s’agit donc de partir non d’une réalité constituée, mais de la réalité du devenir comme processus. Il n’y a donc jamais rapport à de l’individu à proprement parler, mais à du transindividuel.
Concrétisation et relation transindividuelle
Le transindividuel ne pense pas les relations et les opérations internes au sein des parties d’une machine, ni la relation de l’objet technique au milieu extérieur, mais la relation même entre ces deux relations : elle qualifie ainsi une relation transindividuelle en tant que relation de relations. La culture technique comme technologie réflexive consiste ainsi dans une prise de conscience des modes d’existence des objets techniques, c’est-à-dire de leur processus d’individuation rendant compatible la relation interne et la relation au monde extérieur dans lequel l’objet fonctionne, ainsi que l’unité transindividuelle de ces deux relations. Aussi, la réflexivité des élèves peut s’entendre sous un double rapport : non seulement comme une mise en rapport des parties internes de l’objet ainsi que sa connexion avec le milieu de fonctionnement, qui définit son mode de présence à la réalité extérieure ; mais également comme structure de redoublement ultime comprise comme cette relation transindividuelle entre ces deux relations elles-mêmes. À cet égard, la culture technique est bien universelle, elle permet d’unifier des disciplines comme la psychologie (relation interne au psychisme), la biologie (relation au milieu), la sociologie (relation au social). C’est en ce sens et en tant que technologie réflexive, que la culture technique, loin d’être un simple développement de l’habileté quant aux usages ou un nouveau symbolisme abstrait de la réalité technique, constitue l’unité fondamentale des sciences : que ce soit les œuvres d’art ou les théorèmes mathématiques, il s’agit de les appréhender dans leur genèse et dans leur processus d’individuation, qui exhibe à la fois leur sens et leur valeur. Il n’existe ainsi de véritable culture technique que comme impliquant une réflexivité qui lui est absolument constitutive.
En philosophe des techniques et professeur documentaliste coorganisateur du projet PodÉduc de Radio Senghor au lycée Léopold Senghor d’Évreux, Timothée Deldicque (2020, p. 94) pose le paradoxe suivant : « il n’est pas possible d’effectuer une mise en science des techniques, sauf à manquer leur spécificité, les réduire à des moyens et des applications et reconduire une conception instrumentale, neutre et déterministe des techniques ». Comment la pratique pédagogique d’une conception raisonnée de podcasts philosophiques peut-elle éviter l’écueil d’une instrumentalisation de la radio considérée comme interface, moyen, truchement ?
De la voix à la main : la dimension pédagogique du dessin technique
Pour saisir la valeur du dispositif technique et sa créativité intrinsèque, l’auteur propose à la fin de l’enregistrement des podcasts une solution pédagogique aux élèves, consistant à réaliser le dessin technique de la radio avec ses connexions, ses interrupteurs, ses schèmes : « comme la langue universelle des techniques, le dessin [technique] rend possible une abstraction concrète des techniques qui ne se rabat pas sur la formalisation théorique analytique propre à l’enseignement secondaire et supérieur » (Deldicque, 2020, p. 95).
En appréhendant l’objet technique dans sa genèse, qui se retrouve aussi dans le dessin technique comme processus, création de prototypes, esquisses et schémas, mais aussi représentation artistique d’une technique, l’élève prend conscience de ce que les machines contiennent d’humain, ainsi que des relations techniques, voire artistiques qui existent entre toute chose, on réalise cette grande unité du savoir qui rend possible une systématisation des concepts scientifiques et une mise en relation entre les sciences et les techniques. La réflexivité confère ainsi à la culture technique son statut d’universalité. Mais allons plus loin : et considérons jusqu’au bout les conséquences de cet humanisme technologique qui s’incarne dans la culture technique. La réflexivité donne à la culture technique sa dimension libératrice : par l’encyclopédisme technologique, le social lui-même devient l’objet d’une construction organisatrice des finalités. Si la culture technique consiste à saisir toute réalité comme processuelle, c’est-à-dire comme étant toujours en devenir, la théorie de l’information sur laquelle se base la culture technique devient elle-même régulatrice du social. La société possède tout comme l’homme et l’élève en formation, une nature transindividuelle qui contient la possibilité de son propre dépassement, de sa transformation silencieuse. Si la technologie réflexive permet d’appréhender chaque chose dans sa genèse, dans sa construction continue et dans son devenir, la culture technique permet de saisir le potentiel d’évolution humaine inhérent aux technologies industrielles (Xavier Guchet, 2010). Pour l’élève en train de se cultiver, la technologie réflexive vise à se déprendre des contraintes sociales et des pouvoirs conjurés qui pèsent sur lui, grâce à l’invention artistique, oratoire, pédagogique.
Une pratique philosophique transformatrice des élèves
La culture technique s’associe à la pratique philosophique pour insérer, progressivement, le social dans l’ordre de la succession, de son évolution et de son devenir. En effet, le social, comme milieu où vivent notamment les élèves comme le professeur, n’est jamais une réalité constitué, une organisation figée qui viendrait enfermer l’homme dans des structures, mais toujours processuel, ce qui ouvre la possibilité d’une réorganisation consciente et permanente du social. La pratique pédagogique de conception d’une webradio philosophique relève ainsi d’une dimension constitutive de la culture technique, non seulement par l’universalité qu’elle lui confère, mais également par le caractère éminemment libérateur qu’elle lui assigne. La création pédagogique, enfin, survit au temps qui passe : les élèves dans dix ou vingt ans pourront réécouter leurs réflexions, leur voix d’antan ainsi que celle de leurs camarades, pour se replonger non pas tant dans les souvenirs, que dans leur élaboration philosophique adolescente et balbutiante.
Enfin, il s’agit de diffuser de vive voix leur cheminement philosophique à travers un dispositif qui, par sa puissance d’ouverture, dépasse le seul cadre institutionnel : la webradio du lycée Senghor et sa contribution à la vie des idées à Évreux et plus largement en Normandie. C’est une manière de faire jaillir la philosophie hors des murs, partant des recherches silencieuses au CDI à la réalisation collective des podcasts en studio, jusqu’au montage puis l’émission en dehors de toute limite spatiale. La création pédagogique décloisonne en tant qu’elle est maturation, lente et progressive ; éclosion puis fleurissement, la pratique philosophique se veut d’abord locale mais déborde de son cadre, toujours en excès, pour susciter une pépinière de réflexions juvéniles sur les thématiques et problématiques d’un monde incertain. La pratique, tant pédagogique que philosophique, s’avère fondamentalement transformatrice des élèves en recherche parce qu’elle a trait aux transformations techniques à l’œuvre dans le monde contemporain. Créer des podcasts en équipe, ce n’est pas figer une réflexion dans une émission de radio, mais se créer soi-même en tant que citoyen d’un monde processuel ; c’est un repositionnement, une réélaboration de soi – mais aussi d’une génération de lycéens – qui fait fond sur un bouleversement technique accéléré, dont les élèves gagneraient à devenir non seulement les praticiens éclairés, mais aussi les penseurs, les créateurs voire les régulateurs.
- Deldicque, T. (2020). Penser la technologie par-delà l’opposition entre « science pure » et « science appliquée ». Philosophique. Hors-Série.
- Guchet, X. (2010). Pour un Humanisme technologique. PUF.
- Hedjerassi, N. (2016). Les pédagogies émancipatrices. Editions du Croquant.
- Simondon, G. (1958). Du mode d’existence des objets techniques. Flammarion.
- Simondon, G. (1954). Prolégomènes à une refonte de l’enseignement. Sur la technique. PUF.
1. Versions finales des productions des élèves, après montage :
Terminales G4 : https://mega.nz/folder/3aIlWA5B#TAbYJ_GcYZR4Ix8kRr_iQw
Terminales ST2S1 : https://mega.nz/folder/rfoy2TKQ#1Qu_DzqyABGG8017WFjw-g
Terminales Biotech : https://mega.nz/folder/TSwzVIyD#-YfaWoDgGyAZ_SqOr0vZhg
2. Écriture radiophonique au brouillon d’un groupe de quatre élèves de TBiotech :
[Générique d’introduction]
Angelina (animatrice) : Bonjour et bienvenue dans “Débat Sans Filtre !”, l’émission où l’on explore les grands sujets de société avec un regard sans concession ! Aujourd’hui, nous parlons d’un sujet fascinant mais controversé : les bébés sur mesure. Modifier l’ADN d’un enfant avant même sa naissance, est-ce un progrès ou une dérive ? Ce débat soulève de nombreuses questions sur l’éthique, la médecine et l’avenir de l’humanité.
Angelina : Pour en discuter, j’ai avec moi Théo, Manon, et un invité spécial, le docteur Jeffrey Steinberg, qui dirige une clinique spécialisée dans la sélection des embryons.
Angelina : D’abord, un petit rappel pour nos auditeurs : les bébés sur mesure reposent sur deux technologies principales : le diagnostic préimplantatoire, qui permet de choisir des embryons en fonction de critères médicaux, et l’édition génétique, comme CRISPR-Cas9, qui modifie l’ADN directement. Cela offre des possibilités de prévention contre des maladies, mais pose aussi des questions éthiques cruciales.
Angelina : Théo, toi, tu as des réticences sur cette avancée. Pourquoi ça te dérange ?
Théo : Salut ! Franchement, l’idée qu’on puisse “choisir” les caractéristiques d’un enfant, me met mal à l’aise. On parle de créer des bébés comme des produits. On risque de tomber dans un monde où l’on perd toute forme de diversité humaine.
Manon : Moi, je vois cet aspect comme une avancée. Si on peut éviter des maladies graves, pourquoi ne pas l’utiliser ? On cherche toujours à améliorer la qualité de vie !
Angelina : Effectivement, le débat est intéressant. Et Docteur Steinberg, vous êtes en première ligne de ce progrès. Comment justifiez-vous cette pratique ?
Mohamed (Jeffrey Steinberg) : Bonjour à tous ! Eh bien, nous croyons qu’il est important de donner aux parents le pouvoir de protéger leurs enfants dès la naissance. Nous offrons des solutions pour éviter certaines maladies génétiques et permettre un avenir plus sain pour les générations futures.
Angelina : Mais à quel point ne risque-t-on pas de créer une société de “bébés parfaits”, avec une sélection qui se fait sur des critères esthétiques ou intellectuels, au lieu de se limiter à des maladies graves ?
Théo : Oui, c’est ce point qui me trouble ! On commence avec des maladies génétiques, mais qu’est-ce qui nous arrête ensuite ? La couleur des yeux, l’intelligence, la personnalité ? Cela devient très vite un terrain glissant.
Manon : Mais là, Théo, on parle de sauver des vies, pas de rendre les gens “parfaits”. Si on peut éviter la souffrance, pourquoi ne pas le faire ? On améliore déjà des capacités avec la médecine, pourquoi cela devrait être différent avec la génétique ?
Angelina : C’est une question d’équilibre, non ? Docteur Steinberg, en tant qu’expert, comment considérez-vous les risques d’abus ? Est-ce qu’il n’y a pas un danger à faire de la génétique un privilège pour les riches, de creuser encore plus les inégalités ?
Angelina : C’est la fin de ce débat pour aujourd’hui dans « Débat Sans Filtre ! ». Merci à Théo, Manon, et à notre invité, le docteur Steinberg, d’avoir partagé leurs points de vue. On se retrouve bientôt pour une nouvelle discussion sans détour !
[Générique de fin]