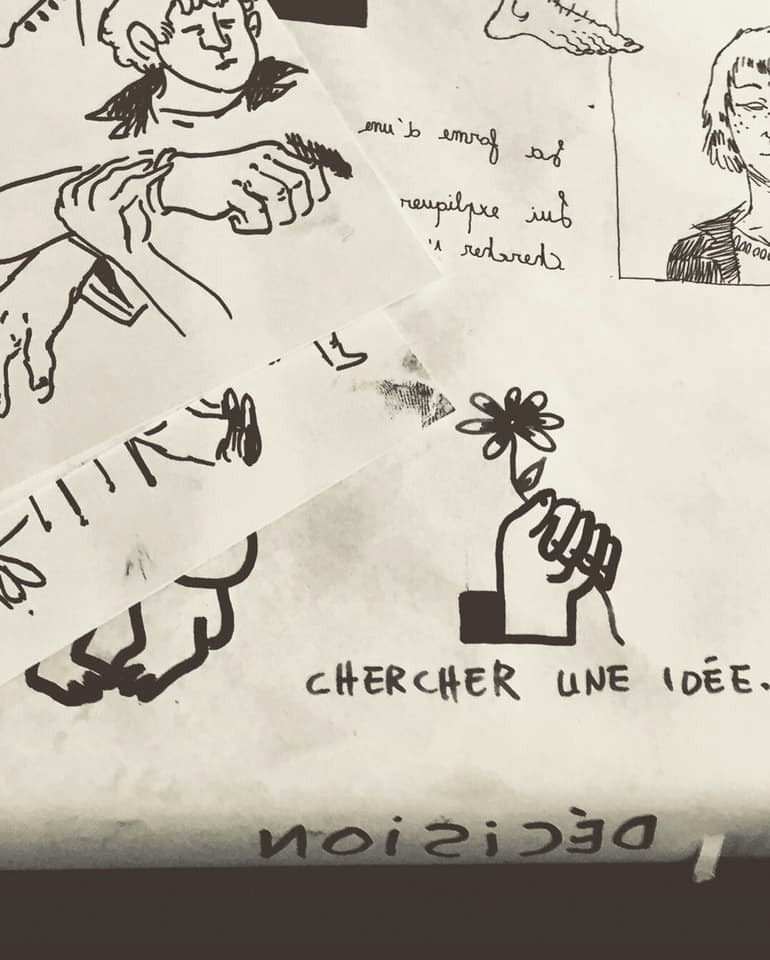Le numéro 97 de la revue Diotime est très particulier car il inaugure deux grandes nouveautés qui font la fierté du comité de rédaction : la création d’une association et un premier numéro thématique.
— D’une part, nous sommes ravi.e.s de vous annoncer la création de l’association “Diotime, Pour la diffusion et l’éclosion des Nouvelles Pratiques Philosophiques”, née d’une assemblée constituante qui s’est tenue à Paris (au siège de l’UNESCO) le 19 novembre 2024 à l’issue des Rencontres Internationales sur les Nouvelles Pratiques Philosophiques. Cette association devenait une nécessité à plusieurs titres : d’une part afin de doter la revue d’une entité morale ; d’autre part pour lui permettre de devenir un véritable outil fédérateur ; enfin (et surtout) en vue d’assurer à la revue une bonne santé financière dans un contexte particulièrement contraint.
En effet, nous ne disposions jusqu’à présent d’aucun modèle économique pérenne et la publication de Diotime reposait sur la seule bonne volonté de quelques bénévoles. Nous remercions la Chaire UNESCO de Philosophie avec les enfants qui a financé les derniers numéros et sans laquelle nous n’existerions déjà plus. Mais aujourd’hui, cela ne suffit plus. Les coûts de production (webdesign) ont fortement augmentés et nous devons trouver a minima deux mille euros par an afin de pouvoir mettre en ligne les deux numéros annuels. C’est pourquoi nous allons faire appel à votre générosité et votre esprit d’engagement en vous proposant de devenir membres. Vous serez invités à chaque assemblée générale et pourrez ainsi participer à la vie de la revue.
Voici comment les statuts ont été publiés au journal officiel (loi 1901) :
L’association Diotime a pour objet la diffusion et l’éclosion des Nouvelles Pratiques Philosophiques par :
- La volonté de faire connaître et fédérer les personnes et les mouvements défendant la philosophie et les pratiques philosophiques, en France et à l’international.
- La défense de la philosophie pour toutes et tous dans le respect de principes fondateurs : une vision démocratique, non-discriminante et non-dominatrice de la philosophie ; une vision didactique exigeante et bienveillante de la philosophie dans la diversité de ses pratiques ; une vision pédagogique fondée sur l’éthique relationnelle et le dialogue.
- L’édition de supports connexes aux Nouvelles pratiques philosophiques dans la revue numérique Diotime. Revue internationale de la didactique et des pratiques de la philosophie.
- La diffusion de supports de communication promouvant les Nouvelles Pratiques Philosophiques (réseaux sociaux, évènements, etc.).
- L’organisation ou co-organisation d’événements scientifiques et de formation (Colloques, Journée Mondiale de la Philosophie, Universités d’été, journées d’études, séminaires de recherche et de formation, …)
Le premier bureau élu est composé de : Michel Tozzi (président), Olivier Blond-Rzewuski (coprésident), Johanna Hawken (secrétaire), Caroline Raffaelly et Christian Budex (trésoriers).
Vous pouvez dores et déjà adhérer sur le site HelloAsso : https://www.helloasso.com/associations/diotime-pour-la-diffusion-et-l-eclosion-des-nouvelles-pratiques-philosophiques/adhesions/adhesions
— D’autre part, nous vous proposons pour la première fois un numéro thématique ayant pour objectif de creuser une question commune grâce aux articles des divers auteurs et autrices. Le thème que nous avions choisi ? Le lien entre pratiques philosophiques et pédagogies critiques. Nous allons donc prendre le temps d’expliciter les raisons de ce choix, avant de présenter les différents articles de ce numéro.
À l’échelle internationale, les Nouvelles Pratiques Philosophiques (NPP) se développent depuis les années 1960 et 1970 à partir d’un mouvement pédagogique et intellectuel revendiquant la démocratisation de la philosophie pour tous les publics (en dehors du lycée et de l’université), mais aussi d’autres formes pédagogiques au sein même des institutions (débats, exercices, pédagogies alternatives, au lycée et à l’université). S’inscrivant donc à contre-courant d’une forme scolaire traditionnelle (Vincent, 1994), les pratiques philosophiques cherchent de nouveaux outils, dispositifs et méthodes afin de rendre la philosophie accessible à toutes et tous, dans la cité : espace public, cafés, bibliothèques, écoles, centres de loisirs, théâtres, cinéma, centres sociaux, etc. Dans ce mouvement de démocratisation de la philosophie, la Philosophie Pour Enfants et Adolescents (PPEA) occupe une place majeure, depuis sa création par Matthew Lipman (2008) et Ann Margaret Sharp (Gregory, Laverty, 2023), dans les années 1970, aux Etats-Unis. En effet, l’Institut for The Advancement of Philosophy For Children (IAPC) peut se revendiquer de 72 centres dédiés à la PPEA dans le monde entier. En Europe et notamment en France et en Belgique, ce mouvement a une influence majeure et se mêle également à d’autres méthodes telles que la Discussion à Visée Démocratique et Philosophique (Tozzi, 2001).
Qu’il s’agisse des pratiques philosophiques avec les enfants, les adolescents ou les adultes, les visées de ces nouvelles activités éducatives sont claires : développer l’esprit critique, l’autonomie intellectuelle, la capacité à penser, à juger et à raisonner, participer à l’émancipation des citoyens et citoyennes (De la Garza, 2023). Penser par soi-même et, surtout, oser penser le monde, tel qu’il est mais aussi tel qu’il pourrait être : tel serait l’horizon des NPP. Ces ambitions d’une teneur toute politique sont loin d’être anodines et se frottent à la réalité des terrains où se mettent en place les pratiques philosophiques avec les enfants, les adolescent.e.s et les adultes. Elles rencontrent également, sur le plan théorique, un autre courant intellectuel : celui des pédagogies critiques et émancipatrices (Freire, 2013, 2021). Ce sont ces deux points de rencontre que nous souhaitons interroger dans ce numéro thématique, grâce à une diversité de voix (celles des chercheur.se.s, des animateur.ices, des enseignant.es, des éducateur.ices, etc.).
En effet, vouloir œuvrer pour l’émancipation des individus, c’est une ambition qui n’est pas dépourvue d’ambiguïtés, car le concept d’émancipation renvoie à différentes acceptions et courants philosophiques. Pour le dire succinctement, nous pourrions dessiner deux grandes tendances qui peuvent entrer en tension. D’un côté, nous percevons une vision de l’émancipation qui se rattache à la tradition des Lumières et notamment aux principes kantiens : dans ce cadre, l’émancipation désigne la capacité à se libérer de tutelles dogmatiques ou religieuses et l’autonomie intellectuelle consisterait à se donner à soi-même des lois rationnelles et à entrer dans le règne émancipateur de la raison. De l’autre côté, le concept d’émancipation a été travaillé différemment par les pédagogies critiques et émancipatrices qui s’inspirent notamment des travaux de Paulo Freire (2013, 2021) et bell hooks à sa suite (2017, 2019). Dans cette perspective, la démarche d’émancipation relève d’une entreprise plus radicale centrée autour de la conscientisation et de la déconstruction des rapports de domination inhérents à la société (notamment capitaliste).
Au fond, il existe une ambiguïté concernant la visée émancipatrice des nouvelles pratiques philosophiques, comme l’atteste la diversité des chercheur.se.s, des pratiques et des praticien.ne.s. Ainsi, de façon paradigmatique, nous pouvons mettre face à face les travaux d’Ann Margaret Sharp, qui défendait une émancipation de type féministe, décoloniale, anti-impérialiste (inspirée de hooks) et le développement d’une “conscience éthique globale” subversive et ceux de Matthew Lipman, qui considère que la faculté de juger doit adopter le critère de la raisonnabilité. Bien que Lipman défende la pensée critique, l’idée de raisonnabilité renvoie à des écueils tels que le conformisme, l’adhésion à la pensée majoritaire ou dominante (Pritchard, 1996, p. 3). Alors que les deux philosophes américains constituaient un binôme particulièrement soudé pour la défense de la PPEA, leurs positionnements sur la question de l’autonomie est typique de la pluralité de sens inhérente à ce concept (comme à tous les concepts d’ailleurs).
En outre, les visées profondément politiques des pratiques philosophiques se frottent également à d’autres enjeux dans leur développement. En particulier, nous pouvons penser aux visées éthiques qui sont également extrêmement importantes, notamment dans la Philosophie pour Enfants et Adolescents : développer l’éthique relationnelle, la pensée attentive et soucieuse de l’autre et de ses idées (le caring thinking : Sharp, 2023), voire la compassion ou l’empathie. En lien avec cette visée morale, un écueil apparaît et entre en tension avec la visée émancipatrice : le projet de pratiquer la philosophie afin de faire des bons citoyens policés et intégrés. Dans les pratiques philosophiques pour adultes, on voit également apparaître des ambitions telles que le bien-être, le bonheur ou le développement personnel (pensons par exemple au succès des conférences de philosophie sur la confiance en soi ou la joie). Ces tendances semblent a priori paradoxales eu égard aux visées émancipatrices. A tout le moins, ces pratiques n’ont pas pour projet principal de questionner la société et ce encore moins de façon radicale. Certaines pratiques s’adressent à des individus et sont ouvertes au public. Mais, les pratiques philosophiques sont également mises en place à l’école et se confrontent alors parfois à des attentes institutionnelles fortes : participer à l’enseignement moral et civique, sensibiliser aux Valeurs de la République, développer la cohésion dans les classes. Concernant les nouvelles pratiques philosophiques dans les lycées et les universités, il peut être compliqué de concilier le cadre universitaire classique ponctué d’examens et la possibilité de mettre en place des pratiques alternatives. Quelle didactique construire au cœur de cette tension entre les engagements de la pédagogie critique et les réalités institutionnelles ? Cette tension est vive, également, en ce qui concerne les conditions matérielles et temporelles d’exercice des NPP : alors qu’un véritable travail d’émancipation exigerait une pratique régulière et progressive, la réalité du terrain amène souvent les praticien.ne.s à devoir travailler dans des séquences beaucoup plus courtes : parvient-on alors à réellement réaliser les ambitions de la pédagogie critique ? Peut-on accepter la demi-mesure dans la perspective de la radicalité ?
Dans la mesure où les nouvelles pratiques philosophiques se réinventent dans la perspective d’une éducation populaire, en s’ouvrant à des lieux ou à des formes non-scolaires, elles sont amenées à repenser la didactique de la philosophie. Ce faisant, de multiples questions se posent : que révèle la didactique classique de la philosophie ? Peut-on imaginer une didactique non-sexiste, décoloniale et émancipée d’une histoire intellectuelle qui serait biaisée ?
Outre la didactique, les NPP parviennent-elles à réinterroger réellement la posture de l’animateur.ice ou de l’enseignante ? Bien qu’un déplacement soit incontestable (dans la mesure où le.a facilitateur.ice vise à construire un dialogue et un espace de parole partagé), les participant.e.s sont-ils finalement acteur.ice.s de leur émancipation ? Ou en reste-t-on à une structure pédagogique où le.a facilitateur.ice reste un guide ultime et une figure finalement dominante ? Si le.a facilitateur.ice se donne pour tâche d’émanciper les autres, n’est-ce pas d’ores et déjà une posture asymétrique et contradictoire ?
Quel est donc l’enjeu de la démocratisation de la philosophie ? L’empowerment ? L’agentivité ? Le conformisme ? Le vivre-ensemble ? L’intégration de chacun et chacune dans les modes de pensée dominants ? Comment concilier une vision radicale de l’émancipation et les cadres institutionnels qui s’en méfient ? Faut-il les concilier et cheminer sur une ligne de crête ? Est-ce raisonnable d’espérer que les institutions rattachées à l’Etat souhaitent développer des pratiques philosophiques radicales et critiques ? Autrement dit, l’Etat a-t-il intérêt à ce que les citoyen.ne.s soient radicalement critiques ?
Présentation des articles du numéro 97
Nous n’avons pas pu traiter de façon exhaustive l’ensemble de ces questions. Néanmoins, nous avons le sentiment que les auteurs et autrices de ce numéro apportent des approches très fécondes pour penser le lien entre pratiques philosophiques et pédagogies critiques.
Les trois premiers articles, de François Galichet, Martine Boncourt, Irène Pereira et Jeffrey Jacquart nous permettent de mieux comprendre les contours de la pédagogie critique, telle qu’elle désigne un ensemble de pédagogies (féministes, anti-racistes, anti-décoloniales, en particulier) qui se revendiquent de l’héritage de Paulo Freire. François Galichet et Martine Boncourt analysent les conditions et limites de la démarche d’émancipation, à partir de la pratique concrète d’ateliers philosophiques avec les enfants. Irène Pereira, quant à elle, nous apporte un éclairage précieux en clarifiant la distinction entre émancipation et libération dans les pédagogies critiques sud-américaines (Freire, Dussel et Mignolo). Jeffrey Jacquart s’interroge sur une certaine tendance de la philosophie pour enfants et adolescents à rejoindre finalement une vision instrumentale et bancaire de l’éducation alors même qu’elle tente initialement de s’en éloigner : la raison de ce glissement serait liée à la notion de rationalité instrumentale.
Les trois articles suivants — de Kevin Rebecchi, Rémi Barrès et Thibault Vian — tentent d’explorer la façon dont l’idéal d’émancipation se questionne sur le terrain des ateliers philosophiques avec les adolescents. Cette exploration se frotte notamment à la question du cadre institutionnel dans lequel ont lieu ces pratiques.
Dans leur texte collectif, Fabiana Martins, Simone Berle et Walter Kohan présentent dans la création du Centre d’Etude de Philosophies et d’Enfance (NEFI) dont l’enjeu principal est de repenser l’enfance et les pratiques éducatives et philosophiques porteuses d’émancipation : il réfléchit à des principes caractérisant la recherche collective et la définit autour de cinq principes : se questionner, s’écouter, se présenter, égaler et errer.
Toujours sur le plan de la méthodologie, Jean-François Goubet propose de s’appuyer sur les travaux de Philippe Cam — professeur d’université australien travaillant depuis plusieurs années sur la philosophie pour enfants — afin de penser les formes de questionnement propices à la pensée critique. Quelles questions poser ? De quel type ? Dans quelle visée ? Ce regard détaillé nous apporte des clés pour la pratique avec les enfants.
Arie Kizel, Darren Chetty et Jonathan Wurtz adoptent une perspective similaire dans la mesure où ils se questionnent sur la place de l’individu dans son identité et comment celle-ci peut être problématisée en philosophie pour enfants : que faire avec les risques de domination de race, de sexe et de classe ? Que doivent faire les facilitateur.ice.s pour prévenir ces risques de domination ? Quelle place occupe l’affirmation de l’identité dans le processus d’émancipation ?
Les cinq derniers articles interrogent les outils, tremplins et méthode pour construire une pédagogie émancipatrice : Patricia Verdeau s’appuie sur le théâtre de l’opprimé et analyse son ancrage dans la pensée de Freire ainsi que ses enjeux philosophiques, notamment dans son appropriation par Augusto Boal, dans le contexte indien. Rémi David, quant à lui, mène sa réflexion dans un terrain plus scolaire, celui du lycée, et se questionne sur la dimension émancipatrice de l’enseignement, en s’intéressant notamment à la place du concept d’émancipation chez les professeurs de philosophie. Dans un cadre encore différent — celui de l’Université — Vanina Mozziconacci s’interroge — en notre compagnie — sur les éléments constitutifs d’une didactique féministe de la philosophie. Animé — entre autres — par une veine féministe, Christian Budex affronte une question complexe : la place et le rôle que pourraient jouer les pratiques philosophiques dans la prévention des violences sexistes et sexuelles : question complexe à laquelle il répond de façon prudente et éclairée, tant que point de vue théorique et pratique. Alicia Garcia part du concret — un cours de Master MEEF qu’elle prodigue à l’Institut Catholique de Paris — et explore une pratique philosophique inspirée de l’oeuvre de Daniel Hameline. Jean Praz, enfin, s’interroge sur un autre cadre : celui d’un groupe de parole philosophique entre adultes, qui s’est tenu pendant plus de vingt ans, de façon volontaire. Cette expérimentation est l’occasion, pour lui, de s’interroger sur les conditions d’une pratique émancipatrice.
Nous remercions chaleureusement les auteurs et autrices ayant contribué à ce dossier spécial. Nous remercions également les auteurs et autrices des articles situés en “Varia” : Soufiane MEZZOURH pour sa réflexion sur une philosophie “double brin”, Chloé Bouchet pour sa proposition de grille d’analyse d’atelier philosophique, Michel Tozzi pour son compte-rendu d’un séminaire sur le thème de la joie et François Galichet pour sa recension du dernier ouvrage de ce même Michel Tozzi.
Nous nous réjouissons de vous présenter ce nouveau numéro et vous souhaitons une très bonne lecture.
Johanna Hawken et Olivier Blond-Rzewuski
- De la Garza, M. T. (2023). L’éducation à l’émancipation. Dans M. R. Gregory, et M. J. Laverty, Ann M. Sharp. Aux sources de la philosophie pour enfants. Textes et études (trad. J. Hawken), p. 235-244. Vrin.
- Freire, P. (2013). Pédagogie de l’autonomie. Erès.
- Freire, P. (2021). Pédagogie des opprimés. Agone.
- Gregory, M. R. et Laverty, M. J. (2023). Ann M. Sharp. Aux sources de la philosophie pour enfants. Textes et études (trad. J. Hawken). Vrin.
- Hedjerassi, N. (2016). Les pédagogies émancipatrices. Editions du Croquant.
- Hooks, B. (2017). De la marge au centre. Cambourakis.
- Hooks, B. (2019). Apprendre à transgresser. Syllepses.
- Jespers, I. (2014). Citoyenneté démocratique et délibération comme processus émancipateur chez Matthew Lipman et Amartya Sen. Dans M. -P. Grosjean (dir.), La philosophie au coeur de l’éducation. Autour de Matthew Lipman. Vrin.
- Kant, E. (1784/2006). Qu’est-ce que les lumières. Dans E. Kant, Vers la paix perpétuelle. Que signifie s’orienter dans la pensée ?. Qu’est-ce que les lumières ? (trad. J.F.Poirier, F.Proust). GF.
- Lipman, M. (2008). À l’école de la pensée. De Boeck.
- Pereira, I. et De Cock, L. (2019). Les pédagogies critiques. Agone.
- Pritchard, M. (1996). Reasonable Children. Moral education and moral learning. University Press of Kansas.
- Sharp, A. M. (2023). L’autre dimension du caring thinking. Dans M. R., Gregory et M. J. Laverty, Ann M. Sharp. Aux sources de la philosophie pour enfants. Textes et études (trad. J. Hawken). Vrin.
- Tozzi, M. (2001). L’éveil de la pensée réflexive à l’école primaire. CNDP.
- Vincent, G. et al. (1994). L’éducation prisonnière de la forme scolaire ? Presses Universitaires de Lyon.