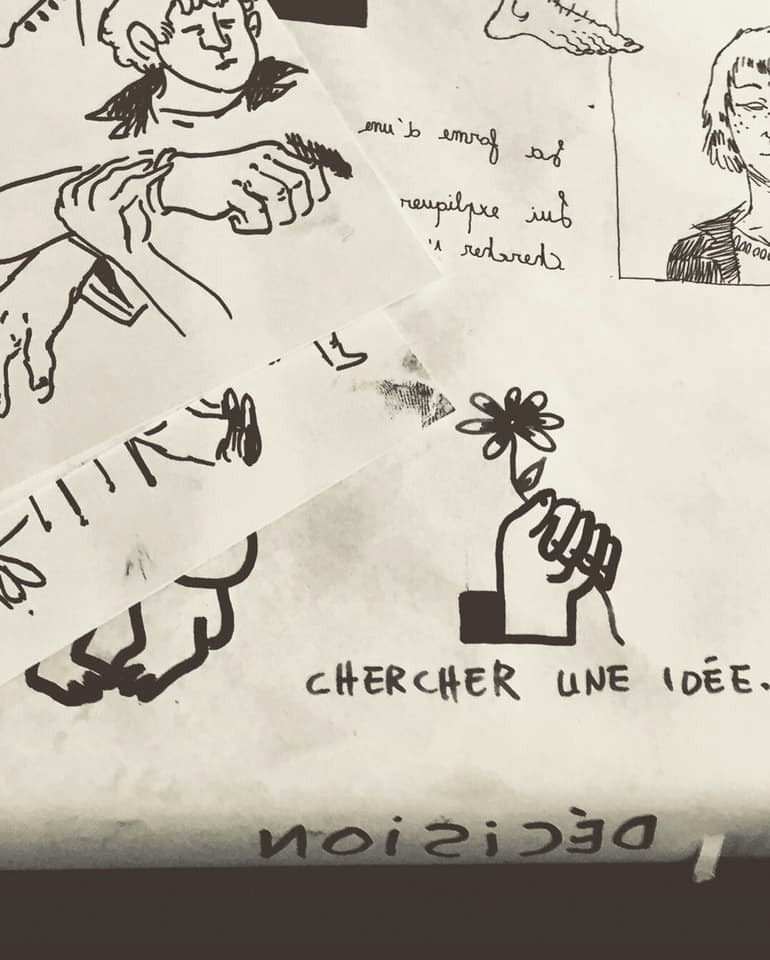Je me propose ici, suite à la communication proposée dans le séminaire "Regards Croisés", d'analyser la discussion "être différents" animée par Michel Tozzi (MT), sous l'angle de la reformulation. Je commencerai par une typologie générale des différentes formes que peut prendre la reformulation, puis, articulant l'analyse de cette animation et la question de la formation, je tâcherai de dégager quelles compétences sont mobilisées par l'animateur, quels gestes d'animation pour obtenir quels effets.
Dans l'esprit de Regards Croisés, mon propos est nourri d'un entretien avec Michel Tozzi lors duquel j'ai pu lui faire part de cette analyse, l'interroger sur ses intentions lorsque le verbatim me laissait avec plusieurs hypothèses valables, lui poser des questions afin que certains de ses gestes puissent être explicités. En effet, lors d'une animation, il y a d'abord certaines choses que l'animateur lui-même ne cautionne pas, les petits ratés liés à l'instant présent ; d'autres choses sont valides pour l'animateur, mais relèvent tout de même du moment présent, du spécifique, du contexte, et ne sont pas à prendre comme une pratique systématique ; certaines encore révèlent une posture pédagogique dont l'animateur lui-même n'a pas toujours conscience avant qu'un observateur ne le souligne ; d'autres enfin, relèvent d'une posture pédagogique délibérée et transverse, choisie par l'animateur et mobilisée pour chaque animation.
Avant de commencer, je souhaite remercier Michel Tozzi de s'être prêté à cet exercice. Rappelons ici que nous analysons une discussion qui s'est déroulée au sein même de l'UNESCO lors d'une précédente édition des NPP organisées par l'association Philolab. Ce contexte particulier mérite d'être identifié : il y a pour l'animateur, outre ses objectifs et enjeux habituels d'animateur de discussion philosophique, un objectif d'exemplarité, de démonstration : il y a lors de ces séances de nombreux observateurs qui sont là pour comprendre ce qu'est une discussion philosophique, et notre objectif, en tant qu'organisateurs de ces rencontres, étant toujours de diffuser ces pratiques, il s'agit également de convaincre que les discussions philosophiques avec les enfants sont pertinentes et bénéfiques à la formation de ces enfants.
Pour les enfants aussi, l'enjeu est différent : les participants sont très conscients de l'auditoire, au sein duquel il y a très souvent leur enseignant, le directeur d'établissement, des parents peut-être, des représentants de l'UNESCO vus comme des personnes importantes par les enfants. Le lieu est prestigieux et exceptionnel, les enfants arrivent très conscients d'une demande d'exemplarité de leur part induite par ce contexte. L'animateur aura donc à charge de rassurer les enfants et de les mettre à l'aise pour qu'un travail "normal" puisse se produire sans que les enfants soient intimidés, sans qu'ils cherchent non plus à jouer les "chiens savants", alors qu'il y a tout autour d'eux des observateurs nombreux et inconnus, parfois bruyants, parfois juges.
De plus, MT rencontre les élèves pour la première fois. Ces élèves ont déjà participé à des discussions philosophiques avec leur enseignant qui utilise, pour l'animation, la méthode de MT ; mais les enfants ne connaissent ni MT ni sa façon d'animer.
Une fois ce contexte planté, commençons.
I) Définir la notion de "reformulation"
En échangeant avec Nathalie Frieden, coanimatrice avec moi du chantier Philo-formation au sein de Philolab, nous nous sommes aperçues que nous ne partagions pas tous la même définition de ce qu'est une reformulation. Pour certains, reformulation est un terme générique qui regroupe toutes les prises de paroles de l'animateur. Ce n'est pas la définition que j'utilise ici.
Pour moi, une reformulation est une reprise de ce qui vient d'être dit. Cette reprise vise à clarifier, à éclairer ce qui vient d'être dit mais n'ajoute pas de nouvelle idée. C'est cette définition que je vais utiliser dans la suite de l'article.
La reformulation peut clarifier en structurant : pour exemple l'intervention 47 de Michel Tozzi : "tu dis deux choses" : il s'agit de mettre en lumière l'architecture, l'arborescence, de localiser dans la discussion générale où se situe l'apport qui vient d'être fait. Est-ce une hypothèse ? Une interrogation sur le contexte ? Un contre-exemple à une hypothèse proposée précédemment ? etc.
La reformulation permet également d' éclairer ce qui vient d'être en dit en mettant en lumière le critère utilisé par la personne : pour exemple, toujours dans l'intervention 46-47, Lucas parle de différence d'ADN et de différence de couleur de peau, MT les reprend en donnant des critères : différence biologique et différence physique.On est plus ici sur le contenu que sur la structure.
Pour qu'une reformulation ait plus de chance d'être adéquate, il convient de la faire valider par la personne dont les propos viennent d'être reformulés.
II) Les différentes formes de reformulation
Concernant les interactions, il y a trois grands types de reformulation.
1. La reformulation par un tiers
Cette reformulation n'est pas apparue dans cette discussion. Typiquement, deux personnes sont en désaccord apparent sur un point alors qu'elles n'envisagent pas le problème sous le même angle, ne parlent pas tout à fait de la même chose, donc ne sont pas en contradiction (voire même, parfois, disent la même chose mais de deux façons différentes)
Ex : A : "Alex est plus grand qu'Eli".
B "Ah non, Alex est plus petit".
Or A parle de la taille et B de l'âge.
Ou : A : "Alex est plus grand qu'Eli".
B : "Ah non, Eli est plus petit".
Le reformulateur intervient alors en reformulant ce que l'un a dit, en mettant en lumière son critère, et en vérifiant avec lui que sa reformulation est adéquate, puis, de la même façon reformule ce qu'a dit le deuxième. Le conflit apparent est alors désamorcé.
Notons ici qu'il ne s'agit pas de faire disparaître les divergences de point de vue à tout prix, de chercher le consensus, mais plutôt de clarifier où se situent les différences dans nos points de vue.
Dans la discussion choisie pour nos Regards Croisés, il n'y a pas de désaccord entre les participants ; chacun vient plutôt continuer l'idée qui lui plaît plutôt que de se positionner en s'opposant aux idées des autres. Il y a peu d'interactions directes de discutant à discutant : sans ces interactions, le recours à ce type de reformulation n'est pas nécessaire.
Une seule occurrence s'en rapproche, suite à un guidage de MT qui a laissé de côté la pertinence d'une intervention. On a ainsi, de 115 à 126, une reformulation de type trio (Finalement à 4 puisqu'il y a aussi l'intervention de Jonquille), où Marine met en lumière pour MT (Faussement naïf afin de pousser Marine à faire une synthèse), la différence entre son propos et celui de Jonquille. Avec le recul du verbatim, on peut voir que Jonquille a, somme toute, et sûrement sans en avoir conscience, repris le propos d'Eliot escamoté plus tôt par la question de MT recentrant "Est-ce qu'on est pareil à l'intérieur, c'est ça la question".
Marine trouve donc le critère d'Eliot, en l'attribuant à Jonquille, et le formule pour MT : "Ce qu'elle (Jonquille) veut dire c'est que du côté anatomie on est pareil au sens forme ".
2. L'auto-reformulation
Elle est utile pour corriger un énoncé qui est confus. Elle est nécessaire sur des énoncés trop elliptiques, où l'idée est si ramassée qu'on ne peut la percevoir pleinement ; elle est également nécessaire sur des énoncés trop longs, où il y a tant de matière que le propos est noyé et devient difficilement identifiable. L'auto-reformulation permet à l'énonciateur de clarifier lui-même son propos, parfois en montrant à quels autres éléments de la discussion il s'articule, parfois en le structurant (L'animateur peut aussi aider à cette structuration en indiquant le nombre de points qu'il a perçu dans le propos).
L'auto-reformulation est peu présente ici, puisque la fonction du reformulateur est institutionnalisée, elle est comme externalisée. Ceci est dû au protocole lui-même. MT sollicite tout de même quelques compléments ou approfondissements, qui sont parfois très proches de la demande d'auto-reformulation utilisée pour les énoncés trop concis.
Il y a (En 75) une demande de la part de MT : "Quand tu dis qu'on a pas tous les même points de vue, est-ce que tu peux un petit peu expliquer ce que tu entends par là ?". Suite à cela, Jonquille propose un exemple pour illustrer la différence de point de vue. Malheureusement, son exemple mobilise une différence de goût, déjà évoquée. Le goût n'est peut-être pour elle qu'un des aspects des points de vue. Mais Antoine, le président de séance, décide à ce moment de solliciter le reformulateur de façon arbitraire, si ce n'est peut-être pour ne pas oublier qu'il peut le faire. On a là je pense un effet "démonstration", Antoine a peut-être trop pris en compte l'auditoire et semble vouloir montrer la palette d'interventions à la disposition du président de séance, mais ne parvient pas à les mobiliser au moment opportun. Suite à une redite plus qu'une reformulation de la reformulatrice, l'exemple de Jonquille va passer de l'exemple parmi d'autres "Par exemple, imaginons" à un exemple représentatif : une différence de point de vue, c'est une différence de goût.
En 85-93, Ewan semble utiliser un nouveau critère pour les différences, mais n'arrive pas à le nommer dans un premier temps : "C'est pas parce qu'on a l'air pareil physiquement qu'on est vraiment pareil". MT lui demande un complément en soulignant la distinction à l'oeuvre pour que le critère soit nommé ou à tout le moins identifié : "Quelle différence tu ferais entre être pareil physiquement et être pareil... autrement ?". C'est un appel au critère qui fonctionne bien, puisque dans l'intervention suivante Ewan parle de différence "psychologique". On a alors un échange très semblable à celui dont nous parlions précédemment avec Jonquille. MT demande à Ewan de préciser, ce dernier le fait en mobilisant un exemple. Cependant ici, MT a le temps de faire une reformulation qu'Ewan va modifier. MT reprend juste l'exemple "Pour toi une différence ça peut être être plus ou moins intelligent". Ewan vient corriger cette reformulation, pour souligner que l'intelligence n'est qu'un exemple dans une catégorie plus vaste. Il ajoute ainsi un autre exemple (gentil/méchant) pour montrer l'étendue de la catégorie dessinée par le critère psychologique, qui ne se réduit pas aux deux exemples qu'il vient de mentionner.
Il y a également une auto-reformulation qui vient préciser la pensée, suite à une reformulation de MT qui ne sera pas validée par l'élève. C'est l'échange 115 à 117. Cet échange fournit un bel exemple de ce que nous avons appelé dans notre définition au chapitre 1 "clarifier" (structure) et "éclairer" (critère spécifique, contenu).
De 115 à 117, Eliot intervient après Marine qui fait l'hypothèse que nous sommes tous pareils intérieurement même si nous sommes différents extérieurement. Eliot annonce ce qui semble être une nouvelle hypothèse, différente de celle de Marine en disant "Nous sommes tous pareils intérieurement mais tout autant extérieurement", précisant que nous avons tous un nez, deux bras, deux jambes : il utilise un critère anatomique sans le nommer (comme nous l'avons vu plus haut, c'est Marine qui parviendra à verbaliser ce critère plus tard). MT reformule sur la structure en montrant la différence entre cette hypothèse et celle de Marine. Eliot corrige alors son propos en le clarifiant. Il avait en fait voulu faire un contre-exemple à l'hypothèse de Marine pour l'affiner, il reprend alors de façon plus globale. La nouvelle hypothèse qu'il propose est qu'il y a des différences extérieures et des similitudes intérieures, mais également des similitudes extérieures. Ce critère de l'anatomie vient donc apporter une nouvelle ramification à la réflexion globale : jusqu'à présent nous présupposions l'extérieur sous l'angle unique des différences, Eliot souligne que ces différences extérieures sont articulées sur une identité anatomique, même si, dans l'immédiat, ceci n'est pas repris par MT.
En 149, MT demande également un approfondissement (Il demande, sans le nommer vraiment, un critère "Essaye de le dire d'une manière un peu plus abstraite : là, quel est l'avantage, finalement d'être différent ?"). Cette demande d'approfondissement aurait pu donner lieu à une auto-reformulation, mais Joseph n'arrive pas à trouver son critère. Peut-être quelques pistes de critères possibles auraient pu l'aider. Suit, en 153, une tentative de reformulation par Lucas, mais qui ne fait que répéter l'exemple, sans identifier le critère.
On voit donc que les demandes d'auto-reformulation ne sont pas très nombreuses, et sont toujours très proches de demande d'approfondissement. Il n'y a aucune demande d'auto-reformulation pour les énoncés les plus longs. Typiquement, toutes les prises de parole de Lucas, qui est souvent confus, voire contradictoire, et parfois bien trop long (197 : 16 lignes, 227 : 11 lignes lorsque les autres interventions prennent 1 à 5 lignes) pourraient en bénéficier. Lancelot, confus en 178 (8 lignes), également. Nous y reviendrons.
3. La reformulation en duo énonciateur/récepteur ou interlocuteur
MT préfère largement ce type de reformulation. De par le dispositif employé, c'est celle qui sera la plus fréquente.
Nous distinguerons ici celles faites par MT de celles faites par le reformulateur.
Pour celles faites par MT, il y en a 2 types selon qu'il y a, ou non, demande de validation.
a) Reformulation avec demande la validation de l'énonciateur.
De façon générale, MT demande la validation de son interlocuteur quand il reformule seul. Cela est moins fréquent lorsque sa reformulation vient après celle d'un élève reformulateur. Cette validation est demandée soit par les paroles : en utilisant le conditionnel, en demandant explicitement une validation "C'est ça?" (67, 116), suivie d'une précision de l'élève - preuve que la reformulation n'était pas ici l'imposition d'une formule de l'adulte, mais bien une recherche de compréhension et clarification de l'animateur ; soit par la posture : en se tournant vers la personne, en laissant un temps de suspens pour une éventuelle reprise de la part du discutant avant de valider, "D'accord"(77), par un ton ou une attitude chaleureuse, ouverte, sollicitant la correction vis à vis de l'énonciateur (90, correction de l'énonciateur en 91).
En 206-207, MT reprend la reformulation de la reformulatrice qui n'a fait que répéter l'exemple. Il identifie le critère du "mérite" en le nommant comme tel "Ce qui est un critère quand des gens sont disons extrêmement différents c'est de tenir compte des qualités comme par exemple du mérite de la personne... l'idée que tu défendais...". Critère sur lequel on pourrait s'appuyer pour faire des distinctions plus justes entre les personnes. Il reprend ainsi parfaitement l'idée d'Antoine, et met en lumière le critère que celui a mobilisé - le mérite -, suscite par des suspens la correction ou la validation d'Antoine, et propose au passage un critère de critère, ou une catégorie plus large à laquelle ce critère pourrait appartenir : les qualités.
b) Reformulations sans demande de validation, parfois un peu décalées.
En 42, Laura propose une première ébauche de définition "Avoir quelque chose d'unique". MT répète sous forme de question "Être unique ?" pour faire valider sa reformulation. Suit une validation franche de Laura. Mais à l'intervention suivante, il reprend le propos en "Être tout seul", et le président de séance donnant alors la parole à quelqu'un d'autre, il n'y aura pas de commentaire de Laura sur cette nouvelle formulation, qui s'écarte peut-être de son idée.
En 190, sous l'apparence d'une reformulation, MT repose sa question sans finalement identifier l'apport d'Amélie en 189. Elle souligne la confusion entre différence physique et différence culturelle, morale, sur le respect, la domination, sans réussir à identifier son critère, mais en distinguant bien la force physique de la force juridique, sociale, pour ne pas se laisser réduire à l'esclavage.
"Ils ont une autre couleur on les prend comme esclave, et en plus comme ils sont moins forts... enfin ils étaient costauds mais... sinon ils se seraient pas laissés devenir esclaves".
En ralentissant le rythme, en travaillant ici la reformulation ou l'auto-reformulation par proposition de critères, on aurait peut-être pu profiter de cette belle distinction.
Il faut aussi savoir faire le deuil de belles occasions et de belles idées lors d'animation, ou alors faire le deuil des questions que l'on voudrait voir traitées. Ce dilemme est visible à la lecture du verbatim, mais pas forcément dans l'immédiateté de l'animation.
Je veux aussi dire ici un mot de ce qu'on ne voit pas. Il y a aussi souvent, dans les premières rencontres avec un animateur, des reformulations validées par l'interlocuteur alors qu'elles sont différentes de la première formulation de son idée. Cela est fréquent aussi lors d'occasion où le participant est pris par un enjeu trop grand (Avoir la bonne réponse, avoir l'air intelligent, ne pas froisser ou contredire l'adulte, etc.). Je n'en ai pas vu ici : il y a quelques interventions un peu décalées sans que la validation du participant soit demandée, ou sans qu'il ait toujours le temps de réagir lorsque le président de séance enchaîne très vite en annonçant à qui il donne la parole. Mais je n'ai pas vu d'assentiment à un propos que la reformulation aurait travesti. On peut y voir là une grande maîtrise de la dynamique de groupe de la part de MT qui a réussi, dans ce contexte très intimidant, à mettre ces élèves assez à l'aise pour qu'ils se permettent de ré-intervenir quand ils le souhaitent. On peut souligner également la mise en oeuvre de toutes les demandes de validation explicites ou implicites qu'il utilise de façon quasi-systématique, avec un ton qui dédramatise l'erreur : il laisse entendre aux enfants, de par son intonation, que tout le monde à droit à l'erreur, que lui-aussi peut se tromper, et les élèves doivent l'aider en signalant s'il n'a pas tout a fait compris ce qu'ils viennent de dire.
c) Reformulations faites par les participants.
De façon globale, les reformulations proposées par les reformulateurs ne sont pas abouties. La preuve en est, MT reformule systématiquement derrière les reformulateurs. Le plus souvent les reformulateurs ne font que répéter, et parfois seulement partiellement, ce que le discutant a dit. Il arrive que ces reprises partielles transforment l'exemple en hypothèse, escamotant ainsi cette dernière. Il y a également des reformulations qui ajoutent une idée ou développent une autre idée que celle amenée au départ (Exemple en 194).
MT propose parfois un début de correction. Exemple en 167 "Il manque un petit bout là...", puis il fait appel aux autres membres du groupe "Qui est-ce qui voudrait reformuler ?", mais il ne corrige pas Jonquille qui, au cours de sa reformulation, ajoute une nouvelle idée "Se disputer pour relâcher les nerfs".
En 199-200, Laura, après une très longue intervention de Lucas, a pour tâche, à la demande de MT, de reformuler. Elle réussit à citer, sans aucune structuration, quelques éléments de l'intervention très confuse de Lucas, puis finit par jeter l'éponge "Et à ce moment là, j'ai pas très bien compris". MT reprend alors très gentiment "D'accord, alors ce qui est important dans ce qui a été dit c'est l'idée que..." et MT donne là une des hypothèses présentes dans le fil embrouillé de Lucas. MT ne demande pas de validation à Lucas, ni d'auto-reformulation pour la suite de son propos. Mais on sent, à ce moment du script, qu'il est focalisé sur un objectif : il met tout en oeuvre pour que les élèves se saisissent de la question qu'il leur propose à nouveau.
Certaines reformulations ne sont ni validées, ni reprises. Par exemple, en 164, lorsqu'Eléonore se propose de reformuler l'idée de Félix, qui a été très bref, il aurait été intéressant de revenir à Félix pour voir si cela correspondait à son idée, ou si, en se partant de la proposition d'Eléonore, Félix arrivait mieux à mettre son propos en lumière.
D'autres reformulations sont ratées mais reprises par MT, comme si elles étaient valides (Vocabulaire de la validation, "voilà", "très bien", etc. en 235 à 238) alors que MT dit autre chose que l'enfant reformulateur : si la reformulation avait été exacte, il n'aurait pas eu besoin de reprendre, et la seule fois où il ne reprend pas la reformulation, c'est quand celle-ci est une répétition pure et simple, (une clarification de consigne plus qu'une reformulation) et est donc exacte (En 109-110).
Cela peut être à mettre sur le compte du contexte particulier qu'est la démonstration à l'UNESCO et du peu de temps passé avec les élèves ; il est difficile d'être plus exigeant quand il y a un auditoire, dont les participants sont très conscients (Présence de l'enseignant, des parents, d'une délégation de l'UNESCO peut-être).
Après échange avec MT, il y a là aussi un positionnement pédagogique choisi : ne jamais mettre en défaut un participant.
Une seule de ces reformulations ratées ne sera pas validée. Et cette absence de validation se fait le plus délicatement qui soit : en 230 "Quelqu'un a compris autrement ?". Suite à cette question de MT, Lucas demande la parole (231), signe qu'il y a bien eu un décalage entre le propos de Lucas et la reformulation de Laura. En effet, en 229, Laura résume une très longue intervention de Lucas en une hypothèse très intéressante, mais qui n'a jamais été évoquée par Lucas.
Lors du moment de métacognition sur la discussion, en 273, Amélie, qui a été reformulatrice lors de la première partie de la discussion, fait référence à la difficulté du rôle. Elle fait allusion à un moment où elle a observé que Laura, reformulatrice dans la seconde partie de la discussion, était en difficulté suite à une prise de parole de Lucas.
Je fais ici l'hypothèse que l'erreur - et l'erreur identifiée comme telle par l'animateur - est formatrice. Amélie fait référence à ce passage (En 227-230). Il convient donc, pour un animateur, de ne pas mettre en défaut les participants, tout en indiquant cependant lorsque l'exercice n'est pas complètement réussi. Pour pouvoir progresser et améliorer sa pratique, il faut que le décalage entre l'attendu et le réalisé soit perceptible, et la correction de l'animateur - avec toute la douceur nécessaire - a un grand rôle à jouer ici.
III La formation à la reformulation
1. Reprenons maintenant les conditions d'une reformulation réussie.
MT les annonce toutes très clairement au début du débat "Tu dis", "Toi tu dis", "Tu ajoutes", "Tu", ce qui appelle le groupe à la vigilance. Il mobilise quasi-systématiquement également une stratégie de validation ou correction par l'énonciateur (Conditionnel, question directe de type "C'est bien ça ?", "Si j'ai bien compris...") Il sait structurer ou mettre en lumière la structure.
Sur la forme : en 47 "Il y a deux choses que tu nous dis" "Tu fais une distinction" ; en 61 "Tu dis qu'il y a beaucoup de différences, tu donnes des exemples", "Il y a donc deux catégories" ; en 67 "Tu es du côté des ressemblances" ; en 113 "Tu fais une distinction" ; en 116 "Tu n'es pas tout à fait d'accord" ; en 207 "Ce qui est un critère" ; etc.
Sur le fond : en 116 "Tu n'es pas tout à fait d'accord" et MT dégage l'hypothèse contenue dans le contre-exemple, aide à identifier des critères, à faire des distinctions : en 87 physiquement /psychologiquement, en 204 et 207 différence de statut social/ différence de mérite, etc.
Remarques
Une reformulation ratée ou incomplète de l'animateur ouvre au travail de la compétence pour l'élève reformulateur : exemple en 174-176-177
2. Les difficultés : la demande à brûle-pourpoint.
Je me suis interrogée sur la pertinence de la demande de reformulation à brûle-pourpoint. MT choisit cette façon de faire afin de faire travailler la concentration et la vigilance des reformulateurs. Ces derniers doivent s'efforcer de tout écouter le plus finement possible parce que l'animateur peut, à tout moment, les solliciter.
Cependant parfois, les discutants sont mieux à même de reformuler que l'élève reformulateur. De plus, on augmente statistiquement les chances d'une bonne reformulation en sollicitant tout le groupe puisqu'on a alors plus de candidats, et des candidats volontaires, qui se sentent donc en capacité de répondre à la demande, contrairement au reformulateur qui peut se sentir pris en défaut.
Parfois c'est l'inverse, quand le participant est parasité par ce qu'il veut dire (Exemple : en 168, on est en droit de se demander si Jonquille a la parole et a demandé la parole pour la reformulation, ou si elle avait déjà la main levée pour participer, et l'a gardée levée lorsqu'on a soudainement demandé une reformulation). Il arrive, et c'est le cas semble-t-il de Jonquille ici, qu'un participant annonce une reformulation, mais dit son idée à lui, alimentée par le propos d'avant, ou même sans lien avec celui-ci. C'est une stratégie, parfois tout à fait inconsciente, pour avoir la parole.
Une modification très légère du protocole pourrait peut-être aider ici à l'apprentissage de la reformulation par les participants.
Le reformulateur pourrait intervenir non seulement à la demande de l'animateur, mais quand il le souhaite, et pourrait également intervenir pour demander des auto-reformulations au discutant. L'animateur pourrait, lors de la phase de métacognition, revenir sur ce rôle et demander au réformulateur d'évaluer si ses interventions étaient utiles à la discussion ou redondantes. Peu à peu, il pourrait y avoir un apprentissage du bon usage de la demande d'auto-reformulation, car systématique, elle alourdit la discussion ; absente, elle empêche de faire connaître la richesse des idées de chacun, qui resteront à l'état de brouillon.
Ici, comme le reformulateur intervient, soit à la demande du président de séance, soit le plus souvent à la demande de l'animateur, le reformulateur adresse sa reformulation plus à l'animateur qu'au groupe, et ne demande pas de validation de la part de l'énonciateur. Il y a donc ici un risque, en cas d'erreur du reformulateur ou sans la vigilance constante de l'animateur, de confisquer la parole de l'énonciateur et de lui mettre dans la bouche des idées qui ne sont pas les siennes.
Un second exercice serait de proposer, toujours sur le mode de l'intervention volontaire, que le reformulateur propose quand cela lui semble pertinent, la reformulation d'un propos qui vient d'être dit, tout en demandant la validation ou la correction de l'énonciateur. A nouveau, ces gestes seraient co-explicités lors de la partie métacognition sur la discussion.
3. Du point de vue de la formation pour l'animateur.
Quelques éléments pour s'entraîner :
- Exercer et observer l'exercice
On a vu que, en 273, Amélie a identifié le rôle de reformulateur en voyant Laura en difficulté.
- Nommer pour apprendre à identifier (déjà un peu présent : tu donnes une définition, tu n'es pas tout à fait d'accord (hypothèses contraire ou contre exemple).
Ce qui suppose de connaître la typologie pour apprendre à nommer. Ex. : hypothèse, exemple et contre-exemple ; recherche des hypothèses en présence ; contexte ; définition ; cause et conséquences ; cohérence et liens ; raison (ou argument dans la terminologie de MT) ; reformulation ; présupposés ; alternative ; sophisme/erreur de raisonnement ; reformuler sur la forme/le fond ; savoir identifier les critères qui souvent reste présupposés, non dit, en filigrane.
- Identifier les critères, ce qui permet d'être fidèle, plus abstrait, plus bref, critère d'une bonne reformulation partagé par MT dans son article