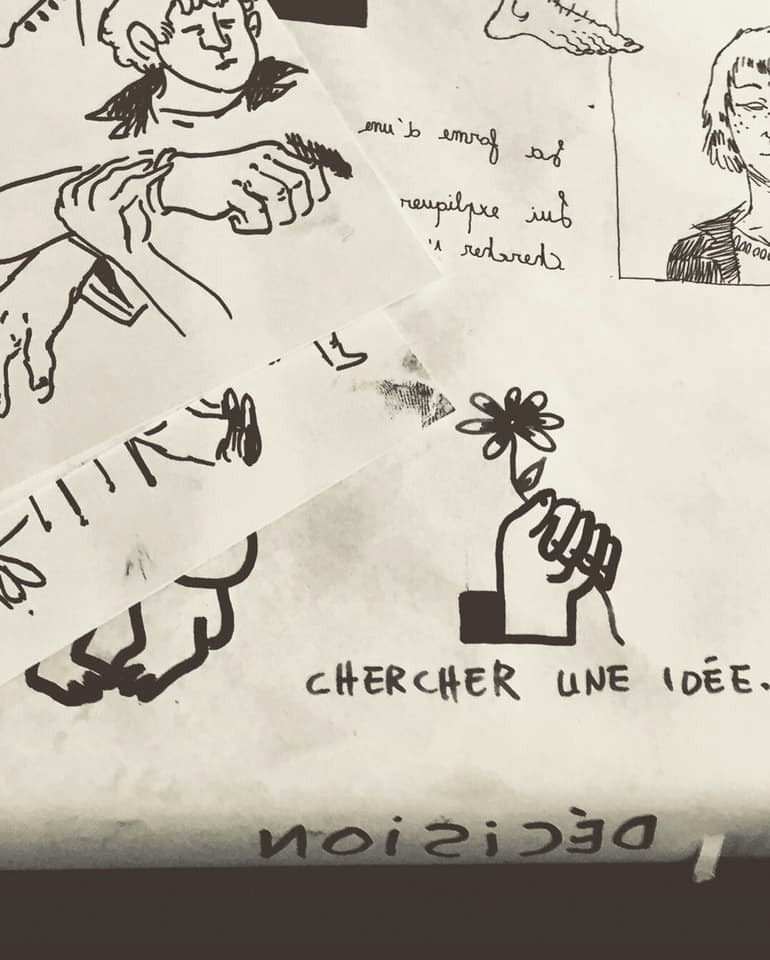La petite théologienne et le professeur de morale
J'emprunte le terme " bien tempéré " à Jean Sébastien Bach. En allemand ce mot wohltemperiert signifie le tempérament, et dans l'esprit du compositeur cela dénotait un instrument bien accordé. En musique, la succession d'une suites de vibrations de sons est harmonique lorsqu'il existe un rapport numérique entre une suite de sons et un son fondamental. D'ailleurs, dès l'antiquité, Pythagore avait théorisé ce rapport numérique pour expliquer comment vibrent les cordes de la lyre. Si on appuie sur une touche d'un piano, en théorie on entendra deux sons différents mais liés. C'est cette altération qui va donner un wohltemperiert ou une note bien tempérée.
En visionnant les enregistrements des cours de morale de Jacques Duez, j'ai pensé à cette altération : deux pensées différentes mais qui arrivent à former un accord harmonieux. J. Duez semble composer un savant dosage entre l'affectivité et la pensée pour entraîner l'enfant vers une réflexion élevée. Déjà Kant indiquait que l'important n'était pas tant de penser le réel, mais de s'intéresser à la manière dont on pense le réel, de s'intéresser au comment on catégorise ce que l'on pense.
Dans un entretien sur le thème de la sexualité, on voit une adolescente confrontée au dilemme de savoir s'il est raisonnable qu'une jeune fille de 17 ans ait un compagnon âgé de 41 ans ? Que fait le professeur de morale ? Il demande à cette adolescente de se décentrer " Si tu étais à la place des parents de cette fille que lui dirais-tu ? ". Au cours de ces entretiens, je m'apercevais que son étonnement ne découle pas de quelque ruse pédagogique. On ne voit pas un adulte plus ou moins condescendant qui juge. Il n'y a pas un rapport asymétrique entre une personne qui saurait et une autre qui ne saurait pas, c'est un dialogue qui s'établit sur le registre de l'égalité. Ce qui apparaît, c'est la mise en place d'une situation où l'adulte s'intéresse sincèrement à son interlocuteur, fût-il un enfant, et qui établit une relation d'égalité. Les questions qu'il pose à l'enfant sont parfois des demandes de clarification, rarement des questions fermées. Il s'appuie toujours sur le discours apporté par l'enfant, et par touches successives va l'entraîner jusque dans une sorte de métadiscours, dans lequel l'enfant réfléchit sur son propre discours.
La question que je me suis posée était de savoir si ce type d'entretien était reproductible. Était-il dû uniquement à sa personnalité, ou pouvait-on, en décortiquant un recueil de discussions, trouver quelques éléments qui puissent expliquer sa démarche. Je me suis intéressé à un entretien pour tenter de comprendre si J. Duez privilégiait certaines procédures au cours de ses entretiens. J'ai opéré de la façon suivante : j'ai transcrit un entretien sous la forme d'un corpus où, à chaque intervention de l'adulte, fait suite la réponse d'une enfant de huit ans (voir annexe). Les interventions sont chronologiquement numérotées (1, 2...). Les paroles de l'adulte sont en italiques, celles de l'enfant ne sont pas en italique et sont précédées d'une flèche ; exemple des deux premières interactions :
1. (en italique, Jacques Duez) Ce sont pas des copains ?
- (L'enfant) Non !
2. "Et pourquoi, le Diable est-il contre Dieu ?
- Seulement, Dieu c'est gentil, et le Diable tout ce qu'il veut, c'est tuer Dieu.
Ensuite, j'ai créé une typologie avec 6 types d'énoncés pour sérier les formes d'interventions (notées J1, J2, J3, J4, J5, J6) et de l'enfant (notées E1,E2, E3, E4, E5, E6).
Le type de dialogue conduit par J. Duez a la forme de l'entretien : l'adulte donne la parole, reformule, questionne, avec un guidage assez fort. C'est la raison pour laquelle j'ai noté les interactions du corpus 1, 2... Dans le tableau ci-dessous, on remarquera que les interventions de J. Duez (colonne de gauche) sont de deux ordres. Dans le premier cas, il questionne comme on le fait généralement avec des questions fermées (notées J1) dont les réponses attendues sont en général : oui, non, je ne sais pas ; et des questions ouvertes (notées J2) quand on peut s'attendre à plusieurs réponses possibles. Dans le second cas, ses interventions (notées J4) invitent l'enfant à élever sa réflexion soit en demandant d'expliciter, d'argumenter ou de définir certaines propositions émises par l'enfant, soit en le sollicitant à résoudre un problème (notée J5). Dans la colonne de droite on observera que les réponses de l'enfant ne sont pas toujours en symétrie avec le questionnement. L'enfant peut proposer une réponse minimale (notée E1), ou une réponse avec extension (notée E2), on retiendra le contenu de la phrase ainsi que sa structure linguistique. En principe, il n'y a pas de connecteurs logiques produits ou sous entendus. Un énoncé (noté E4) dénotera une tentative de démonstration argumentée (parce que, si ...alors, etc.), le contenu phrastique peut être cohérent ou partiellement cohérent, on jugera si l'effort intellectuel de l'enfant correspond à un énoncé réflexif. Enfin, nous avons noté E5 les moments où l'enfant s'autorise à questionner son interlocuteur, soulignant ainsi que le contrat didactique correspond à une véritable éthique communicationnelle d'où on peut espérer voir surgir une véritable réflexion philosophique.
Tableau : typologie des questions et réponses des interlocuteurs
| Interventions de Jacques Duez | Interventions de l'enfant |
|---|---|
| J0 : Pas d'intervention, il est coupé dans sa parole. | E0: Pas de réponse. |
| J1 : Question fermée. Ex. : #1, Ce ne sont pas des copains ? |
E1 : Réponse minimale, sans extension ( (Ex. : #36, Non.) |
| J2 : Question ouverte. Ex. : #13, Comment sais-tu qu'il est là ? |
E2 : Réponse avec extension, mais non argumentée. Il s'agit souvent d'une affirmation. (Ex. : #4, Le Diable il est là pour le mal) (Ex. : #19, Plus fort que Dieu !) |
| J3 : Étonnement phatique, manifestation émotionnelle qui semble dire à l'autre : tu dis des choses intéressantes, je reste en contact avec ton discours et je te considère comme mon alter ego. Ex. : #3, Oh là ! Étonnement qui reformule. Ex. :#6, Tu m'avais dit que Dieu avait tout fait ! |
E3 : Récit, L'enfant part dans son imaginaire, il est redondant. Il court-circuite son interlocuteur. Ex. :#23, Il était là, alors, et tu vois, il était très jaloux et très en colère. Et il voulait devenir le plus fort du monde. Et l'ange, donc l'ange, il est devenu fort et il se bagarre pour devenir le plus fort du monde. |
| J4 : Demande d'explicitation sous la forme d'une demande d'argumentation ou de clarification pour définir un terme. Ex. : Et, pourquoi le Diable est-il contre Dieu ? Ex. : Quel avantage il y a à croire en Dieu ? |
E4 : Réponse explicative en cohérence avec la demande, explication partielle ou complète. Ex. : #2, Seulement, Dieu c'est gentil et le Diable tout ce qu'il veut c'est tuer Dieu Ex. : #13, Même si tu vas au ciel près de Dieu, tu ne saurais pas le voir parce que Dieu il est invisible. |
| J5 : Problème à résoudre qui s'appuie sur l'énoncé de l'enfant. Ex. : #5 Oui, mais qui a créé le Diable ? Ex. : Quel avantage il y a à croire en Dieu ? |
E5 : Renversement de posture, c'est l'enfant qui questionne ou qui met en interrogation l'adulte. Ex. : #43, Oui, mais tu as le choix entre eux deux? Ex. : #42, Bon écoute, si tu crois le Diable tant pis pour toi, tu voleras ! |
Le passage de la question au questionnement réflexif s'effectue, me semble-t-il, selon deux types de procédures (noté J3). La première consiste à nourrir la discussion à partir du matériau linguistique et logique produit par l'enfant, c'est comme si c'était l'enfant qui donnait à penser à l'adulte. J. Duez, tel un Socrate, reste celui qui ne sait rien, il n'avance jamais une opinion et engage son interlocuteur dans un dialogue aporétique. La seconde procédure justifie l'autre comme un alter ego. L'enseignant extériorise de façon naturelle et expressive son étonnement, si bien que l'enfant est reconnu comme un porteur de questionnement existentiel. Ce n'est pas une simple reformulation de type empathique, c'est la manifestation d'un désir de savoir, une façon de prendre l'autre réellement au sérieux. Par contre, la réponse notée E3 n'est pas le corollaire de J3, elle dénote au contraire des moments dans la discussion où l'enfant se dérobe au dialogue. L'enfant retourne dans son monde syncrétique, son petit monde imaginaire et récite de longues litanies. C'est une façon d'interrompre momentanément le dialogue parce qu'on peut supposer que l'enfant est soit dans l'embarras soit en surcharge cognitive.
J'émets donc comme hypothèse que si Jacques Duez établit comme intention discursive l'étonnement (dans le sens d'un étayage tel que le propose Bruner), alors cela favorisera chez son interlocuteur une prise de risque nécessaire pour mettre au feu de la raison les opinions qu'il avance.
Les tableaux ci-après représentent le dialogue de l'enfant et de Jacques comme une partition de musique qui serait découpée en quatre oscillations. (Graphique1) Le premier mouvement serait, allegro, la discussion est enlevée, les questions de Jacques alternent avec les questions problèmes et les questions habituelles (fermées ou ouvertes). Les réponses de l'enfant sont en écho à cette demande. Très rapidement l'enfant va se placer dans la posture d'un théologien : " Dieu est bon et le monde est mauvais parce que c'est le Diable qui nous met de mauvaises idées dans la tête. " Le professeur va mettre sous le feu de la raison de telles affirmations en s'abstenant de porter un jugement sur les explications de l'enfant. En fait, l'enfant tel le philosophe Berkeley rejette le matérialisme et le langage comme outil explicatif de l'idée de Dieu. Et on voit que dans les interactions 6 et 7 c'est l'enfant qui relance la discussion ("6 Oui mais il n'a pas fait le Diable ! Tu n'imagines pas que Dieu est un gentil, et il va faire un méchant ? 7 Un méchant pour attaquer lui ? ").
Le Second mouvement (Graphique 2) est moins vif, allegro ma non tropo, Les interventions de J. Duez étayent le raisonnement de l'enfant qui arrive peu à peu à construire et à formuler une thèse explicative pouvant faire l'objet d'une discussion éthique. Le maître construit ce dialogue à partir de ce que l'enfant peut apporter. Le bouton d'aiguillage pour amener l'enfant vers un oral réflexif semble bien être l'émotion de l'étonnement qui encourage son interlocuteur à poursuivre le cheminement de son idée. J. Duez manifeste son étonnement : "16 Et qui est cet autre ennemi de Dieu. C'est très bon ce que tu dis, c'est intéressant ! 18 Un Jésus Diable, ah ! ce n'est pas une bête idée ! 20 Que Dieu !!! 22 Ah ! C'est par jalousie ! Et qui t'a raconté ça ? 23 Ah ! Très bonne explication ! " Toutes ces relances s'appuient sur le discours produit par l'enfant et l'encouragent à maintenir un niveau de réflexion élevé. Comme on le voit dans le graphique la moitié des réponses de l'enfant sont explicatives et avancent une thèse : le Diable agit par jalousie, il veut devenir plus fort que Dieu.
Le troisième mouvement (Graphique 3), andante, apparaît comme un répit. L'enfant esquive le dialogue, il se campe dans le narratif plus ou moins explicatif, c'est un monologue qui ne laisse pas de place à l'autre. Plus de la moitié des interventions de J. Duez sont coupées, l'enfant ne le laisse pas intervenir. C'est une espèce de logorrhée, une sorte de stratégie où l'enfant semble reprendre son souffle en récitant des histoires qu'elle a mémorisées. Il est possible que les questions précédentes l'aient un peu déstabilisé et qu'il s'accorde cette pause. Sur les douze interventions, J. Duez se voit interrompu à sept reprises. Ceci souligne également, dans ce type d'entretien, que l'enfant s'autorise à prendre l'initiative en tant que débatteur. Le contrat didactique de l'entretien a transformé la culture classique de la réponse en celle de la question. Le professeur n'est plus celui qui sait et qui pose des questions pour vérifier ou tenter d'inciter l'élève à deviner ce qui fonde une explication. L'enseignant est ici dans une posture de recherche où l'élève se rend compte qu'il peut en savoir, peut-être, autant que son professeur et que de ce fait il peut se permettre de prendre le risque de s'aventurer tout seul vers l'abîme de la sagesse.
Le dernier mouvement (Graphique 4), scherzo, renoue le dialogue entre l'élève et le professeur. Le graphique montre un dialogue qui situe constamment l'échange sur le plan le plus élevé et réflexif de la discussion : clarifications explicatives (J4, E4), problème à résoudre (J5) et l'enfant dans une posture de questionneur (E5).
La fin de la discussion entrecroise une subtile dialectique entre les propos de la petite théologienne et le discours rationnel du professeur de morale. La petite théologienne ramène sans cesse la raison au service de la croyance et le dernier mot reste son soupir que J. Duez se gardera bien de combler.
Pour conclure, j'ai essayé de montrer qu'il était possible de pointer certaines procédures dans la façon dont J. Duez conduisait ses entretiens. L'entretien sous-tend une visée philosophique. En effet, on s'aperçoit que les paroles de cette enfant de huit ans sont empreintes de métaphysique. Rappelons- nous comment Kant a reformulé les objets platoniciens (le Bien, le Beau et le Vrai) : que m'est-il permis d'espérer (religion), que dois-je faire (éthique) et que puis-je savoir (métaphysique). On peut suivre dans le cours de la discussion la façon pertinente dont J. Duez va pointer les propos de l'enfant.
Dans la première partie il repère un discours religieux et invite donc l'enfant à se mettre à sa place en lui demandant quels avantages et ce qui lui serait permis d'espérer s'il croyait. Puis, peu à peu il s'aperçoit que l'enfant campe sur des positions théologiques, c'est-à-dire sur l'être divin donc la métaphysique, alors il déplace le fond de la discussion vers le " que puis-je savoir ? ". Et on va retrouver chez cet enfant des idées proches de celles développées par le philosophe Berkeley qui supposait que l'être des objets est d'être perçu et celui des sujets de percevoir et de ce fait la seule chose qui pouvait exister c'était l'esprit et tout ce qui était matériel n'était qu'une illusion. Cette thèse se retrouve à la fin de la discussion quand l'enfant et l'enseignant dialoguent pour savoir qui est à l'origine de la connaissance métaphysique, une personne ou Dieu ? L'enfant ne nie pas la réalité du monde extérieur que l'on peut éprouver par ses perceptions sensibles (le feu dans la pétrolette, ou dans la lampe), elle réfute le caractère matériel de cette perception (c'est le Diable qui te le dit dans ta tête). Elle reprend à son compte ce qu'écrivait Berkeley " Les choses ne sont rien d'autre que des complexes d'idées perçus par Dieu et suscités en nous par une affection de notre esprit. "
Un entretien entre Jacques Duez et un enfant n'est pas considéré comme un banal échange. Il ne s'agit pas d'une discussion entre un enfant qui réciterait son catéchisme et où le rôle du professeur serait de pointer les incohérences et de mettre en garde l'élève au nom de quelques grandes déclarations juridiques ou vertueuses. Il s'agit d'une rencontre entre deux êtres, une confrontation entre deux intelligences, dont les outils intellectuels ne sont pas forcément symétriques, mais dont l'éthique discussionnelle repose sur le socle du principe de l'égalité.
ANNEXE I : Graphiques
<div class=“bloc_image_interne”> <img src=“/static/images/D020009B.PNG”/> <p class=“legende_image”>Graphique 1 ALLEGRO</p> </div>
<div class=“bloc_image_interne”> <img src=“/static/images/D020009C.PNG”/> <p class=“legende_image”>Graphique 2 ALLEGRO MA NON TROPO</p> </div>
<div class=“bloc_image_interne”> <img src=“/static/images/D020009D.PNG”/> <p class=“legende_image”>Graphique 3 ANDANTE</p> </div>
<div class=“bloc_image_interne”> <img src=“/static/images/D020009E.PNG”/> <p class=“legende_image”>Graphique 4 SCHERZO</p> </div>
ANNEXE II : paroles rapportées de l'entretien Jacques et la petite théologienne
- (L'enfant) Seulement, tu vois quand tu fais des bêtises... Par exemple, si tu voyais un beau crayon avec +++ et que tu le voles ; ça c'est le Diable qui te le fait faire, parce que Dieu il te dit dans ta tête "ne le fais pas, ne le fais pas" et Diable il te dit "fais le, fais le". Parce que le Diable il est contre Dieu et Dieu il est contre le Diable.
1. "(en italique, Jacques Duez) Ce ne sont pas des copains ? (J1)
- Non ! (E1)"
2. "Et pourquoi, le Diable est-il contre Dieu ? (J2)
- Seulement, Dieu c'est le gentil, et le Diable tout ce qu'il veut c'est tuer Dieu. (E4)"
3. "Oh là ! (J3)
- Le Diable il veut tuer Dieu pour faire faire aux gens des bêtises voilà ! Tu peux me croire. Le Dieu il est là pour le bien. (E4)"
4. "Et le Diable ? (J2)
- Le Diable, il est là pour le mal ! (E2)"
5. "Oui mais, qui a créé le Diable ? (J5)
- Ah ! c'est pas Dieu ! (E2)"
6. "Tu m'as dit que Dieu avait tout fait ! (J3)
- Oui mais il n'a pas fait le Diable ! Tu ne t'imagines pas que Dieu est un gentil, et il va faire un méchant ? (E5)"
7. "Je n'en sais rien ! (J 1)
- Un méchant, pour attaquer lui ? (E5)"
8. "Non, ce n'est pas possible. (J1)
- Ça c'est pas possible, allons... !! (E3)"
9. "Alors comment expliques-tu la présence du Diable ? (J5)
- Mais le diable, existe pour du vrai ! (E2)"
10. "Mais comment est-il venu, qui l'a fait ? (J5)
- Seulement, il faut pas dire des gros mots et dire ça au Diable, parce que le Diable il nous entend, il nous voit, il est dans le feu ! (E4)"
11. "Partout ? Mais ce feu, où est-il ce feu ? (J4)
- Il est partout ! Il y a du feu à l'école ? Il y a un poêle, si tu allumes, le Diable il est dans le feu. Quand j'allume ma pétrolette dans ma baignoire, ma maman, elle allume la pétrolette et bien il y a le feu et le Diable il est dedans. (E4)"
12. "Et tu le vois ?(J1)
- Non, on sait pas le voir. (E4 * sous entendu du parce que...)"
13. "Comment sais-tu qu'il est là ?(J2)
- Même si tu vas au ciel près de Dieu, tu ne saurais pas le voir parce que Dieu il est invisible. (E4)"
14. "Je repose la même question, je suis d'accord avec toi. Tu me dis que Dieu n'a quand même pas créé le Diable. Cet énergumène lui cherche des misères, il lui en veut à mort. Mais ce que je ne comprends pas c'est comment il s'est fait le diable ? Il s'est fait tout seul ?(J5)
- (Soupir...) Non ... (E1)"
15. "Alors, comment est-il venu celui-là ? (J2)
- Alors c'est un autre ennemi de Dieu qui a construit le Diable. (E4)"
16. "Et qui est cet autre ennemi de Dieu. C'est très bon ce que tu dis, c'est intéressant. (J3)
- (Réflexion ...) Ça y est... Je sais. Dieu il a eu un enfant ? Je veux dire, il a eu le Jésus. Ah ben... le Diable il a eu un enfant... (E4)"
17. "Comme le Jésus. (J2)
- Un Jésus Diable ! (E2)"
18. "Un Jésus Diable, ah ! ce n'est pas une bête idée ! (J3)
- Tu vois avant, tout avant y avait rien du tout. Il y avait des petits anges, tout avant il n'y avait rien du tout, il y avait des petits anges et Dieu était là. Il y avait un petit ange qui voulait être plus fort. (E4)"
19. "Plus fort que les autres ? (J2)
- Plus fort que Dieu ! (E2)"
20. "Que Dieu !!! (J3)
- Que Dieu, l'ange alors il est devenu fort et il veut tuer Dieu parce qu'il veut devenir le plus fort, le plus costaud, pour devenir plus fort que Dieu... (E4)"
21. "Ah ! Mais comment (interrompu par l'enfant) (J0)
- Parce que tu vois, c'est par jalousie ! (E4)"
22. "Ah ! C'est par jalousie ! Et qui t'a raconté ça ?(J3)
- C'est papa. (E1)"
23. "Ah ! Très bonne explication. (J3)
- Il était là, alors, et tu vois, il était très jaloux et très en colère. Et il voulait devenir le plus fort du monde. Et l'ange, donc l'ange, il est devenu fort et il se bagarre pour devenir le fort du monde. (E3)"
24. "Oui... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- Et c'était Dieu...(E3)"
25. "Et... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- Mais un peu plus tard, Dieu il va faire disparaître le Diable. (E3)"
26. "Tant mieux ! (J3)
- Mais il faut des dizaines, des centaines, des milliers...(E3)"
27. "Des milliers d'années...(J3)
- Des milliers de jours. (E3)"
28. "Mais... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- Des milliers de jours pour que le Diable soit tué par Dieu. (E3)"
29. "Mais ... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- Il faut des milliers de jours pour tuer le Diable. Mais moi je pense... Tu vois quand tu as une maladie et que ... Que tu es mort. C'est le Diable qui te fait mourir. (E4)"
30. "Ah bon, ce n'est pas la maladie ? (J4)
- Non c'est Dieu qui fait de tout son possible pour ne pas nous faire mourir. Seulement, c'est le Diable grâce au pouvoir du diable qu'il fait mourir. (E4)"
31. "Mais... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- Et Dieu, il fait tout son possible pour ne pas faire mourir les gens, mais c'est le Diable. (E4)"
32. "Dis, écoute je vais te poser une question ... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- (Elle montre une ampoule d'éclairage) La dedans, y a du feu, et bien diable est dedans ! (E2)"
33. "Non !, dans la lumière du cours de morale ? (J3)
- Si, si. (E1)"
34. "Même dans la lumière du cours de morale ? Aïe ! (J3)
- Je vais te dire dans quoi est-ce qu'il est ; il est partout dans le feu ! (E2)"
35. "Mais ... (Interrompu par l'enfant) (J0)
- Il est partout dans le feu, il est dedans. La lumière c'est du feu, il est dedans. (E2)"
36. "Écoute bien ce que je vais te dire. L'histoire de Dieu et du Diable est-ce que ce n'est pas des histoires comme l'histoire de la Belle au Bois Dormant, de Blanche Neige ? (J1)
- Non ! (E1)"
37. "Ce ne sont pas des légendes comme E. T. ? (J1)
- Non !!! Il faut croire !!! (E2)"
38. "Tu crois que je dois y croire ?... Oui ?... Pourquoi penses-tu que je dois y croire ? (J4)
- Parce que c'est la vérité ! (E4)"
39. "À ton avis qui est-ce qui a construit la Terre si Dieu n'était pas là ? Un petit correspondant a dit que c'était la Nature. (J4)
- Ah non ! La Nature n'a pas poussé toute seule ... Puisque avant il n'y avait personne sur la Terre. Alors ... hein ... On n'a pas réussi à mettre de graine voyons !!! (E4)"
40. "Oui mais les choses se sont faites petit à petit, il y a eu dans le sol des éléments dans la terre puis c'est devenu des arbres. (J3)
- Mais il faut croire, il faut croire en Dieu, parce que... (E2)"
41. "Parce que quoi ? Tu crois que c'est mieux, quel avantage il y a à croire en Dieu ? (J4)
- Il faut vraiment croire... Dieu. (E1)"
42. "Qu'est-ce qui va changer dans ma vie si je mets à croire en Dieu ? (J5)
- Bon écoute, si tu crois le Diable tant pis pour toi, tu voleras ! (E5)"
43. "Mais moi je ne crois pas le Diable ! Je ne l'écoute pas ! (J3)
- Oui, mais tu as le choix entre eux deux ! (E5)"
44. "Mais, j'ai le choix aussi à ne croire ni en Dieu, ni au Diable. (J4)
- Alors tu ne sauras rien du tout, parce que quand tu sais quelque chose c'est Dieu qui te le dit plusieurs fois et après tu l'as dans ta tête. (E4)"
45. "Mais prenons un exemple, quand tu apprends à calculer c'est toi qui apprends à calculer, quand tu apprends à lire c'est toi qui apprends à lire.(J4)
- Oui, je ne veux pas dire apprendre, je veux dire si tu savais. Par exemple, quand on allait dans le cimetière, quand on serait mort et bien c'est Dieu qui te le dit plusieurs fois et puis tu sais, tu l'as dans ta tête. (E4)"
46. "Je sais qu'un jour quand je mourrai, on me mettra dans un cimetière. Ça, je le sais parce qu'on me l'a dit, l'instituteur me l'a dit, mes parents aussi, je l'ai appris.(J4)
- Hé ! Mais écoute, tu vois c'est Dieu qui a dit aux gens tout ça, qui a dit ça aux gens, à tous les gens plusieurs fois. (E4)"
47. "À toi qu'est-ce qu'il t'a déjà appris. Pas à lire, pas à écrire, pas à compter ça c'est avec M. Deruyver ton instituteur d'accord ? (J4)
- Mais c'est Dieu qui a dit à M. Deruyver...(E4)"
48. "M. Deruyver a appris à lire avec son instituteur.(J4)
- Oui mais Dieu il l'a dit à son instituteur. Il faut vraiment croire Dieu tu vois...(E4)"